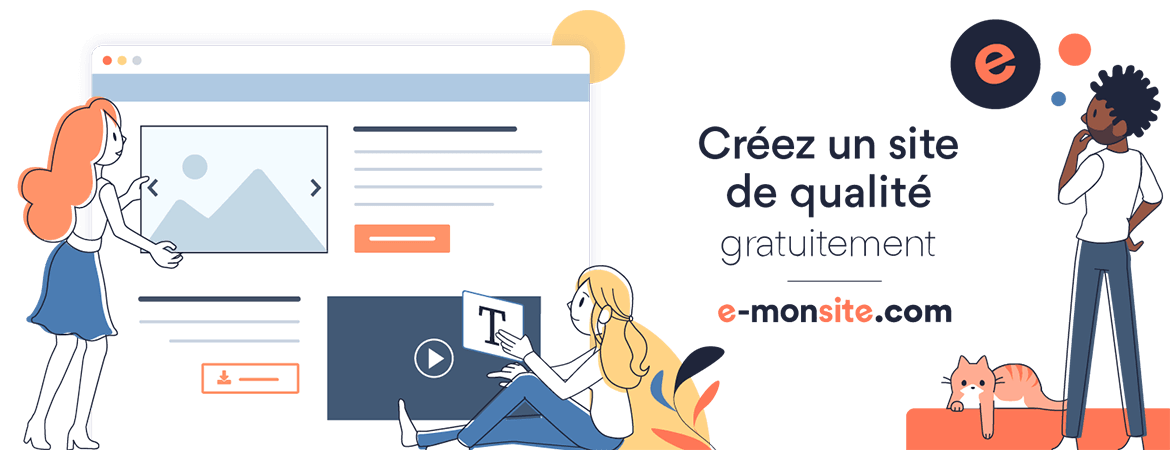Billets
Pas d'école pour Pascal...
- Par clopine
- Le 04/03/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Je pourrais dire tout simplement que Pascal Quignard m'étonne - ce qui, l'âge et la raison aidant, m'arrive de moins en moins - mais ce ne serait pas suffisant pour expliquer l'intérêt que je porte à ce drôle de bonhomme.
Certes, au niveau biographique, lui et moi avons un point commun, que nous partageons avec des myriades d'autres êtres humains : celui de ne pas avoir été désiré. Mais cela ne suffirait pas à justifier la lecture ardue, secrète, mystérieuse, en un mot : sentant l'effort, que je pratique pourtant, presque malgré moi.
J'ai également discerné ce qui, pour moi, fait la particularité de cet auteur : il s'attache à des objets, comme "la pensée", "le temps", "la sexualité" qui sont depuis belle lurette des incontournables de la pensée philosophique ou scientifique. Mais lui ne s'inscrit dans aucune de ces démarches : il n'en a cure, et trace obstinément une voie qui, pour toute érudite qu'elle soit, n'en est pas moins irréductible à quoi que ce soit de connu.
Je l'ai une fois comparé à un diamantaire, qui, devant une pierre brute, met au jour les facettes au départ invisibles de son objet d'étude. Mais il va sans dire que cette comparaison pourrait être tout aussi vraie de n'importe quel philosophe attelé à son concept. La particularité de Quignard, c'est bien qu'il n'adopte pas la démarche philosophique. Qu'il lui tourne même, presqu'ostensiblement, le dos...
IL va donc procéder, très précisément, comme un mosaïste. Regardant son sujet sous toutes les facettes, mais à l'aide d'outils de savoir non utilisés par les autres. Par exemple, l'ourage commencera par un récit tiré de tel manuscrit datant du moyen-âge, racontant telle anecdote historique ou religieuse, contenant un rapport plus ou moins loitain avec son sujet. Et là où d'autres chercheraient à mettre en parallèle l'enseignement tiré de l'histoire en faisant un parallèle avec notre modernité, Quignard, lui, nous invite à le rejoindre dans l'espace-temps où l'histoire, ou historiette, ou fable, ou anecdote, ou récit, fut inscrit. Il nous invite à faire le chemin inverse de celui qui nous est d'habitude proposé : nous voici sommés, si nous le suivons, à réfléchir, à réagir, à penser le réel comme tel ou tel protagoniste médiéval, ou latin.
Je dis "ou latin" à dessein, puisque le propos de Quignard, tournant le dos à la philosophie, l'emmène bien évidemment plus volontiers dans la Rome antique que dans la Grèce de Périclès : les Grecs ne faisaient rien d'autre que de la philosophie. Les latins, eux, construisaient patiemment l'idée de droit, et tentaient de résoudre ainsi les trébuchements de leur société. Nul doute que Quignard se sente plus volontiers de leur côté - nonbostant sa résistance à l'idée de dieu (qui est encore quelque chose que je patage avec lui, mais là, nous sommes bien moins nombreux, hélas !) - car les plus belles mosaïques sont bien romaines, et non athéniennes... Et puis, il y a dans cette tentative latine de définir le droit, quelque chose qui, transcendant la philo, amène directos à l'humanisme (qui est le sujet caché de toute l'oeuvre quignardienne, son interrogation profonde sur son individualité, son refus d'inscrire sa sensation de soi dans la lignée des idées communes à ce sujet, cette croyance que la lumière viendra de la juxtaposition d'éléments disparates, ce paradigme qu'il fait toujours entre le récit et l'ineffable de la musique...) : dépassant la loi "naturelle" - c'est-à-dire "sans morale", un chien ne sait pas le bien ou le mal, il connaît juste l'autorisé et l'interdit, (ce qui fait le rêve de tout dictateur : ne réfléchissez plus, ne tentez plus d'être face au monde, laissez-moi vous dissoudre dans le monde magique où la vérité est dans l'abolition de la pensée et l'adoption de la Loi) - et tentant de proposer des codes qui refléteraient une société "civilisée"...
Quignard s'appuie sur son érudition pour nous emmener dans un chemin extrêmement étroit, réduit à lui-même en quelque sorte : c'est en cela qu'il ne pourra jamais être assimilé. N'importe quel autre penseur (mais Quignard divague plus qu'il ne pense, ou plutôt, il ne cherche pas à "penser", il cherche à obtenir le plus de reflets possibles de la pierre qu'il taille) éprouve, tacitement ou ouvertement, le désir de "faire école". Quignard, lui, ne montre aucun chemin. Surtout pas. En ce sens, il n'est pas non plus du côté des Lumières. Il nous invite simplement à venir avec lui descendre dans l'obscur...
Evidemment, c'est casse-gueule. Mais on y trouve tant de beautés. Certes, c'est une posture qui n'interroge pas notre monde contemporain, puisque tout ici est fait pour qu'on rejoigne ceux qui nous ont précédé, au plus près d'eux-mêmes et non de nous. Mais la splendide solitude qui en découle n'est-elle pas la seule réponse que l'incomparable érudit pouvait apporter à sa présence au monde ?
Hmmmhhhhh ???
Le crépuscule des yeux
- Par clopine
- Le 03/03/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Le rendez-vous chez l'ophtalmo est fixé au mois de juillet. Mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir attendre jusque là, tant la brûlure de mes yeux devient désormais permanente.
Au boulot (sept heures d'écran par jour), me voilà obligée de porter des lunettes de soleil pour supporter la luminosité des écrans. A la lecture, je dois avori recours à la loupe, ou à une lumière puissante (qui abîme encore un peu plus) pour discerner les caractères. Et la douleur est désormais constante.
j'ai toujours fait le rêve, né d'une conviction bizarre de la justice, d'une vieillesse heureuse. C'était compter sans ses infirmités. Oh, je dois relativiser : les vieux d'aujourd'hui ne sont plus les pauvres infirmes d'hier... Il n'empêche : la métaphore de 'la nuit qui vient" pourrait bien, dans mon cas, se revéler plus douloureuse que je ne l'avais escompté.
Payer l'addiction...
- Par clopine
- Le 02/03/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Par nature, je suis addictive. Enfin, comme on dit aujourd'hui. Au 17è siècle, on aurait peut-être parlé de "fidélité", au sens de clientèle et de loyauté...
En tout cas, tombée dans les pièges de l'addiction (c'est-à-dire de la facture qui est toujours brandie, à la fin), je ne connais qu'une manière de m'en sortir. Celle de la louve qui, prise au piège, consent à se séparer de sa patte, en échange de sa liberté.
Au Québec, un jeune animateur de pourvoirie, afin de justifier les modes de chasse actuelles, a un jour enfermé mon poignet (qui, du coup, était si menu, étroit et fragile qu'on aurait dit une patte de sauterelle) dans un "nouveau piège", entendez un piège à loups mais caoutchouté de manière à ne pas blesser l'animal pris. Je n'ai pas osé, tant le discours du jeune homme était empli de sincérité et de passion pour les animaux qu'il disait côtoyer tous les jours, lui demander si, malgré l'absence de douleur physique , certains continuaient néanmoins à préférer la mutilation. Il m'aurait répondu "non", convaincu. Je suis certaine du contraire. C'est ce qu'on appelle "y laisser des plumes". C'est la loi.
J'ai donc rogné ma peau, entaillé mes veines et scié mes os, mais j'ai décidé d'arrêter de fréquenter la République des Livres. Une de mes plus grosses addictions. Il y a quelques jours, un des participants à ce blog littéraire a été enterré, et son départ a reçu des hommages mérités. Je n'en attends pas tant : je sais que sur ma tombe virtuelle (car mon dernier commentaire était un adieu) tomberont très certainement trois roses, et vingt brouettées d'indifférence ou de méchanceté. Peut-être mon départ est-il aussi ma manière de saluer le disparu ?
J'ai un jour dit à un jeune médecin (j'impressionne toujours les médecins, je m'en suis rendue compte à leur empressement à me prescrire tout ce que je peux bien leur demander) que ma seule addiction, en réalité, était Clopin. Je disais ça en souriant... Mais pour le prouver, ne faut-il pas d'abord que je me débarrasse de toutes les autres, grandes et petites ?
Comme les apnéistes, le sevrage s'opère par palier, quelque soit l'addiction à traiter : disons que je vais commencer par me contenter de lire le Magazine Littéraire, et de m'emporter, comme il m'arrive si souvent, contre les opinions qui y sont émises et le style vulgaire et manichéiste avec lequel on y exècre certains auteurs. Mais je ne porterai plus mes indignations "là-bas" : c'est le début du traitement !
Et nous verrons bien si mes démangeaisons littéraires survivent à l'abstinence, et à la réflexion...
Bye Bye Larry...
- Par clopine
- Le 22/02/2017
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Tellement aimé ça... Ca s'appelle "twin house", ça n'a pas vieilli (mais Larry Corryel est mort aujourd'hui !)
Sinon, pour répondre à Paul Edel : oui, sans doute avez-vous raison - jamais de trève, jamais de repos, et un monde toujours et sans cesse sanguinolent. Je persiste cependant à penser que nous assistons effectivement à la renaissance des vieux démons - le nationalisme, le repli sur soi- et que tous les néofascismes en profitent. Je voudrais vous dire aussi que le repli sur le privé est un peu plus difficile à pratiquer quand on a un fils et un beau-fils de respectivement 23 et 33 ans : de jeune adultes, qui peuvent basculer du jour au lendemain dans un monde bien plus violent que celui que nous voulions leur léguer. N'avez-vous jamais ressenti cette sorte de responsabilité, vis-à-vis de vos enfants, et cette sorte de honte, à voir toujours ressortir les mêmes spectres que ceux que d'autres, avant nous, ont bel et bien dû combattre ?
je soupire d'avance : le résultat du prochain scrutin a toutes les chances de me faire, une fois de plus, arpenter les rues. En vain, bien entendu, en vain..
L' Ecosse (art)
- Par clopine
- Le 21/02/2017
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Nous partons en mai pour l'Ecosse. Ca laisse trois mois à Clopin et Clopinou pour se préparer...
L' excitation de la bougeotte
- Par clopine
- Le 11/02/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Ca se passe comme ça d'habitude : la kangoo (avant et pendant longtemps, jaune PTT, désormais bleu glacé) est pile devant la porte, Clopin et moi nous agitons là autour, déplaçant les sacs et posant le pique-nique à portée de mains, le chien, alllongé sur le carrelage de la cuisine, nous regardant de loin et d'un air lugubre (il sait que, sauf exceptions, il restera là, et prend toute l'agitation nocturne pour un abandon caractérisé - il est à deux pattes d'écrire à la SPA, et même s'il sait parfaitement que tout est prévu pour lui, il estime qu'on aurait pu mettre en place une cellule psychologique, ou au moins une psychothérapie décennale).
Et puis c'est le départ en pleine nuit.
Longtemps, le dernier acte était d'aller chercher le Clopinou dans sa chambre, de le descendre enveloppé dans la couette, de le déposer à l'arrière de la voiture avec son oreiller, tel un petit papoose parti sur la piste des bisons. Certes, il ne s'agissait plus ici, que de rejoindre l'autoroute, et les bisons ont des doubles pneus , des feux à l'arrière et la mention "TIR" apposée sur la porte salie.
Mais nous sommes des humains, et quoi de plus humain que l'excitation de la bougeotte, quelles qu'en soient les conditions ? Pendant longtemps, j'ai appréhendé, pour le fiston, l'inconfort de ces départs. "Tu rigoles", m'a-t-il répondu récemment, "c'était le meilleur : j'adorais ça. Etre porté dans l'escalier, rester dans la couette, savoir qu'on partait, garder les yeux fermés et les ouvrir juste comme ça, très vite : pourquoi croyais-tu que je faisais semblant de dormir ?"
J'aurais pu m'en douter...
Comme tous les ans à pareille époque, le départ se fait, pour ces vacances-ci, sans moi : je reste avec le chien (!) - je ne skie pas, et il n'est pas désagréable de rester seule, lorsqu'on sait que cette solitude a un terme.
Il ya quelques années, j'aspirais même à cette rupture - le boulot, plus le quotidien, les repas et la maison, c'était lourd, et d'un coup je me retrouvais légère. J'ai beaucup moins besoin de cette halte désormais, je l'appréhende même un peu - des fois que je ne me joue des tours et ne découvre, à force d'introspections et de vagabondage mental, une Clopine douloureuse, seule en face d'elle-même.
Un peu comme le chien, quoi.
Une Arendt dans le gosier...
- Par clopine
- Le 02/02/2017
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Perso, aprèsa voir visionné le film (j’allais écrire « documentaire » !) sur Arendt, hier au soir, j’ai pensé que la banalité du mal vient certes de la médiocrité d’une pensée fanatisée ET administrative, mais aussi, plus globalement, de notre déconnection du monde sensible. (même si ça doit vous faire hurler tous, je trouve que la racine est la même. Y’a qu’à aller visiter une usine de porcs pour comprendre ce que je veux dire : c’est un cerveau « nazi » qui a inventé ça, pas possible autrement°
J’ai attrapé un stylo pour noter que, quand Arendt parle de l’homme devenu « superflu » dans les camps de concentration (avec la destruction totale des valeurs qui s’en suit), on pourrait étendre cette notion à la nature : elle aussi est devenue « superflue » pour tellement de nos contemporains ; la publicité pour la Renault Scénic est pour moi tout aussi banalement terrifiante qu’Eichmann – en encore plus sournois, en quelque sorte.
La déclinaison actuelle de la pensée d’Arendt, c’est aussi Daech, qui rentre parfaitement dans le schéma totalitaire éclairé par la philosophe.
(j’aurais voulu en savoir tellement plus sur cette pensée mais le « biopic » était trop restreint à ce niveau-là.)
ah oui, lien vers la pub, pour que vous voyiez ce que je veux dire quand je parle de « terreur » : une vision de l’avenir totalement irréelle, quoi. Ou la moindre brindille devient « superflue »… https://youtu.be/1N-uNgCS_xg
A(h) A(h) A(h)
- Par clopine
- Le 31/01/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Bien sûr, mon désengagement militant auprès de la Fédé n'en a pas pour autant amoindri mon intérêt pour les idées et les convictions qui étaient agitées là. Passant ainsi de l'anarchie au féminisme, puis à l'écologie, je me rends bien compte qu'on pourrait m'accuser de Bouvardetpécuhettisme - je ne serais certes pas la seule -mais je ne crois pas que c'était le cas.
Je tâtonnais, ça, c'est sûr, d'autant que je ne disposais pas du corset universitaire - qui certes rigidifie les pensées, mais qui permet néanmoins de se tenir droit. Mais contrairement aux héros flaubertiens, je conservais soigneusement, à chaque étape, ce qui m'avait nourri à la station précédente. J'étais en réalité une éponge, tendue vers tout ce qui pouvait à la fois m'expliquer le monde dans lequel je devais vivre, et me donner l'espoir de me bâtir autrement que ce à quoi j'étais destinée. Echapper au déterminisme, cela avait à voir avec le refus de la violence de la discipline.
ca donnait un drôle de mélange dans ma tête, qui aurait pu m'acculer à confusion, si je navais pas quelques solides garde-fous. Et d'abord, la conviction que toutes les théories, toutes les opinions, tous les soubresauts intellectuels se fracassaient contre la réalité. Aucune des théories si intelligentes du dix-neuvième siècle n'avait réussi à façonner le monde autant que la volonté d'un capitalisme triomphant - ça n'était pas les stériles terrils, (qu'on finirait bien par prendre pour des témoins religieux tels des pyramides), qui allaient me contredire. Pour remonter moins loin, pendant que je m'approchais, fascinée et démunie, du monde magique des idées, le moindre programmateur informatique préparait mon avenir - et j'ai moi-même participé, lors de petits boulots à la DDE où il s'agisait de comptabiliser le trafic routier, à l'encombrement du monde sensible auquel j'appartenais : il fallait doter la terre d'infrastructures routières aussi pratiques qu'arides - contre-vivantes : la palme, dans le genre, revenait sans doute aux parkings de supermarché.
Cette prise de conscience, cette révolte, a toujours sous-tendu mes prises de position. J'étais à la fois persuadée que seul l'individualisme issu de l'humanisme était supportable, en l'état, mais que cette indivudualisme me rendait paradoxalement si dépendante d'un univers collectif mortifère que c'en était pitié. J'ai écrit il y a quelque temps que Kukas avait eu une sacrée prescience, en assignant à l'homme du futur - foetus intergalactique - du film 2001 l'odyssée de l'Espace, un destin lié à un "monolithe noir" qui ressemble furieusement à un de nos portables. Nous ne le savions pas encore, mais tous nos soubresauts politiques ne faisaient pas le poids, devant la marche inexorable de ce que d'aucuns appelaient "progrès", et qui ressemblaient au fourmillement mortifère d'une termitière détruisant son propre écosystème.
Quoi qu'il en soit, si je relativisais les théories libertaires qui me séduisaient tant (et d'autant plus que, restées inexpérimentées, elles n'avaient pas eu le temps de prouver ou d'infirmer leurs vertus), je n'en conservais pas moins "mes trois A" : l'anarchie, l'altérité, l'altruisme.
L'altérité était sans doute la cheville ouvrière qui pouvait relier le féminisme à l'anarchie : contrairement aux fascisme d'extrême-droite, auquel il est parfois associé, le mouvement libertaire garde toujours, précieusement, le sentiment de l'existence et de la dignité de l'"autre". Ce qui sous-tend également, dans une perspective humaniste et universaliste parfaitement illustrée par un Condorcet, les combats féministes...
(la suite à plus tard...)
Espoirs et convictions
- Par clopine
- Le 30/01/2017
- Commentaires (0)
(je me refuse à relire mon billet "je voulais écrire...", car je n'aurais certes ni la patience ni le masochisme pour continuer, si je commençais à chipoter avec moi-même. Poursuivons, puisqu'il n'est pas nécessaire de réussir pour perséverer.)
Je crois que j'ai été fort injuste en attribuant mon "désengagement" de la Fédé Anarchiste à mes seules convictions (montantes) féministes.
IL y fallait sans doute une vaillance que je n'avais pas, ou plus.
Oh, ce n'était pas de me lever à cinq heures du matin pour aller coller des affiches sur des murs où, à cause du gel, il était impossible de coller quoi que ce soit (ç ane tenait pas). Ni de me retrouver par des petits matins brumeux à la porte de telle ou telle usine, pour une distribution de tracts sitôt jetés que pris. Ou encore de délaisser les délices de la littérature pour les âpretés des obscures brochures politiques. Non, ce n'était rien de cela qui me posait problème.
C'est que je manquais de conviction. Les camarades anarchistes avaient entre eux un certain nombre de points communs, parfaitement repérés et décrits par Léo Ferré (surtout). Je partageais certains de ces traits, mais, outre que j'étais fille (et je suis persuadée qu'il n'y en a toujours pas beaucoup, chez les libertaires), j'étais différente. En ce sens qu'à 20 ans, je savais qu'il me serait toujours possible de gagner ma vie.
Pour mes camarades, par contre, ce serait toujours plus compliqué. Ma révolte innée contre tout ce qui peut ressembler à une violence disciplinaire n'était rien, comparée à leur révolte à eux, bien plus étendue, essentielle et soutenue par un orgueil (fort différent des vanités que j'ai pu, par la suite, recontrer trop souvent, hélas) qui leur tenait lieu de colonne vertébrale. Certes, leurs analyses politiques leur permettaient de comprendre de quoi étaient faits les rouages qui les emprisonnaient, eux qui étaient tous "fils de rien ou de si peu", qui, pour une raison ou une autre, n'avaient pu obtenir la résilience nécessaire pour "profiter du système", notamment éducatif. L'idéalisme des anars est sans borne. Leurs moyens, ridicules. Leurs passions, dévorantes. Et leur capacité à mettre de l'eau dans leur vin, nulle.
Avec ça, instantanément pris pour des fous dangereux, point à la façon des religieux radicaux dont nous avait fait récemment la si plaisante rencontre, mais pas trop éloignés non plus. Ce qui d'ailleurs était encore un attrait enivrant pour certains d'entre eux : le "romantisme "ruuse, le côté voyou d'une Bande à Bader, un radicalisme qui leur permettrait enfin de vivre (même de manière abrégée) au rythme de leurs tripes - voilà ce qui, au-delà de la simple raison issue des lectures et de la connaissance de l'histoire, les convainquait.
Et ce dont j'étais le plus loin possible. A cause, bien entendu, de ma naïveté fondamentale. Songez que je croyais presque, en ces belles années, qu'il nous suffirait de secouer le joug sexiste de la société pour accéder à une société enfin humanisée. Je croyais vraiment qu'il n'était pas question de réformisme en matière de féminisme, par exemple. Qu'on ne pourrait commencer à changer de paradigme qu'en transformant l'être humain.
Or, si le combat féministe était parfaitement légitime (et l'imparfait, ici, commande le soupir, car plus que jamais le féminisme doit s'exprimer partout), il n'arrivait pas cependant à transformer le monde - et surtout pas le monde capitaliste, qui avait une capacité d'absorption voisine de celle du python s'étirant à craquer pour avaler un mouton.
Rien ne semblait suffisant, d'ailleurs, pour le faire éclater, celui-là.
Si ce n'est, peut-être, l'écologie.
Nous y venons.
J'avais quitté la fédé anarchiste avec quelques convictions écologistes dans ma besace : d'abord concernant le nucléaire, bien sûr, qui ne pouvait s'apparenter qu'au Minotaure, monstre emmuré parce que fils apocalyptique d'une société étatique et d'un capitalisme énergétivore, ensuite la protection du monde sensible (je préfère ce terme à celui d'"environnement", qui fleure bon les ministères), ce dernier incluant évidemment la cause animale, ensuite par réaction contre les différentes objurgations du monde de la consommation.
J'avais partagé avec enthousiasme les combats féministes de l'époque - mais ils me semblaient avoir atteint certains de leurs buts, et avoir été récupérés d'un autre côté. E tpuis, pour tout avouer, plus j'allais, moins mon sentiment d'être l'égale de n'importe quel individu mâle n'était remis en question. Au contraire : les seuls mecs qui m'intéressaient étaient précisément ceux pour qui cette égalité "allait de soi".
Bien sûr, c'est le genre d'évidence dont on peut se méfier, car l'inconscient veille, et le mec le plus ingénument "féministe" peut avoir un inconscient bourré, lui, de préjugés. M'enfin, je devais bien reconnaître que ma qualité de femme ne m'empêchait nullement de rencontrer des compagnons qui ne se sentaient certes pas supérieurs, du fait de la possession de leurs divins attributs, à ma personne.
Et les écolos encore moins que les autres...
(suite à plus tard)
Je voulais écrire un texte sur le féminisme et l'écologie.
- Par clopine
- Le 27/01/2017
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Je voulais écrire un texte sur l’écologie et le féminisme. Mais à peine avais-je tapé ces deux mots sur mon azerty que, (là, au choix, une métaphore :
- Telle une viennoiserie dans de l’earl grey,
- Tel le ballet récurrent et nostalgique des feuilles mortes venant recouvrir le sol de l’automne,
- Telles les bulles qui remontent à la surface quand vous pétez dans le bain, au risque de passer pour une grosse feignasse qui y passe des plombes.
Suivant vos goûts et votre personnalité, vous pouvez choisir l’une des options…), un souvenir s’est imposé, et je me suis retrouvée dans un garage non chauffé d’une rue montueuse, à Rouen, dans les années 70-80, assise sur une chaise bancale autour d’une planche posée sur des tréteaux, sous la lumière faible et clignotante d’une unique ampoule : dans le local de la fédération anarchiste locale, quoi (les connaisseurs auront reconnu, mais ce seront bien les seuls, car nous étions 6 ou 8 seulement).
"Eh bien, pourquoi n'écrirais-tu pas un article sur les rapports entre l'anarchie et le féminisme ?"
Je ne me souviens plus ni du nom, ni du son de la voix qui me posait la question. Mais je me revois l’entendre, incrédule et impressionnée.
C'étaient des années où les discussions politiques avaient lieu partout, tout le temps, et pendant des heures interminables. J'y participais parce que j'avais reçu, au lycée, de la part d'un prof trotskyste, une formation politique qui avait débouché, chez moi, sur la conviction qu'aucune dictature du prolétariat ne pourrait changer l'humanité. Seule l'anarchie, avec sa revendication fondamentale d'égalité, ses aspirations à un monde économique fondé sur l'autogestion et son rêve de fédéralisme fractal (c'est-à-dire reflété et répété de la cellule familiale à ce qui allait remplacer l'Etat) m'avait persuadée de "m'engager".
Et puis, confusément, je sentais déjà que j’étais « à part ». Il me semblait ressentir, par exemple, bien plus fortement qu’autrui, la violence de la discipline. Je n’acceptais que celle que je m’imposais, mais ne pouvais m’empêcher de renifler, (et re :
- comme une bête sauvage le fait avant de s’élancer hors de son abri
- comme le SDF pas persuadé du tout de sortir intact de l’hébergement nocturne prévu par les autorités
- comme l’humaniste au moment d’ouvrir le dernier Houellebecq)
les autres. Encore maintenant, j’ai toujours un sursaut devant les règlements intérieurs, par exemple. Même (et surtout ?) ceux que Clopin édicte au gré de ses préoccupations quotidiennes, comme la fermeture des portes des placards et des portes, l’entretien du congélateur ou l’interdiction de marcher dans le potager, bref.
Ce sursaut, légitime ou non, est sans doute une des causes de mon indissolubilité dans le collectif. Et même le groupuscule anar dont je parle aujourd’hui a été encore « trop » pour moi. Mais n’anticipons pas.
Très vite, je suis devenue la meilleure vendeuse du Monde Libertaire, surtout le samedi après-midi rue du Gros-Horloge : c'est-à-dire l'endroit de Rouen où, compte tenu de l'affluence, on pouvait vendre à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Surtout quand on était une fille de 20 ans et qu'on possédait une voix conséquente, pour appeler le chaland !
Je le vendais, bien, mais je n'arrivais pas souvent à le lire en entier, ce canard libertaire : les articles (la majorité d'entre eux signés Maurice Joyeux, ce nom étant à mes yeux le signe que j'étais bien au bon endroit pour l'avenir) étaient touffus, hérissés de convictions, curieux mélanges d'anathèmes, de lyrisme sur fond de démonstrations et d'allusions historiques dont je ne possédais pas les clés ; je préférais de loin les revues mensuelles de "La Rue", qui étaient dévolues chaque mois à un thème, et qui, beaucoup plus pédagogiques, m'étaient du coup plus abordables.
N'empêche qu'être sollicitée pour écrire un article qui, potentiellement, pourrait peut-être paraître dans Le Monde Libertaire, c'était très très très intimidant.
J'avais déjà, à 20 ans, l'habitude d'être seule fille au milieu de mecs. Sans doute mon enfance, passée avec deux frères très peu distants de moi par l'âge (cela se comptait presque en mois pour le plus proche !), m'avait donné l'aisance nécessaire, le manque d'appréhension et l'habitude d'une certaine confrontation, que d'autres filles ne possédaient pas.
En tout cas, c'est une caractéristique de ma vie -encore maintenant : je suis très souvent seule fille au milieu de garçons, sans l'avoir jamais délibéré. Il a donc bien fallu que je m'y fasse.
Mais j'étais néanmoins fille - et nous étions fort peu nombreuses, à la fédé anar. C'est donc à cause, très certainement, d'une "discrimination positive" qu'on m'avait proposé ainsi de m'exprimer sur le sujet.
J'en fus incapable.
Oh, ce n'était pas d'écrire qui me tourmentait : les mots me connaissaient déjà. Mais le projet d'article que je rendis, quinze jours plus tard, fut un échec retentissant.
"Bien", dit le leader après avoir lu mes quatre petites feuilles, écrites largement. "Tu as parfaitement résumé les thèses féministes. Mais par contre, l'anarchie là-dedans, e tle rapport entre les deux, je ne le vois pas - du tout."
Je fus bien entendu mortifiée - mais j'acceptais la sentence. J'avais été incapable de trouver la moindre documentation (et internet n'existait pas, je le rappelle tout de même...) sur ce thème. Et ni les écrits sur Makno ou la CNT, ni les thèses phalanstériennes de Fourier, même critiquées par Proudhon, ne pouvaient guère me sauver. Voyons, imaginer un monde où, comme par magie, la sexualité s'arrangerait à merveille, sans violence et dans une égalité harmonieuse, (par exemple, l'amateur de sexe sur fond de souliers féminins trouvant une partenaire aimant précisément regarder un homme boire du champagne dans sa godasse - tous les deux "prenant leur pied" ainsi, wouarf...) m'était absolument impossible.
Nous étions dans les années où les réflexions féministes aboutissaient à la nécessité, non seulement d'un combat contre le machisme ambiant, mais encore d'une prise de conscience des mécanismes fondamentaux de l'objectivation de l'autre - et les quelques malheureux textes que j'avais pu parcourir pour mon article n'avaient effectivement rien "d'anarchistes", et tout de "féministes".
De toute façon, l'ambiguïté du combat féministe - après tout, n'était-il pas mené en priorité par des avocates, des intellectuelles, des bourgeoises, ce qui indiquait qu'il pouvait fort bien se limiter à du réformisme, à l'application de revendications égalitaristes, sans changer radicalement la nature humaine (et pourquoi être anar à 20 ans, si ce n'est pour changer radicalement l'être humain, bon dieu de merde ?) ne m'apparaissait pas encore clairement.
C'était la même ambiguïté qui entourait les combats pour l'homosexualité, d'ailleurs. Le paradoxe qui consistait à en arriver à revendiquer avec eux le droit au mariage (alors que, pour un libertaire, le mariage n'est ni plus ni moins qu'une sorte de contrat relevant d'une société étatisée, et pour une féministe, une déclinaison légalisée de la prostitution) ne me gênait pas trop, certes : je disais "d'abord, luttons pour qu'on arrête de leur casser la gueule. Après, nous verrons..."
Mais j'avais conscience aussi que je ne pouvais interroger franchement mes braves camarades libertaires en développant ces "points d'achoppement" - qui étaient pourtant les seuls intéressants dans l'histoire. Il faut dire qu'à l'époque, les militants anarchistes, mâles dans leur immense majorité, étaient aussi des "machos" de première. J'invite tous ceux qui ne me croient pas à écouter attentivement Léo Ferré - où à prêter l'oreille à l'une de ses premières phrases, sur cette vidéo . ("Ruteboeuf avait des problèmes d'argent et de femmes, ce qui est souvent la même chose", ben voyons.)
Je fus incapable, malgré les encouragements, d'étoffer mon article par la partie qui "manquait".
Mais cet échec, et aussi le fait d'entendre des réflexions, de la part de mes potes anars de l'époque, fleurant bon l’homophobie primaire firent que je quittai, quelques mois plus tard, la Fédé. J’entrai du même coup dans la nébuleuse féministe : les groupes femmes, le café « Adèle Blanc-Sec » du quartier Saint-Nicaise, les manifs et les discussions m’occupèrent longtemps…
Avant d’être interdite (comme par hasard) d’entrée dans un groupe femmes auquel je souhaitais adhérer. (encore une autre histoire !)
Mais ces différents échecs de mon engagement « militant » ne m’empêchaient pas, même s’ils étaient particulièrement durs à vivre, de m’emparer des thèses et des convictions qui m’étaient présentées.
Et c’est bien par le mouvement libertaire que je fus conduite à l’écologie : précisément dans un des numéros de cette revue mensuelle « la Rue », consacré à ce thème, et qui présentait la plupart des thèses écolos.
Il y avait d’ailleurs comme un lien ontologique entre l’écologie et l’anarchie : le refus de la société étatisée nécessaire à l’avènement du nucléaire. Certes, les écolos pouvaient « trimballer », plus que de raison, des contradictions et des errements qui n’allaient pas leur servir – encore moins quand il fut décidé qu’ils sortiraient de la sphère uniquement associative et qu’ils entameraient un combat politique, ce qui était et est toujours, à mon sens, largement hors de leur portée.
Mais les fondamentaux étaient là, et je les adoptais aussitôt.
N’allez pas croire que j’oublie, en vous racontant tout ça, mon sujet premier, à savoir l’écologie et le féminisme. Mais en retournant vers ce passé, il me semble aujourd’hui que le décalage (encore et toujours, soupir !) qui existe entre mon milieu désormais très fortement écolo et moi, provient de ces prémisses : à savoir que j’ai soutenu les thèses écologistes fondamentales par le biais de textes issus des cercles libertaires, que j’ai rencontré ces textes au moment où j’allais quitter ce milieu libertaire pour intégrer le mouvement féministe de l’époque, et qu’il y a donc eu, dès le départ, comme deux « registres » bien différenciés dans ma pensée : un plan où il s’agissait de penser des rapports économiques et sociaux radicalement différents, sous peine de naufrage environnemental, et un autre où il s’agissait de faire l’apprentissage de la libération de la femme, comme on disait à l’époque – mais en remisant pour de bon le moindre robot Moulinex, évidemment.
Je n'ai pris conscience ces différences avec ceux qui m'entourent désormais que lentement - et encore aujourd'hui, je pense qu'il ne serait pas négatif que j'éclaircisse, autant que je le peux, cet écheveau qui s'est noué, pour moi, dès mes vingt ans...
(la suite à plus tard).
L'ombre de la main de Léonard
- Par clopine
- Le 23/01/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
VU sur Arte l'enquête "picturale" sur un tableau attribué (avec quelques éléments sérieux de vraisemblance) à Léonard de Vinci :

Comme d'habitude, le souci de monter le documentaire en "enquête policière" conduit à quelques "tics" assez énervants : la répétition, à intervalles réguliers, des mêmes phrases( "il faut désormais que l'acheteur apporte la preuve irréfutable" "l'expert doit désormais prouver", etc. Mais il semble qu'aucune émission ne puisse, désormais, à l'instar de la publicité, faire l'économie de la répétition : soupir.) , la recherche de "suspens", avec passage tout aussi obligé sur le "plagiaire" qui va "montrer comment les faussaires font" (mais qui n'en est pas un, hein, soyons clairs ! Wouarf....) , et surtout l'enjeu : une toile achetée 22 mille euros qui se retrouve "trésor inestimable" (expression dite à plusieurs reprises) mais dont on nous donne cependant l'estimation (des millions de dollars).
Bon, je reconnais que le tableau est beau, la recherche fascinante : vérifier la datation du velin, reconstituer la technique de peinture, expliquer pourquoi le tableau ne fut jamais accroché ni même mentionné, retrouver le modèle et son histoire, comprendre que le tableau était en fait une page d'un livre retrouvé en Pologne, faire coïncider l'identité du modèle, sa place à la cour des Sforza, la prèsence du peintre sous l'autorité de son commaditaire, père naturel de la princesse, déterminer que le tableau a été peint par un gaucher et retrouver les trous de la reliure, correspondant exactement à la feuille découpée, dérobée du livre 'd'origine : quelle jolie histoire, n'est-ce pas ?
Le dernier mot du documentaire souligne ce qui, aux yeux du réalisateur, est donc le plus important : la valeur monétaire de la toile -dernière offre refusée : 80 millions de dollars. On sent le frisson qui parcourt l'échine...
Mais pour moi, c'est autre chose que le "prix" de l'oeuvre qui m'a fait frissonner : une experte s'extasie sur le dessin de la jeune fille - la dimension de son nez démonre qu'elle est à ce stade intermédiaire entre l'enfant et l'adulte, par exemple, et un faussaire même génial aurait-il pu, comme Vinci, saisir à ce point la vérité du modèle ?
Oui, une femme-enfant est donc représentée là... J'écoute : c'est une fille illégitime de Sforza, une jeune "Bianca" de treize ans. Et le portrait a été effectué pour son mariage...
Son mariage.
Sûrment rien à redire, au quinzième-seizième siècle, au mariage d'une fille de treize ans...
Et une autre phrase, comme ça, au détour d'un plan :
"morte trois mois après ce mariage, vraisemblablement des suites d'une grossesse".
D'un seul coup, les millions de dollars, la "chance" du connaisseur finaud qui a acheté l'oeuvre, le lent travail des experts, la mobilisation autour du portrait, la richesse de la tenue de la princesse, la beauté des cadeaux reçus pour son mariage, dont ce "livre" enluminé et s'ouvrant par son portrait, tout ce luxe, passé et présent, tout ce monde de l'art et de l'argent, tout pâlit à mes yeux...
Chef d'oeuvre de Léonard de Vinci en majesté... Tous ceux qui regardent ton portrait ne voient que lui, que Vinci, le Maître. C'est pour lui qu'on s'extasie, pas pour toi, petite fille mariée et morte trois mois après, car forcée bien trop jeune, comme j'ai vu, parfois, chez les chattes : l'une d'elles, qui n'avait pas fini de grandir, et prise trop tôt, mourant sous un ventre ballonné qui excédait ses forces...
Je n'arriverai pas, sous les "bravos" des spectateurs, les sourires gourmands des connaisseurs et les billets de banque volentant autour de la Trouvaille, à oublier ton sort : et derrière ton fin profil, c'est la brutalité et le machisme de ton temps qui pèsent sur l'ombre de la main de Léonard, dessinant ton front, ton menton, et la belle natte tressée qui pend sur ton dos, droit comme celui d'une écolière, menu comme celui d'un enfant, Léonrad dessinant ce qui fut une "Belle Princesse", à jamais sacrifiée.
Saturday morning fever
- Par clopine
- Le 21/01/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Pour des raisons - dont vous ne saurez rien, je dois derechef, après des moments d'inactivité qui se sont étalés sur quelques années, consacrer 35 heures hebdomadaires à un travail salarié, morne et alimentaire, alors même que je sens tous les jours l'usure de mon corps - et que je dois désormais passer au contrôle technique, comme les voitures, à intervalles réguliers. Ceci n'est pas sans rapport avec mon humeur morose, causée également, cette humeur, par le désastre du monde qui m'entoure, certes. Mais si j'avais 20 ans, je supporterais sans doute mieux l'évolution catastrophique de mes contemporains.
En tout cas, mes contraintes professionnelles ont ceci de bon que je retrouve le goût du samedi matin, que j'avais quelque peu perdu.
Il faut travailler toute la semaine pour bien apprécier le samedi matin. Le réveil tardif, la conscience bienheureuse que non, on n'a pas à se lever, le tapotage de l'oreiller avant d'y replacer la tête de trois quarts, et l'épiage, par la fenêtre de la chambre, de la lumière du soleil qui monte... C'est encore meilleur quand il fait très froid dehors, et qu'un chat vient rontonner dans vos bras, histoire de vous raconter le plaisir qu'il a à vous voir...
Du coup, je retrouve mes vieilles marques, et notamment les moments solitaires, une fois descendue dans la cuisine, où je fais chauffer de l'eau, m'occupe vaguement de petites corvées ménagères, prépare la théière, me verse de l'earl Grey, vais dehors me rafraîchir en déposant de la margarine dans la mangeoire aux oiseaux, traîne le rocking chair dans la cuisine, face à la fenêtre, pour pouvoir mater les passereaux qui viennent s'y nourrir, et ouvre France CUl. (Clopin, lui, le matin, ne supporte pas le bruit de la radio. C'est donc un plaisir solitaire et donc, dirait Marcel Proust, impie et coupable, que de m'adonner à l'écoute de Répliques, d'Alain Finkielkraut - que j'honnis par ailleurs, bien entendu.)
Ce matin, pendant que les passereaux s'en donnaient à coeur joie, le plaisir était précisément là, car l'invité était Hector Obalk, dont je suis "friande", dirais-je. IL y a six ou sept ans, j'avais même plagié Brassens en me décernant le titre de "la fan d'Hector". Cela faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendu (depuis qu'on ne le voit plus à la télé sur Arte, en fait), et c'était un vrai plaisir d'entendre sa voix - qui ressemble pour moi au pépiage de ces jolis oiseaux qui viennent, légers et graciles, se nourrir à mes frais.
Si je me sens en "intimité" intellectuelle avec Obalk, outre le fait qu'il m'apprend tant de choses que j'ignore car c'est un authentique érudit, c'est à cause, je crois, de l'arrière-plan jubilatoire qui l'entoure. Pour son dernier ouvrage sur la Sixtine, il est monté sur un échafaudage, du type de celui que Michel-Ange a emprunté. Finkielkraut était encore ému de l'exploit (pensez ! Monter sur un échafaudage ! ) et je reconnaissais tellement "mon" Obalk dans l'anecdote que je m'en balançais un peu plus vite dans mon rocking-chair -au risque d'effrayer,, au-dehors, les mésanges charbonnières, toujours nerveuses quand elles sont trop proches de la maison.
Ca me faisait tellement de bien, l'enthousiasme juvénile, volubile et jubilatoire d'Obalk, en ce triste surlendemain d'investiture américaine du Roi des Cons, que mon humble cuisine devenait pavée de toutes les couleurs de la Renaissance. Certes, les hypothèses iconoclastes d'Obalk sur Michel-Ange doivent être sujettes à caution, dans les cercles 'autorisés". Moi, je m'accorde à les trouver originales, surprenantes et surtout éclairantes.
Ainsi, pour lui, l'illustrissime scène où Dieu, sur son nuage, effleure sans les toucher les doigts d'Adam : scène donnée comme "clé" de l'Humanisme de la Renaissance, homme et dieu sur le même plan, se regardant en miroir et si semblables qu'on devine tout de suite, comme dans un mythe grec, que le fils va bien finir par zigouiller son papa.
Obalk la voit tout autrement, cette scène si célèbre qu'on ne la regarde plus que détournée vingt mille fois par la publicité : notre vision moderne nous empêcherait de percevoir la perspective voulue par Michel-Ange, la scène devant se lire comme un énorme dieu, très loin, que des yeux du 16è siècle percevaient parfaitement comme relevant d'un effet d'optique perdu pour nos regards contemporains...
J'adore ça, ce genre d'hyptohèses, quand c'est Obalk qui les développe. Parce que ce type est d'une ingéniosité qui repose sur une sorte d'humilité sincère, dans laquelle je me reconnais. Pas le genre à affirmer une théorie un peu aventureuse, à l'asséner, puis à se retirer dans le silence, Obalk. Non : il commence par s'excuser, presque, d'avoir de telles idées, semble cligner un peu de l'oeil, et puis, avec le même plaisir que le prestidigateur sort un joli lapin de son chapeau, vous donne, un peu pataud, le résultat de ses cogitations.
Ca m'a fait beaucoup de bien, parce que je suis un peu frustrée en ce moments, à cause de débats littéraires commencés ailleurs, et qui ont tourné court. Du coup; entendre un type de la stature du critique d'art avoir une telle modestie dans une hypothèse qui, sous ses airs fantaisistes, doit puiser ses racines dans une érudition réelle (je suis sûre que son bouquin sur la Sixtine doit être particulèrement dense !), c'est comme partager -enfin- sur un pied d'égalité, une jolie conversation...
Et c'est donc fort plaisant, pour une fan d'Hector !!!
Pour Marcel, aller chez Patrice...
- Par clopine
- Le 18/01/2017
- Commentaires (0)
Finalement, le débat sur l'éventuelle masturbation du narrateur pendant la scène du baiser du soir de la Recherche du Temps Perdu se déroulera chez Patrice Louis, authentique Fou de Proust : http://lefoudeproust.fr/
Une Polémique Marcel (différente, donc, de la Polémique Victor !)
- Par clopine
- Le 18/01/2017
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
ais
Alors voilà : je fréquente un blog dédié à Marcel Proust, plus précisément à la Recherche du Temps Perdu, blog qui est sous-titré "voyages extraordinaires dans la Recherche" et qui est tenu par un certain "fou de Proust".
Une sorte de discussion s'y est engagée entre un internaute "Jean Adloff" et moi-même, à propos... de deux adjectifs employés par Proust dans une des plus célèbres scènes du premier tome de la Recherche : "du côté de chez Swann", dans la partie "Combray".
Je me rends bien compte, allez...
Un débat pour deux adjectifs... Et où je m'engage, moi qui n'ai aucun titre pour ce faire, alors que des litres et des litres et des litres d'encres universitaires ont été répandues et n'ont même pas encore eu le temps de sécher, qu'on élucubre là autour depuis des lustres, et que, s'il y a UN livre qui ouvre légitimement à toutes sortes d'interprétations, c'est bien la Recherche.
Alors, pourquoi ne pas admettre bien tranquillement l'opinion de Jean Adloff, et vouloir "batailler" (avec le sourire quand même, hein !) là autour ? Je me mets en danger, avant tout d'être renvoyée dans mes foyers pour cause d'impertinence et d'illégitimité, et après tout pour un résultat couru d'avance : Jean Adloff est particulièrement convaincu d'avoir raison, et il semble qu'il ne soit pas le seul de son opinion, sur ces deux fameux adjectifs.
D'autant que la lecture induit cette liberté d'interprétation, puisque chaque lecteur introduit dans le texte qu'il aborde une part de lui-même...
C'est peut-être justement cela. De la même manière qu'un Onfray chaud bouillant, s'appuyant sur "le livre noir de la psychanalyse", entreprend de déboulonner la statue de Freud, de la même manière j'ai envie de défendre "ma" lecture de Proust, fondée sur le respect du texte littéral et et quelques considérations sociologiques générales, notamment sur les clichés entourant la question de l'homosexualité.
Si le débat pouvait s'ouvrir, j'en serais enchantée...
En attendant, voici les deux adjectifs incriminés : "impie" et "secret",
et voilà le passage en question. Un des plus célèbres, à juste titre, dans la richesse psychologique du tout est superbe :
"Maman resta cette nuit-là dans ma chambre et, comme pour ne gâter d’aucun remords ces heures si différentes de ce que j’avais eu le droit d’espérer, quand Françoise, comprenant qu’il se passait quelque chose d’extraordinaire en voyant maman assise près de moi, qui me tenait la main et me laissait pleurer sans me gronder, lui demanda : « Mais Madame, qu’a donc Monsieur à pleurer ainsi ? » maman lui répondit : « Mais il ne sait pas lui-même, Françoise, il est énervé ; préparez-moi vite le grand lit et montez vous coucher. » Ainsi, pour la première fois, ma tristesse n’était plus considérée comme une faute punissable mais comme un mal involontaire qu’on venait de reconnaître officiellement, comme un état nerveux dont je n’étais pas responsable ; j’avais le soulagement de n’avoir plus à mêler de scrupules à l’amertume de mes larmes, je pouvais pleurer sans péché. Je n’étais pas non plus médiocrement fier vis-à-vis de Françoise de ce retour des choses humaines, qui, une heure après que maman avait refusé de monter dans ma chambre et m’avait fait dédaigneusement répondre que je devrais dormir, m’élevait à la dignité de grande personne et m’avait fait atteindre tout d’un coup à une sorte de puberté du chagrin, d’émancipation des larmes. J’aurais dû être heureux : je ne l’étais pas. Il me semblait que ma mère venait de me faire une première concession qui devait lui être douloureuse, que c’était une première abdication de sa part devant l’idéal qu’elle avait conçu pour moi, et que pour la première fois, elle, si courageuse, s’avouait vaincue. Il me semblait que si je venais de remporter une victoire c’était contre elle, que j’avais réussi comme auraient pu faire la maladie, des chagrins, ou l’âge, à détendre sa volonté, à faire fléchir sa raison et que cette soirée commençait une ère, resterait comme une triste date. Si j’avais osé maintenant, j’aurais dit à maman : « Non je ne veux pas, ne couche pas ici. » Mais je connaissais la sagesse pratique, réaliste comme on dirait aujourd’hui, qui tempérait en elle la nature ardemment idéaliste de ma grand’mère, et je savais que, maintenant que le mal était fait, elle aimerait mieux m’en laisser du moins goûter le plaisir calmant et ne pas déranger mon père. Certes, le beau visage de ma mère brillait encore de jeunesse ce soir-là où elle me tenait si doucement les mains et cherchait à arrêter mes larmes ; mais justement il me semblait que cela n’aurait pas dû être, sa colère eût été moins triste pour moi que cette douceur nouvelle que n’avait pas connue mon enfance ; il me semblait que je venais d’une main impie et secrète de tracer dans son âme une première ride et d’y faire apparaître un premier cheveu blanc. Cette pensée redoubla mes sanglots et alors je vis maman, qui jamais ne se laissait aller à aucun attendrissement avec moi, être tout d’un coup gagnée par le mien et essayer de retenir une envie de pleurer. Comme elle sentit que je m’en étais aperçu, elle me dit en riant : « Voilà mon petit jaunet, mon petit serin, qui va rendre sa maman aussi bêtasse que lui, pour peu que cela continue. Voyons, puisque tu n’as pas sommeil ni ta maman non plus, ne restons pas à nous énerver, faisons quelque chose, prenons un de tes livres. »
Bon, voilà, nous y sommes.
Alors, thèse de Jean Adloff. Le "geste de la main impie et secrète" serait une masturbation du jeune Narrateur, masturbation qui serait un secret si lourd à porter qu'il en expliquerait toute la Recherche, construite à partir de ce geste "primitif" (comme la "scène primitive" de Freud, qui prétend que chaque enfant assiste aux ébats sexuels de ses parents et éprouve du même coup le complexe d'Oedipe, désir sexuel de la mère et envie de meurtre du père).
Ma thèse : le "geste de la main impie et secrète" serait une métaphore non d'un acte masturbatoire commis pendant la scène racontée, mais simplement du chagrin que l'enfant, dans sa victoire à la Pyrrhus, cause à sa mère, elle-même prise dans un conflit de loyauté.
Les arguments pour ma thèse sont les suivants :
(suite à plus tard).
Toute petite anecdote, mais néamoins ouvrant sur des considérations pleines d'enseignement (au moins pour bibi)
- Par clopine
- Le 15/01/2017
- Commentaires (1)
La ligne SNCF Rouen-Amiens a, comme si souvent dans nos vies, deux aspects bien différents : il y circule des TGV rapides, confortables et pressés, qui vous relient les deux grandes villes provinciales en un rien de temps et sans presque s'arrêter entre les deux gares, sinon à Serqueux, ancien "noeud" ferroviaire et situé à mi-parcours. Et puis il y a les tortillards, qui s'arrêtent partout, sont bruyants, point trop propres, secouent leurs voyageurs comme des vêtements dans le tambour d'une machine à laver, et dont les passagers ont le visage tiré et les pensées rentrées des gens qui doivent gagner leur vie, en la perdant.
Ceux-qui-savent font parfaitement la différence entre les deux, et ne montent jamais "dans le premier train venu". Mais les autres...
Ce jour-là, j'avais pris le tortillard, puisque je n'allais pas à Amiens, mais rentrais à Beaubec. Par contre, la famille montée dans le train avec moi partait, à l'évidence, pour Amiens. Et c'était leur méconnaissance de la ligne qui leur avait fait choisir le mauvais train. Mais bon : ils allaient cependant y arriver, pour sûr.
Je les ai vus tout de suite, tant ils différaient des voyageurs habituels, et tant surtout ils semblaient fatigués. Le père, qui dirigeait les manoeuvres entre les bagages et l'installation des autres, la mère, traits tirés au cordeau et bouche amère, le jeune fils, trop sage et qui gardait les yeux baissés, et une adorable petite fille de trois ans et demi environ, aux yeux immenses et grands ouverts, sautillante, légère comme un oiseau et parée d'une noire chevelure soyeuse et bouclée : un miracle de légèreté. La seule qui ne semblait pas épuisée, et entreprit de tout visiter dans le wagon.
J'avais tout de suite eu envie d'entrer en contact avec eux, mais comment faire ? Ils venaient visiblement de si loin, d'un de ces pays d'où le sang dégoutte sans que, dans les images quotidiennes vues à la télévision, nous n'en ressention la réalité, ni le goût, ni l'odeur. Ils ne parlaient pas français. Le père commandait, certes, mais il s'adressait à la femme avec respect, et sans brusquerie. Je me demandais quels âges ils avaient, l'un et l'autre. Pas plus de trente-cinq ans, aurais-je dit, en soustrayant mentalement leur extrême fatigue, la fragilité de leurs gestes, la précaution avec laquelle ils se serraient les uns les autres, et la neutralité de leurs habits. Ils pouvaient être syriens, ou afghans, ou irakiens, ou... : ils étaient simplement une famille de réfugiés, et ils étaient ensemble - il fallait donc les considérer comme ayant eu beaucoup de chance.
J'essayais, en vain, de deviner la langue qu'ils parlaient, quand le père sortit d'un sac une sorte de radio-cassette, qu'il installa sur ses genoux : il le mit en marche, et là, dans ce wagon laborieux et traînard, entre Monterolier et Buchy, se déversa soudain, le son mis quasiment au maximum, la prière musulmane psalmodiée par une voix de muezzin.
Personne dans le wagon ne pouvait y échapper.
J'en ai sursauté d'étonnement, et de déplaisir : moi qui ai déjà du mal à entendre les banales conversations échangées par portable (mais de plus en plus souvent, les voyageurs se déplacent sur des plates-formes dédiées aux communications), comme si l'intimité d'autrui m'était imposée par intrusion , voilà que j'allais devoir supporter la prière ? J'ai tenté de raisonner. Voyons, si au lieu d'étrangers, il s'agissait d'une de nos bonnes soeurs bien de chez nous mettant Radio Vatican à fond la caisse, qu'est-ce que je ferais ? N'irais-je pas instantanément, poliment mais fermement, lui demander de baisser d'un ton ? Oui, mais pouvait-on extraire de ce contexte l'épuisement de cette famille, la recherche de réconfort moral que devait signifier pour eux ce déluge de surâtes, et leur ignorance absolue des règles de laïcité qui régissent le territoire français, jusque dans ce lieu ô combien public qu'est un wagon SNCF ? Et puis, la religion... La merveilleuse petite fille de trois ans et demie, qu'allait-on lui imposer, au nom de la religion, "bon dieu de bon dieu de merde", même ici, même en France ?
J'étais salement emmerdée, de cette nouvelle sorte d'emmerdements qui n'existaient pas dans ma jeunesse et que la folie de notre monde me mettait sous le nez. Je n'étais, je ne suis, que bienveillance vis-à-vis d'autrui, qu'envie d'accueil de tous ceux qui ont besoin d'un refuge, et que reconnaissance vis-à-vis de Cédric Herrou, qui sauve notre honneur collectif.
Mais de là à supporter le muezzin entre Buchy et Serqueux...
J'en étais là de mes perplexités ô combien modernes, quand le Sauveur est arrivé. Oui, oui, le Sauveur. En complet-veston gris-bleu, avec casquette à lisière dorée, et pince à composter à la main. J'ai nommé le contrôleur SNCF.
J'ai suivi attentivement la "conversation", bargouinée dans un pseudo-anglais avec force gestes des mains : avec une politesse absolue, le contrôleur a expliqué à la famille que la discrétion était de mise, dans le wagon. Il a été jusqu'à montrer au père une paire d'écouteurs, pour lui faire comprendre d'où venait le problème... Le père a donc éteint son appareil, et tous les deux, la mère et lui, ont serré la main du fonctionnaire.
Car c'était un fonctionnaire, ce sont des fonctionnaires que les contrôleurs SNCF ; oh, je sais que pour une partie de mes compatriotes, ce sont là des dinosaures dont il faut accélérer l'extinction, des preneurs d'otage , les exemples même de ce qui empêche notre glorieux pays de prospérer, de dangereux agitateurs toujours en grève pour des revendications exhorbitantes qui relèvent du privilège, bref, des nuisibles.
N'empêche que je l'aurais bien embrassé, moi, le contrôleur...
A méditer, non ?
Vues du coq...
- Par clopine
- Le 11/01/2017
- Commentaires (1)
Ah ! Les belles porteuses d'oeufs !

On comprend que les coqs en soient fous :

Et ici, ce sont des aquarelles : poules d'eau, en quelque sorte

Le mangifique peintre de ces magnifiques poules s'appelle ENDRE PENDOVAC ; cot cot à lui !!!
La sérénité de la sénilité
- Par clopine
- Le 10/01/2017
- Commentaires (0)
Je me souviens d'un cours de philo de terminale. Le prof, "Papa Hue" (vieux cheval de labour, déiste, bavard et rougeaud comme une marchande), nous avait fait passer "un test", façon journal féminin. Pauvre vieux bonhomme : il comptait ainsi jouer sur nos egos adolescents pour éviter de faire remarquer qu'il ne faisait plus cours (du tout... Mai 68 était passé par là...) , et passait son temps à nous raconter sa vie, encombrée des problématiques du remembrement rural : pensez, sa femme avait des terres... C'était du souci...
Il nous avait demandé d'associer un adjectif à chacun des trente noms communs d'une liste. Puis s'était emparé de nos feuilles (nous n'étions que 12 élèves, dans ma classe de terminale, cela autorisait de pareilles manipulations, impossibles dans une classe à plus fort effectif), et les avait commentées. Comme de bien entendu, c'étaient mes résultats qui avaient le plus attiré son attention, au motif "qu'ils étaient différents de ce qu'on aurait pu attendre" (ben tiens, le contraire m'eût étonnée) : "Serein !", s'était-il écrié, en me regardant longuement. "A "Vieillard", vous avez associé "Serein" !!! Vous en connaissez donc beaucoup, Mademoiselle, des "vieillards sereins" ?"
J'avais failli répondre qu'effectivement, ce n'était pas lui, Papa Hue, qui aurait ainsi pu m'aiguiller dans ce choix : il était toujours excité comme une puce. Mais inconsciemment, je l'associais pourtant au vieillard dont il était question.
Bon sang, il devait à l'époque avoir soixante ans au plus. Avec la cruauté de mon âge, je rassemblais en une seule catégorie vieillesse, extrême vieillesse et sénilité : c'était tout un...
Aujourd'hui, je suis plus vieille que Papa Hue, et je comprends mieux sa réaction : rares sont les vieillards (et sans doute les vieillardes) sereins. Rarissimes, même. Car il en faut, du calme et du courage, pour vivre sereinement ce qui, à plus ou moins fort étiage, est le début du "naufrage" gaullien : la déchéance.
Je n'ai pas encore bien avancé dans ce chemin-là, que déjà je me révolte et me débats : encore une promesse trahie, en quelque sorte. Ce n'est PAS parce que vous serez "raisonnable", que vous régirez votre vie suivant les préceptes de la salubrité, de la sobriété, du calme et de la vertu physique, que vous pourrez remonter le temps, retrouver l'élastique et l'élan de la jeunesse ; tout juste se maintient-on, et encore.
Et c'est bien dans la seule sénilité que la sérénité doit trouver place, en fait...
38,5 degrés de critique littéraire (suite)
- Par clopine
- Le 06/01/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Allongée dans le lit maternel, la maison enfin vide autour de moi et les genoux relevés portant tous les livres que je voulais, je bénéficiais apparemment du calme préconisé immuablement par le médecin : mais ce calme concret dissimulait une telle intensité d'émotion et de pensées, au fur et à mesure que je tournais les pages, qu'une seule héroïne littéraire peut rendre compte de ce tumulte : la petite Jane Eyre, derrière son rideau. Une frangine, sans aucun doute.
Tout m'était bon, certes, mais déjà je trouvais plus de matière dans Victor Hugo que dans Enyd Blyton. Moi aussi, comme la soeur d'Alice, je commençais à préférer les livres "où il n'y avait pas d'images" et parfois, quand les passages trop difficiles (mais il y en avait de moins en moins) me faisaient obstacle, je ne cherchais pas d'explications à l'extérieur, mais reprenais mon élan, reculais d'une page ou deux, et arrivais généralement, contexte aidant, à emporter l'explication.
Je pense que c'est vers 8 ou 9 ans qu'à l'occasion d'une grippe, j'ai commencé sérieusement à vouloir savoir "comment c'était fait". Comment de simples mots pouvaient aboutir à de tels ravages, de tels emportements : pourquoi n'étais-je déjà plus libre de suspendre ma lecture, s'il s'agissait de savoir si Claude Gueux allait mourir, la petite Fadette être aimée de Landry ou Raskolnikov être démasqué. Plus tard, ma rage de lecture me fit craindre d'être atteinte de bovarysme - mais je savais déjà trier, laisser tomber les stupidités type Guy des Cars.
Je crois que c'était la fièvre qui m'aidait à opérer ce tri, ce classement, cet embryon de "critique littéraire". La fièvre est une formidable alliée pour affiner son goût et son analyse (même si, découvrant avec ravissement la grammaire à l'école, je compris très tôt que savoir agencer des briques n'a rien à voir avec la beauté d'un mur, sinon, bien entendu, que cet agencement est l'art même de le faire tenir debout), parce qu'elle correspond, chez le lecteur, à la poussée créatrice de l'écrivain.
La limite était très claire : 38,5 °; Au-delà, la chambre commençait à tourner, mes yeux se brouillaient, ma tête retombait sur l'oreiller : je ne pouvais plus lire. Mais mes plus belles appréhensions de ce qu'était un texte se situaient juste un peu en-deça. Je dirais que 38,3 ° est une excellente température pour comprendre comment Hugo, après un long passage explicatif, concentre son propos en une phrase balancée entre paradoxe, oxymore et brillante formule : adjectif plus image contre oxymore plus image, par exemple.
Les textes hors de ma portée étaient ceux écrits sous une fièvre plus intense encore. Il me fallut même être adulte, et apprendre ce qu'était l'ivresse alcoolique pour pouvoir "situer" des textes comme ceux de Joyce, ou certains Céline. Mais enfin, Hugo, Dickens ou Balzac étaient déjà passablement enfiévrés comme ça !
Toute empirique, naïve et peu crédible que puisse paraître cette méthode de "critique littéraire," elle m'est toujours cependant apparue fiable, enfin, plus fiable que ce que j'ai eu le loisir de découvrir ici ou là. Je me souviens ainsi d'un "exercice", appelons ça comme ça, d'un de ces structuralistes (je ne me souviens plus de son nom, mais disons qu'il avait fleuri dans le parterre semé par Barthes) des années 70/80. Il s'agissait du Rouge et Noir, et l'auteur avançait sans trembler que le livre avait été écrit par Stendhal suivant les mêmes règles qu'un jeu de cartes. A preuve, les quatres Dames étaient distribuées. Evidemment, les Dames de coeur et de pique étaient respectivement Madame de Rênal et Mathilde de la Mole , mais la belle Amanda était la reine de trèfle, et Madame de Fervaques, de carreau. Le tout argumenté, bien voyons. C'était drôle, intelligent, bien construit... et totalement absurde. Qui pourrait sérieusement croire que le Rouge et le Nor a été élaboré mentalement par un Stendhal pendant qu'il jouait à la belote ?
(par contre, le soupçon que l'essai structuraliste en question ait été écrit par un étudiant venant de passer une soirée arrosée à jouer au tarot est lui, beaucoup plus fondé, à mon sens...)
Quand on sait ce que le structuralisme a causé de dégâts à l'enseignement du français, on peut avoir de l'indulgence pour la méthode parfaitement empirique avec laquelle j'ai bricolé mes propres critiques littéraires. Et l'on peut me comprendre, je pense : déchiffrer un livre en étant soignée, (c'est-à-dire ce qui ressemble le plus à être aimée), n'est-ce pas la condition sine qua non pour comprendre le pouvoir de la littérature sur l'âme humaine ? D'autant que, notamment ici, je mesure et restreins bien évidemment ce pouvoir aux limites thermographiques des fièvres d'une fillette pourvue d'un rhume carabiné...
(et hier, j'ai atteint 38,6°).
38,5 degrés de critique littéraire
- Par clopine
- Le 06/01/2017
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Je crois bien que ce sont les maladies que j'ai préférées, dans mon enfance. Je crains que les enfants uniques, régnant sans partage sur l'attention que leur mère peut leur porter, ne puissent me comprendre. Mais pour moi, dans ma famille nombreuse, être malade était une bénédiction. En tout cas, moi qui étais une fillette des plus pleurnicheuses, "jamais contente" et de l'avis de tous une source de problèmes, j'étais une petite malade aussi idéale (sans la fin tragique) qu'un petit prince d'Oscar Wilde.
D'abord, je n'allais pas à l'école. Mais ce mot "école" ne rend pas compte du soulagement que j'éprouvais, et peut tromper ; car ce n'était pas "l"école" qui étati un problème : dès mon arrivée dans la classe, je me sentais généralement bien, occupée, intéressée. Ce qui me chagrinait d'ordinaire, et à quoi je coupais quand je restais à la maison, c'était la crainte d'être soit en retard, soit en avance ; c'était le "sas" entre la maison et l'école qui me préoccupait chaque jour. Si j'étais malade, eh bien, la question ne se posait plus.
De plus, ma mère, qui n'était ni câline ni encline à donner aux enfants de trop bons sentiments d'eux-mêmes (mais elle compensait ce trait de caractère par une loyauté et une vaillance jamais démentie), baissait un peu la garde, en cas de maladie. Elle promettait des récompenses, en échange du courage à supporter l'épreuve de l'absorption des médicaments. Et puis, quand on était malade, on était ainsi seul avec elle, pendant l'absence scolaire des autres enfants. Je crois bien, ma parole, que je me serais incoulée moi-même l'angine ou la rougeole, pour obtenir ce fabuleux résultat.
D'autant que, malade, j'avais le droit d'être dans la chambre et le lit parental, pendant la journée. Ca, c'était le mieux. Le lit m'apparaissait aussi vaste que l'océan, et si la fièvre me faisait chavirer, l'illusion était alors parfaite.
Quant aux douleurs des maladies enfantines, eh bien, j'ai eu la chance d'être enfant quand les médecins, dits "de famille", se déplaçaient encore chez leurs patients. Quel qu'ait été l'état de ma gorge, il me suffisait d'entendre le pas lent et pesant du médecin grimpant l'escalier du perron pour commencer à moins souffrir. Car si ce pas était souvent fatigué, il était aussi déterminé et bienveillant. Je me rends compte, avec la distance, que le médecin était aussi le seul homme adulte de mon entourage qui prenait le soin de m'interroger, d'écouter mes réponses. J'adorais sa venue, j'adorais tout le petit cérémonial des visites, la cuiller à soupe que ma mère allait chercher dans le tiroir de la cuisine pour que le docteur m'ausculte la gorge, la discussion dans le couloir entre le médecin et ma mère, l'oracle qui tombait : "elle en a pour quatre jours... ", jusqu'aux paroles redondantes qui tombaient à chaque visite : "mais cette petite est bien trop nerveuse, le calme lui fera du bien".
Je pense aujourd'hui que ces visites à domicile avaient, outre la vertu de simplifier la vie d'une femme comme ma mère, accablée d'enfants et sans moyens de transport, l'avantage de permettre au médecin d'entrer dans la vie même de ses patients. De voir l'intérieur des maisons, d'estimer non seulement l'évolution des angines mais aussi le degré de fatigue des mères et le niveau du ménage, de jeter mine de rien un coup d'oeil à la cuisine ou de poser la main sur les radiateurs, histoire de voir si le chauffage marchait, de suivre les évolutions, aussi. Je me souviens de discussions entre ma mère et le médecin sur la télévision (une des premières de tout le quartier), et de l'usage que l'on en faisait.. .
Peut-être que les médecins généralistes d'aujourd'hui, qui passent les quinze premières minutes de la consultation l'oeil rivé sur l'écran de l'ordinateur, à vérifier votre dissier tout en vous écoutant sans plus même regarder votre visage, sont plus renseignés ainsi que leurs confrères d'antan sur l'état réel de leur patient. Mais j'en doute.
Il n'y a pas eu une seule maladie de mon enfance qui n'ait été pour moi la source d'un contentement suprême : pouvoir lire jusqu'à plus soif. Je ne peux décrire le plaisir que je ressentais, accoudée aux oreillers du grand lit, les genoux relevés, la porte entrouv'erte sur le couloir et les allées et venues de ma mère dans la maison perceptibles et rassurantes, le chat en boule au bord du lit, et le livre grand ouvert. Ma parole : je crois bien que je pouvais lire toute la journée sans en être fatiguée, au contraire...
Et tout enfant, c'est également pendant ces périodes de maladie et d'intense lecture, très tôt donc, qu'une des questions qui allaient, par la suite et sans prétention de ma part, se poser constamment dans ma vie, a pour la première fois surgi : à savoir "Comment c'était fait ? Comment cela fonctionnait-il ?"
(la suite à demain)
L'art des Cris...
- Par clopine
- Le 31/12/2016
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Si je m 'accorde une qualité, c'est bien celle de lectrice : mais cela ne signifie rien, hélas, sur l'art d"écrire : car mes lectures faisaient partie d'un temps qui n'est plus celui d'aujourd'hui, et ce qu'utilisaient les écrivains n'est plus "valable" (quel vilain mot), tel le ticket du métro, pardon, du RER, au-delà d'une certaine limite.
l'art décrit, l'art d 'écrit, l'art des cris dornavant , est, à mon sens, de plus plus en difficile à utiliser, si le but que l'on recherche est celui de décrire ce moinde, et sa propre posture;
Et ce, parce que la littérature avait toujours fait bon ménage avec la nature, dans une relation disons "essentielle", et que ce n'est plus le cas : le petit Marcel embrassant en pleurant ses aubépines était tout entier issu d'un temps littéraire où les émotions humaines étaient peintes avec le matériau du monde sensible.
En un mot, il suffisait de parler du rouge-gorge sautillant sur l'appui de la fenêtre et nourri par une jeune fille blonde aux cheveux tressés pour faire naître, tour à tour, l'amour mélancolique pour les jeunes recluses, le coeur bondissant sous l'ennui quotidien, et le feu sous la glace si cher aux blondes hitckockiennes et à Catherine Deneuve.
Je sais parfaitement (et les jeunes gens, nos grands fils et leurs compagnes, qui hantent désormais Beaubec, aussi rapides, vifs et intermittents que les hirondelles revenues nicher sous la grange tous les printemps, m'en persuadent un peu plus à chacun de leurs haltes passagères) que la "nature", le "monde sensible", le registre des pierres, des plantes, de l'eau, du feu, de l'animal aussi, les éléments quoi, (de moins en moins "premiers") ne sont plus "pertinents" pour exprimer ce que mes jeunes contemporains vivent, et comment ils perçoivent le monde qu'ils partagent et qui les nourrit.
IL faudrait avoir vingt ans, peut-être, et bien du talent sans doute, pour comprendre et retraduire ces nouvelles (et pour moi, mystérieuses) manières d'être au monde : arriver , en décrivant comment un pouce glisse sur la matière transparente, dure et monolithique d'un écran tactile, arriver à faire sentir l'effroi d'un appel amoureux, ou au contraire la désinvolture d'un égoïsme, ou l'angoisse d'un désarroi sans nom : mais je suis bien trop vieille pour comprendre et partager cela.
Oh, ma génération a bien pressenti les choses, pourtant : le parallélépipède noir et glacé de "2001, l'odyssée de l'espace" préfigurait assez bien, à mon sens, ce qui nous arrive. Et c'est un défi formidable qui attend aujourd'hui celui qui voudrait se servir des mots pour parler de soi et des autres : par exemple, la tentation d'un suicide pourrait, devrait sans doute, être illustrée par une panne de téléphone portable, allez savoir...
J'éprouve donc une ormidable incapacité à sentir le monde actuel comme descriptible, saisissable, à portée de mots. Mais c'est cette incapacité même qui m'aide à vivre aux champs, alors que c'est une existence dure et solitaire...
Car ici, (et contrairement, donc, j'insiste, à ce que vivent l'immense majorité de mes contemporains, de plus en plus éloignés du monde sensible et donc de moins en moins aptes à en profiter pour l'humaniser de mots l'usage de la métaphore comme médium entre le sentiment éprouvé et le monde réel est aussi aisé, apaisant, évident que le geste de boire un verre d'eau pour étancher sa soif.
(etsi je connais un peu mieux maintenant le vocabulaire de la ruralité - alors que nos jeunes gens sont bien incapables de distinguer un rouge-gorge d'un chardonneret, par exemple, je ne sais pas même simplement nommer la moitié des objets qu'ils manipulent tous les jours, d'un autre côté).
Le givre, qui s'est installé deuis hier, un peu partout, après un vilain brouillard dense, en est un parfait exemple. La conscience du mouvement de toute chose est d'habitude comme cachée, imperceptible. Mais la gaine étincelante, de ce blanc inflexible du froid, qui enveloppe chaque objet "du dehors" produit le même effet qu'un cliché pris sur le vif : les branches comme entravées par leur élan, et ployant sous le poids de glace, révèlent chaque arbre à lui-même : comment ne pas se servir de ce qui est fourni, ici, à portée de regard, pour exhaler le sentiment si humain, en ce 31 décembre, de nostalgie du temps qui passe et d'appréhension de l'avenir ?
Nous sommes tous (et j'entends ici les occidentaux), aussi "révélés" par notre époque que la géométrie et le mouvement des choses sensibles le sont par le givre. Et sans doute n'est-ce pas un hasard si ce mot sert, en qualificatif, pour la désignation d'une sorte de folie.

défête
- Par clopine
- Le 26/12/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Tojours le coeur gros pendant cette période. L'impression habituelle d'être en demande de reconnaissance, avivée par les efforts de sociabilité à faire , et si jamais l'on oublie de me dire "merci", je me sens inévitablement réduite au pentagone table-frigo-évier-four-machine à laver la vaisselle - c'est bien évidemment paradoxal, car je ne suis obligée à rien, ce que l'on me fait parfois savoir avec un ton disons acerbe.
Je ne peux pas m'empêcher à la fois de donner raison à l'argument -puisqu'effectivement, je ne suis obligée à rien, (et surtout pas à être là n'est-ce pas), et en même temps de me dire que le "merci" serait peu de chose, et qu'il pourrait même venir de coeur, allez savoir...
c'est la dépression des fêtes : une sorte de période où je pourrais, je m'en rends compte avec effroi, entamer moi aussi le dialogue de la femme rompue...
Mais je ne suis pas, ne veux pas être rompue. S'il le faut, je plierais aussi bien que le roseau ; ce n'est pas le vent qui manque.
No, No, No (elle)...
- Par clopine
- Le 24/12/2016
- Commentaires (0)
Alors, ce soir, petit réveillon intime. De toute façon, je ne sais pas si j'aurais pu en supporter plus, parce que, franchement :
- ce matin, chez l'ineffable Finkielkraut, on m'apprend que certes, Trump n'a jamais ouvert un bouquin de sa vie, certes, il est grossier, inculte, et aux antipodes d'Obama, mais justement : c'est bien la faute de ce dernier finalement ce vote Trump, puisque qu'Obama, lui, quand on lui posait une question, analysait le thème abordé, donnait les avis des différentes parties concernées, bref "sophistiquait", ce dont le bon peuple avait marre . Trump, lui, est un "pragmatique", et donc il ne faut surtout pas le dénigrer mais "le juger sur ses actes". J'ai arrêté l'émission là, parce que j'avais légèrement la nausée - étant moi-même, sans aucun doute et malgré mon faible niveau d'instruction, bien trop sophistiquée pour approuver qu'on vote pour un gros con, pragmatique ou non. Bref.
- j'ai donc été faire un tour chez le non moins ineffable Assouline. Le commentarium, fêtes obligent, était ce matin un désert, seulement occupé par les deux insensés de service : JC, dont je ne lis plus depuis longtemps les débilissimes messages, jouant à saute-com' avec eux, et WGG qui, comme d'hab'; s'énerve tout seul et sort des trucs genre "En plus, les prétendus « Palestiniens » n’existent pas. Ce qui existe, ce sont des Arabes qui viennent d’ailleurs occuper un territoire où ils n’avaient aucune légitimité à s’implanter. Les occupants ce sont les Arabes sur une terre juive depuis 3000 ans !", ce qui nous met bien tout de suite dans l'ambiance du "paix sur la terre aux hommes de bonne volonté", je trouve, pour un matin de noël.
- et puis je me suis rendue compte que, moi qui aime d'habitude les enfants, qui ai envie d'être grand'mère pour repiquer au truc du nounoutage avec bisous partout, eh bien la période de l'avant-noël me les rend tous antipathiques. Tous, enfin tous ceux compris entre trois et douze ans. La petite fille qui, hier, pendant que j'achetais des bougies, tripotait tous les rayons à sa portée en chantonnant "j'ai des kinders à la maison", et qui, s'approchant sournoisement de sa grand'mère occupée à payer, se mettait à crier, hystérique "tu as vu Mamie, tu as vu la Reine des Neiges" ... Et la grand'mère qui soupirait "mais j'ai ce qu'il faut à la maison" (je crois que Disney va se faire des couilles pesant tellement leurs poids en or avec cette Reine des Neiges que Mickey ne pourra plus marcher, gêné qu'il sera à l'entrejambe ...), et d'un coup j'ai vu tous ces mômes jouant à l'enfant sage, avec leurs yeux pleins de convoitise et leurs mains avides, tous s'approchant près de moi façon zombies dans massacre à la tronçonneuse que j'ai oublié qu'ils sont avant tout nos victimes :
comment peut -on aimer les gosses, à Noël ?
Un monde bâclé
- Par clopine
- Le 22/12/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Bien entendu, le pire est qu'on s'y habitue. Non, le terme "habitude" n'est pas le bon : disons que l'usure émousse notre empathie - ma première pensée, après Berlin, n'a pas volé vers les victimes, mais a été "à qui le tour maintenant ?", tant nous avons finalement accepté que la question ne soit plus "pourquoi ?" mais "où et quand ?".
Après Charlie, je n'avais pas eu de "première pensée" : juste une horreur qui m'avait prise à la gorge, bien enfoncée, et dont j'ai goûté si journellement l'acidité qu'elle est désormais incorporée à la texture de ma vie quotidienne.
L'impression, aussi, d'avoir à transmettre un monde bâclé. Je suis d'une génération utopiste, secouant gaiement les interdits d'antan, qui était prête à aller danser sur des décombres de mondes anciens . Et voici tout ce que ma génération a su transmettre : uen planète à la dérive, une fin de civilisation rougeoyante, et toutes les idées que je combattais devenues prépondérantes.
La nature, avec son immoralisme et ses lois fondamentales, ne bâcle pas, elle. Comment, pourquoi l'être humain se sent-il affranchi de ces contraintes-là, qui sont sa vie même ? Eh bien, la nature se fout particulièrement de cette derières question, et de nos pitoyables tentatives de réponse.
Et cette absence d'intérêt est peut-être la seule chose réconfortante à laquelle se raccrocher : au moins, cette indifférence est l'inverse de la damnation (que nous avons pourtant si abondamment méritée).
Darwinette de noël...
- Par clopine
- Le 20/12/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Qu'est-ce qui évolue (un peu) dans les dessins animés proposés à la télé pendant la période de Noël ? Les techniques d'animation, bien sûr, toujours plus ébouriffantes, le rythme de l'histoire, car l'explicite cède la place à un implicite qui permet d'aller vite, et... La vision de la femme chez Disney.
Ben oui, j'ai regardé la Reine des Neiges hier au soir, et j'étais assez contente, même si pas totalement, de quelques avancées darwiniennes dans la description de(s) héroïne(s).
D'abord, et merci qui ?, il semble qu'on ait enfin échappé au ménage obligé comme illustration des vertus féminines. Cendrillon et Blanche-Neige ont cessé d'être à genoux à passer la wassingue, ce qui est ma foi une bonne chose. Anna, elle, commande son cheval, grimpe dessus et s'en va fièrement à l'aventure retrouver sa soeur, en laissant la morne intendance du royaume à son fiancé.
Ensuite, les princes charmants ne sont plus ce qu'ils étaient (re-ouf), et surtout les héroïnes ont le droit de se planter, et de ne pas commencer par le bon. Symboliquement, ça en met un sacré coup au mythe de la virginité cette histoire, si le prince charmant du début n'est plus le même que celui de la fin...
Enfin, les princesses ont désormais le droit d'avoir des parcours initiatiques aussi exaltants que leurs frères. Je m'explique : avant, la princesse devait en chier notablement pour y arriver, toujours dans la douleur (se faire battre par des orties la nuit, devoir nettoyer l'auge aux cochons avec une peau de bête, se faire dévorer par le loup, etc.) : fallait que t'en chies un max, quoi.
Ici, la douleur est toujours présente (la reine est infoutue d'avoir uen copine) mais elle est compensée par l'attribution de pouvoirs magiques somptueux. Ahahah. Le destin ne passerait donc plus par l'acceptation de la soumission, mais on pourrait préférer une solitude créatrice, voire, attendez attendez attendez, la jouissance du POUVOIR ?
Bon, évidemment, ce n'est pas aussi simple. Arrivée à peine possession de ses pouvoirs, voici notre reine qui se transforme en une sorte de pétasse sexy qui ondule vers le spectateur, ce qui pourrait être à la limite intéressant si c'était moins stéréotypé dans le genre représentation de la sexualité féminine, soupir, mais de toute façon, la scène est brutalement interrompue par une porte qui claque en se refermant.
y'a encore du boulot...
M'enfin je trouve que les petites filles ont quand même à portée de la main uen représentation d'elles-mêmes bien plus riche que celle auquelle ma génération a eu droit. Elles n'attendent plus le Prince qui, un jour viendra. Elles sont, même si elles en chient pour ça, "libérées, délivrées"....
(par contre, nous, on en prend pour "la Reine des Neiges" pour quelques années. Avant, c'était "Les Choristes"... c'est quand même dingue, le mauvais goût musical qui semble nécessaire pour les films pour enfants...)
Petite histoire de Noël...
- Par clopine
- Le 18/12/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
NOEL 197…
Michel C. était le garçon le plus recherché du lycée. A cela, deux raisons : ses cheveux longs, épais, bouclés, qui dansaient sur ses épaules au moindre mouvement et encadraient une tête d’’ange aussi blond que celui de la flagellation du Christ de Fra Angelico, et sa chambre en ville, luxe inouï qui n’était pourtant dû qu’aux exclusions successives des internats de ses précédents établissements. Il passait en effet son temps à faire tourner la tête des filles : il était charmant. Un jour, il avait embrassé par derrière la prof de maths dans le cou : il l’avait confondue avec une de ses copines.
Il avait tant de succès qu’il était charmant avec moi aussi, qui n’était pourtant qu’une terne camarade de classe : et ce fut ainsi que cela arriva.
Il s’agissait de la fête de Noël du lycée. Il y tiendrait un rôle de tout premier plan, car il avait été sollicité par la prof de français pour jouer des scènes d’une pièce de Ionesco, « Rhinocéros » : il était fabuleux, et je l’écoutais avec tant d’attention que, prenant soudain conscience qu’il me racontait tout cela à moi, qui n’avait évidemment aucune chance d’être sollicitée pour quoi que ce soit, il me proposa, sous le coup de la pitié et de l’inspiration, de participer également au spectacle.
Evidemment, il n’y avait plus de place pour la pièce de théâtre : tous les rôles avaient été distribués. Mais peut-être pourrais-je intervenir avant, en lever de rideau en quelque sorte ? Voyons, je devais bien avoir un talent caché : n’y avait-il rien que je sache faire, vraiment ?
Si, répondis-je. Je connaissais un poème par cœur.
Un poème ? Oui, cela pourrait peut-être faire l’affaire, il allait en parler à la prof (qui, visiblement, ne savait rien lui refuser). Et de quel poème s’agissait-il ?
Je pris une profonde inspiration, le regardai droit dans les yeux : « Il n’y a plus rien », de Léo Ferré.
Rien que ça.
Léo Ferré a dû en effet écrire le plus touffu et surtout le plus long poème de sa carrière pour déclarer « qu’il n’y avait plus rien ». Non seulement le nombre de mots pour le dire est considérable, mais encore le tout, sur fond de Rejet Absolu et Défintif de la Société, est panaché d’anathèmes, de déclarations emphatiques, et d’amères considérations sur l’Ingratitude Humaine.
Cela correspondait tout-à-fait à la jeune fille de 17 ans que j’étais, bien entendu.
Mais mémoriser ce monstrueux texte était un exploit en soi, et je savais que je pouvais le faire : j’avais le temps nécessaire pour cela, n’est-ce pas, et pouvais y consacrer toutes mes soirées…
Et c’est ainsi que par un soir de décembre de l’année 197…, l’élève la plus mal dans sa peau (car si certaines jeunes filles étaient en fleurs, j’étais plutôt en boutons…) , la plus encombrée d’elle-même, la plus mal fagotée de tout l’établissement (je portais un chandail avachi, dans les tons roux, boutonné sur le devant et aux antipodes des modes « indiennes » de ce temps-là) se présenta debout, seule sur scène, devant tout ce que le lycée comptait de personnes influentes, assises en rangs serrés.
Le proviseur et les professeurs les plus importants, bien sûr. Mais aussi les représentants des associations de parents d’élèves (comme ma propre mère, qui était la Présidente de l’association catholique et de droite), les grands élèves de Terminale, qui occupaient les premiers rangs, et enfin la piétaille lycéenne.
Oh ! Patti Smith peut bien décrire combien elle a tremblé, devant le jury suédois du prix Nobel de littérature ! Elle peut bien, la main sur le cœur, raconter comment elle s’est emmêlée dans sa chanson (elle devait, pour célébrer Bob Dylan le récipiendaire même pas foutu de venir chercher un prix immérité, chanter « It’s a hard rain ») : « Unaccustomed to such an overwhelming case of nerves, I was unable to continue. I hadn’t forgotten the words that were now a part of me. I was simply unable to draw them out. This strange phenomenon did not diminish or pass but stayed cruelly with me.”
Elle ne m’arrive en réalité pas à la cheville ! Car, arrivée au trois quart du poème (et cela devait faire environ vingt bonnes minutes que j’étais ainsi livrée aux lions), moi aussi j’ai eu, non un banal trou de mémoire, mais un « case of nerves », dû à la brusque conscience du silence absolu qui entourait ma voix imprécative : tous m’écoutaient, et c’était à la fois si inattendu et si impressionnant que j’ai flanché, j’ai reculé, et me suis précipitée dans les coulisses.
Où Michel C., déjà grimé pour la suite du spectacle (et je ne le reconnus pas, car il était affublé d’une fausse barbe), me demanda d’une voix émue si j’avais fini, et, apprenant que non, me prit carrément par la main pour me rapporter, comme une mère chienne transporte son chiot dans la gueule, sur le devant de la scène.
Le silence avait continué ! Tous attendaient ! J’ai donc fermé les yeux, repris le poème là où je l’avais laissé …
J’ai encore dans l’oreille le tonnerre d’applaudissements qui a accueilli le dernier vers : « Nous aurons tout… Dans dix mille ans ! »
Mais moi, n’est-ce pas, je n’ai pas eu besoin d’attendre dix mille ans pour « tout avoir ». Car le soir même, quand la soirée s’acheva, que les chaises furent rangées le long du mur, les élèves à l’internat et le proviseur dans son appartement de fonction, Michel C . m’a raccompagnée à la maison, et là, dans le jardin, sous les froides étoiles de décembre qui brillaient moins que l’unique projecteur du lycée, j'ai reçu un long baiser.
Vanités...
- Par clopine
- Le 18/12/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Grands dieux ! Que les pattes du paon sont vilaines !!!
La Fille de la Pochette
- Par clopine
- Le 12/12/2016
- Commentaires (2)
- Dans Mes textes
Bon. Dylan a tellement plein de pognon qu'il s'en fout d'aller chercher son Nobel, s'asseyant du même coup (car le prix n'est remis qu'en présence du lauréat) sur plus de 800 000 euros. Ou bien il exècre tellement l'usage du monde que les prix, pour lui, c'est comme un morpion pour le vulgum pecus : ça le gratte et il a décidé de s'en passer le plus possible. Ou encore il est tellement étonné qu'on puisse lui attribuer, à lui le barde, un nobel de "Littérature", qu'il boude dans son coin.
Vous aurez compris que je ne suis pas vraiment d'accord avec cette attribution, qui ridiculise surtout le jury suédois, à mon sens. M'enfin si le but était de faire le buzz, bon là c'est réussi...
Mais ce qui m’énerve moi, c’est qu’on ne peut remettre en cause ce Nobel sans être soupçonné d’appartenir aux « détracteurs de Dylan ».
Alors qu’on peut aimer Dylan, pousser « Hard Rain » sous la douche (sic) tant qu’on peut (à parité avec Carmen, autre grand classique de salle de bains, d’autant que l’on peut transformer les couinements que vous arrache le shampooing dans l’oeil en imitation de Julia Migenes), avoir écouté la biographie de François Bon et visionné celle de Scorcese, connaître précisément la date où Dylan a trahi (passant du folk à l’électrique, comme Higelin abandonnant Areski et Fontaine), et ne PAS apprécier qu’on lui ait refilé un Nobel « de littérature ».
Et c'est quelqu'un qui a longtemps longtemps longtemps, c’est-à-dire entre treize ans et demi et quatorze ans et huit mois, rêvé d'être une "Fille de la Pochette" (celle de « Freewheelin », avec le combi Volkswagen à gauche, toute une époque), qui vous le dit.

Soupir.
Evoquer Condorcet...
- Par clopine
- Le 10/12/2016
- Commentaires (0)
Impeccable Caroline Fourest chez Finkielkraut, ce matin, sur le thème "laïcité et tolérance", rappelant qu'un Ferdinand Buisson (c'était le nom de mon école primaire...) avait lu Condorcet...
Perso, je n'arrive pas à résoudre le paradoxe de la burqa ; je veux dire que c'est au nom de la liberté individuelle qu'on défend le port de ce vêtement, qui est un manifeste en faveur de l'absence de liberté individuelle. Toute religion est, à mon sens, fondée précisément sur la négation de l'individu libre. On va me répondre "communauté" : mais une communauté n'est digne de ce nom que si on peut la choisir, et la quitter. Ce qui ne semble pas le cas de l'islamisme radical !
A part ça, baguenaudant dans les prés fleuris de la société de consommation, je cherchais un cadeau pour Clopinou et sa nouvelle et étonnante compagne. J'ai trouvé la série, sur Arte, des "grands mythes" de Busnel : comme je ne suis pas du tout sûre qu'à l'école, on ait raconté ces fabuleuses histoires à mes jeunes gens, j'ai commencé à visionner la série. Ca me rafraîchissait la mémoire, d'une part, et je tentais de savoir si c'était à la fois plaisant et pédagogique, et enrichissant. Enfin,"enrichissant", ça j'en suis sûre, car connaître la mythologie grecque, c'est connaître les rêves dont nous sommes directement issus.
Bon la série est parfaite en ce sens, avec une simplicité de bon goût je trouve, et du coup, je l'ai carrément désirée pour bibi, avant de tenter de la faire partager à la jeunesse - ni une ni deux, Clopin m'en a fait cadeau...
J'ai donc retrouvé avec plaisir ce que j'avais découvert à l'adolescence : le mythe d'Antigone, la famille des Atrides (chaude ambiance), celle des Labdacides (acides est le mot, z'ont tous l'air shooté là-dedans, bonjour les meurtres, incestes, parricides, fratricides, tout icides), Bellérophon et.. Oedipe.
Et là !
Je suis tombée de l'armoire.
Parce que j'ai un souvenir extrêmemet précis de ma rencontre avec la mythologie grecque. C'est mon prof de français de troisième qui m'avait donné un livre récapitulant les différentes histoires, et nous en avions parlé ensemble.
Je mere vois encore lui demandant pourquoi Oedipe était maudit comme ça. Bonjour la liberté individuelle, tout de même ! Voilà un type qui fait tout pour échapper à un destin, hélas inexorable...
Et j'entends encore la voix de mon prof tentant de m'expliquer le rapport entre les dieux et les hommes, chez les Grecs : la vie entière d'Oedipe est une énigme pour lui, parce qu'il refuse d'admettre la prédestination. Bien, bien. A l'époque, je m'étais contentée de cette explication...
Et puis là, grâce à Busnel, qu'apprends-je ? Qu'il y a bien un motif derrière le destin tragique d'Oedipe. En fait, si la lignée entière est maudite, (parce que les enfants-frères et soeurs- d'Oedipe n'auront pas trop l'occasion de réussir leur vie, on va dire ça comme ça), c'est à cause de l'ancêtre Laïos. Une faute originelle. Oui, oui, comme de croquer la pomme...
Laïos n'a pas croqué la pomme, lui. Il a juste violé un jeune garçon, Chrisippe, qui du coup, s'est donné la mort...
j'ai dû attendre 61 ans pour apprendre ça ! J'ai pourtant lu les tragédies de Sophocle et d'Euripide, Oedipe à Colonne etc., les adaptations de Giraudoux ou de Sartre, j'ai suivi les élucubrations freudiennes là autour, et jamais personne ne m'avait raconté que toute la famille était en galère parce que Papa était un violeur pédophile...
Alors on pourrait estimer que mon prof de l'époque n'avait peut-être pas trop envie de raconter à la môme que j'étais de pareilles perversités. Dans les années 70, on n'effarouchait pas les jeunes filles avec des histoires "de pédéraste".
sauf que ça ne gênait absolument pas mon prof de me raconter l'histoire d'un type qui couche avec sa mère...
passons.
Mais tout cela conforte mon opinion : point de liberté individuelle dans l'esprit religieux, même si, comme chez les grecs, les Dieux ressemblent fichtrement aux hommes avec lesquels ils jouent...
Initiales B.B.
- Par clopine
- Le 07/12/2016
- Commentaires (0)
Lu dans Télérama l'annonce d'une pièce de théâtre : la Balasko dans Beauvoir. Ca va nous changer des "initiales B.B." de d'habitude, parce que ces deux-là, vingt dioux ! N'ont pas l'habitude de faire dans la sucrée et encore moins dans la robe Vichy (encore que, si l'on en croit cette peste d'Onfray, le couple Sartre-Beauvoir, bien loin du gauchisme qui leur est attribué, étaient des purs petits-bourgeois un tantinet collabos pendant la guerre, m'enfin, bref.)
Bon, Balasko dans Beauvoir, alors, en voiture Simone ?
Un truc m'interpelle, cependant : l'article parle du "monologue" de "la femme rompue". Or, si mes souvenirs sont exacts, il y a trois nouvelles dans le recueil de "La femme rompue". Certes, un monologue : celui, monomaniaque et complètement hystérique, d'une femme solitaire exclue (pour des motifs que l'on devine relevant efffectivement de la psychiatrie) de sa famille, mari, enfant...
Mais il y a aussi l'histoire totalement pathétique d'une femme délaissée pour une plus jeune qu'elle, une femme qui ne comprend pas ce qu'il lui arrive puisqu'elle avait "tout bon" : cultivée, " à sa place", aimant son mari...
Et enfin l'histoire de la femme vieillissante sommée de ne plus exister, de s'effacer...
j'ai lu tout ça à 16 ans, et malgré l'ignorance totale des sentiments d'autrui qui était la mienne à l'époque (j'avais déjà assez à faire avec mes névroses adolescentes disons autodestructrices), j'ai été imprégnée à jamais des trois histoires. Beauvoir se garde bien, évidemment, d'influencer le jugement du lecteur, mais sa pensée transparaît par en-dessous : il s'agit d'illustrer à quel point les dés peuvent être pipés dans la condition féminine). Encore maintenant, et cela doit faire quarante ans que je n'ai pas rouvert le livre, quand je croise certaines névroses féminines sur le net, je pense aussitôt à la "femme rompue", à ces trois-là ensemble, quoi...
Alors, une pièce qui réduirait le livre à une seule de ses nouvelles me semblerait a priori aussi amputée qu'un triptyque réduit à son seul panneau central.
Car il s'agit bien entendu des trois facettes d'un même destin - je veux dire, hystérique ou raisonnable, il faudra toujours s'effacer, et être toujours dupe - c'est le tranchant message de Beauvoir, aussi tranchant, net et métallique que la voix même de l'écrivaine.
Fêtes donc.
- Par clopine
- Le 06/12/2016
- Commentaires (1)
Bien sûr, qu'on a envie de dire : "fêtes donc, après vous". Bien sûr, que je comprends l'exécration de Clopin, pour qui la période entre noël et jour de l'an est synonyme de problèmes : cadeaux, déjà, il ne faut pas décevoir ce n'est pas si aisé, ensuite susceptibilités des uns et des autres, et rappel que rien n'est simple et tout est compliqué, surtout dans les familles.
Pourtant il n'a pas à se plaindre : je m'occupe généralement de la majorité des trucs à faire, de la déco à la tortore, et je n'ai jamais pu priver, même dans les pires moments, les gamins des cadeaux, du sapin, des petites bougies et de l'air mystérieux que la baraque prend.
Cette année, pourtant, j'aurais pu m'en passer : les deux garçons, adultes depuis lontemps, ont définitivement "passé l'âge", et la nouvelle génération, si'l y en a une un jour, n'a pas pointé le bout de son nez...
Mais voilà : j'y suis allée encore plus que les autres années. Compensation inconsciente ? J'ai choisi le sapiin le plus gros du magasin, l'ai surchargé de trucs brillants, virevoltants, fragiles et bien niaiseux...
Bien sûr, je crois que je suis condamnée à officier ainsi jusqu'à ma mort. La faute à ma mère, très certainement, qui nous occupait de Noël comme on lance une bouée à un homme qui se noit. Je revois encore, une par une, toutes les pièces de la crèche... Je me souviens des noëls de ma toute petite enfance : le sapin était très dangereux, car on y plaçait de vraies petites bougies, engoncées dans des pinces métallisées, qui risquaient à chaque instant de foutre le feu à tout le bazar.
Je ne peux pas m'empêcher de regretter les années où "je n'ai rien fait". Où je haussais les épaules dédaigneusement, ou bien vitupérait contre la "consommation"...
Parce que, quand même : si vous retirez le bling-bling et le pognon, l'invasion électrique et l'artificiel, il vous reste et restera toujours ce moment si particulier de l'année, où tout est noir, froid, sans vie : au moins, mes petites lumières se reflètent dans les vitres qui me séparent de l'hiver.
C'est déjà ça.
Un Vrai Semblable...
- Par clopine
- Le 02/12/2016
- Commentaires (3)
J'y pensais, ce matin, en traversant la maison aussi endormie que peut l'être Clopin sur le coup de 8 heures du matin : notre réunion, notre couple même, notre passé et notre éventuel fuur : tout est improbable, dans cette histoire.
Je pense qu'une de mes caractéristiques est bien de ne pas réussir à "être comme tout le monde", malgré tous mes efforts. Bon, cela, je l'ai à peu près compris, d'autant qu'aucun de nous "n'est comme tout le monde". Mais disons que ma particularité est d'avoir voulu, à toute force et en dépit du bon sens, "être comme les autres". E t j'ai vraiment souffert (et à quoi sert de souffrir, enfin !) de ne pas y arriver...
Bref et pour en revenir à Clopin endormi , eh bien, arriver à rencontrer quelqu'un d'aussi différent de moi : fallait le faire.
Si je répertorie (et en évitant tout jugement, car là n'est pas la question), le résultat est impressionnant tout de même...
Tenez, on pourrait faire deux colonnes :
Il se couche tard Je me couche tôt
Il a du mal à se lever Rien ne m'est plus facile
Il dort allongé Je dors en boule
Il aime les chiens J'aime les chats
Il est méticuleux Je suis brouillonne
IL a les yeux bleux J'ai les yeux noirs
Il est facile d'accès Les gens ne savent pas trop sur quel pied danser, avec moi
Il est parfois hypocrite Je suis souvent colérique
Il lit Géo Je lis le Magazine Littéraire
Que mange-t-on ce soir ? - Des restes ! Que mange-t-on ce soir ? - Un repas
Que mange-t-on ce soir ? - Du rôti à Mamy Que mange-t-on ce soir ? - Une entrée, un plat, un dessert
Que mange-t-on ce soir ? - On va pas s'emmerder avec ça ! Que mange-t-on ce soir ? - C'est ma manière de prendre soin de l'autre
Il change ses draps trois fois par an Je ne peux pas supporter plus de quinze jours du linge de lit
Une voiture arrive "Qui c'est qui vient nous emmerder ?" Une voiture arrive : "Chic, du monde !"
Les gens viennent le voir Les gens m'évitent
le contact avec l'autre lui est facile Rien de plus difficile !
Il est plein d'indulgence pour lui-même Je ne me supporte pas
Il racle à fond ses assiettes Je peux jeter même du caviar
Attention aux objets : leur valeur est décuplée par le soin qu'ils réclament L'objet doit me servir, pas l'inverse
Il collectionne à tout va Si je pouvais ne rien posséder
Il sait tout faire Je n'ai que les mots
Il skie Je nage
Il a toujours raison J'ai si souvent tort...
Il s'aime bien Etre une heure, une heure seulement
Il a beaucoup de force musculaire Mes mains sont débiles
IL ne s'intéresse pas aux bébés Quelle responsabilité, que donner la vie !
Il s'agace du quotidien "elle a encore fichu ses souliers près du poële" Je gère
IL aime les légumes bien cuits, voire spongieux Vive le craquant !
Avant tout, l'alimentation : saine, bio, autoproduite Je peux même bouffer chez Mac Do, eh oui.
Il est large pour sa maison, radin pour le quotidien J'ai besoin d'argent pour ne jamais y penser
Il s'exprime par l'image De la musique, avant toute chose
"Quand c'est papa qui conduit, on sait où on va" "Quand c'est Maman, ça finit toujours par des rallongis"
Il prend soin de lui Je ne fais pas attention
Waouh ! C'que ça lui va bien, ce beau costume ! Merde, encore plein de taches partout, y'a qu'à pas y penser
Il est beau Je suis laide
Il est maigre Je suis grosse
ll joue de l'accordéon J'ai vendu mon violon
Y'en a, vraiment, c'est des champions de la branlette intellectuelle Combien d'années à pratiquer l'introspection ?
Je pète, je chie, et je t'emmerde J'ai un penchant coupable et caché pour l'imparfait du subjonctif
Il est le fils de Cavanna Je suis la soeur de Carson Mac Cullers
Il est chez lui Je suis chez lui
Et pourtant, cela fait un bout de temps que ça dure...
Plus je vais, moins je vais...
- Par clopine
- Le 29/11/2016
- Commentaires (0)
Comme tous ici bas, "plus je vais, moins je vais", certes - mais plus aussi je me durcis, me semble-t-il, dans mes goûts. Je ne suis pas la seule à avoir "de durs goûts et dégoûts", mais il me semble que PLUS j'affine mes manières de voir, (moins je me cherche de miroirs, comme je le faisais si désespérement lors de mon épouvantable adolescence, ) PLUS je suis capable (oh, modestement !) d'analyser ce qu'on me présente, MOINS je suis satisfaite.
Rassasiée, peut-être ? J'ai la chance d'être d'un pays où l'on porte très haut (encore, malgré bien des tentatives de recul, et les prochaines attaques populistes prônant l'inculture seront sans doute les plus virulentes) les valeurs culturelles : du coup, j'ai eu à ma portée, au lieu d'un maigre buffet ou de ces étagères des magasins de l'Est durant l'ère soviétique où trois boîtes de conserves s'entrechoquaient au milieu d'un grand vide, la carte étoilée et gastronomique d'un vieux pays débordant de culture.
J'ai pioché au hasard, en ai longtemps gardé un sentiment d'humilité, ne suis plus si sûre désormais, à connaître l'intense pédanterie qui éclate, (comme les pets foireux d'une bête à corne exorbitée, ici et là - et internet permet aussi cela : frôler la vacuité des autres), qu'il faille m'en affliger...
Donc, grosso modo, je devrais m'accommoder de tout ce que j'ai pu grapiller, pour nourrir ma curiosité intellectuelle, qui ne s'est vraiment jamais éteinte.
Eh bien, non.
Je crois qu'en fait, cette curiosité était ma manière à moi de tenter de rencontrer les autres. C'est ce que l'on fait tous, non, avec plus ou moins de maladresse...
Mais les miennes, de maladresses, sont assez énormes dans le genre. Elles me font penser à ces copines que j'ai fréquentées dans le temps, et qui tentaient, louable initiative, de monter des formations théâtrales pour des publics démunis (chômeurs...).
L'idée était excellente, la démarche généreuse, le besoin défini (car le théâtre est aussi l'art d'apprivoiser l'éloquence, et c'est ce qui manque le plus à un chômeur...). Hélas. Les filles en question ont commencé par trouver une salle, et patatras ! Elles ont surchargé le lieu d'objets et de décorations de toutes sortes, censés "ouvrir l'imagination", comme un bateau renversé, des tentures, des gazes et des tulles... Bref, le même défaut, exactement, que pour ces "jeux de rôle" où les animateurs vous disent "tu es libre d'inventer ce que tu veux", mais où tu dois te couler, en fait, soit dans la peau d'un elfe ou d'un guerrier, avec codes encore plus définis et contraignants, ma parole, que les didascalalies d'une pièce de Beckett. Le contraire de la liberté...
Dans le "théâtre" des copines, personne ne pouvait apprendre à jouer quoi que ce soit . C'était devenu l'univers (oh, certes, très chatoyant) mental des copines, étalé là...
Un vrai cours de théâtre, c'est deux chaises, un rideau, une estrade, point.
Eh bien, plus je vais, plus il me semble que je devrais aller vers cette sobriété, mais qu'en réalité je surcharge mon espace mental de décorations inutiles. Ma parole, je ne peux plus lire un livre, voir un film ou même un tableau, sans commencer par le dépouiller mentalement de l'ego de son auteur, et je cherche une parole qui tiendrait "toute seule", à la fois réduite à presqu'elle-même et en même temps universelle ; plus mon armoire est pleine, moins je supporte les oripeaux de l'effet pour l'efffet. e (sauf pour mon propre cas, ô fatuité de l'introspection !!!)
Mouais. Mes goûts devraient s'élargir : ils se restreignent. Je n'en suis pas encore à préférer à tout les redites, à repasser en boucle ce qui m'avait émue à 8,9 ou 10 ans, ou bien à renifler tout ce qui est contemporain du même nez d'une vieille dame qui ne jure que par le numéro 5 de Chanel, et trouve que tout le reste, ma foi, sent la vulgarité...
Mais cependant, cependant : plus je vais, moins je vais. Je suis un escargot qui se fait déborder par la coquille qu'il porte, qui a tant poussé, s'est tant développée, et prend désormais tant de place que certes le refuge est devenu luxueux, mais l'allure, elle, s'est ralentie d'autant...
Jamais à l'heure...
- Par clopine
- Le 27/11/2016
- Commentaires (0)
J'aurais mieux fait d'écouter Dick Annegarn, tiens ,
plutôt que de mettre France Musique pendant la préparation du repas (le dimanche matin, sur France Cul, le service public est dévolu aux diverses confessions religieuses, ce qu'on pourrait trouver critiquable mais passons...)
Au menu, après un apéro-maison (radis gris avec fromage dessus), j'avais prévu une tarte aux petits légumes et truite fumée en entrée, suivie de tranches de gigots d'agneau garnies (oignons, carottes, chips de pomme de terre par-dessus) et ail fondant dans la lèche-frite, fèves en accompagnement (cuisson vapeur et peau épaisse des fèves ôtée, s'il vous plaît), salade et tarte normande (une 5-4-3-2-1, celle qui me vaut d'habitude des regards émus, parce que les pommes sont en quartier épais et qu'elles fondent dans la bouche). Le tout du jardin, du 100 % beaubecquois.
Bref, un travail plaisant et absorbant. Tout aurait été pour le mieux, si, les mains tellement occupées que je ne pouvais pas aller changer de station (et de toute façon, donc, sur France Cul y'a la messe), je n'avais pas écouté France Mu.
C'était l'insupportable Rafaël Enthoven. Il a dit des monceaux de conneries sur le jazz ("où les notes fuient les unes devant les autres", bon dieu, Jacques Chesnel aurait été là il les lui aurait rattrapées vite fait tiens, les notes fuyantes), a fait de la fausse modestie en veux-tu en voilà (rappelant des déjeuners avec Clément Rosset avec tutoiement, ben tiens, tout en affirmant deux minutes plus tard que "non, ce n'est pas mon maître, je ne suis pas à la hauteur d'un tel maître", mais tu lui tapes sur l'épaule au restau, va, bouffon...) dit tout et son contraire (on comprend que ce qui n'est pas de son goût est nul, puis après qu'il assume ses mauvais goûts, enfin bref), et les choix musicaux étaient à la fois m'as-t-u vu et inadéquats.
Heureusement, ça n'a pas gâté le gigot. L'essentiel était sauf.
No, no, no...
- Par clopine
- Le 24/11/2016
- Commentaires (0)
Je suis devant l'année 2017 exactement comme Amy Winehouse devant sa cure de désintoxication.
No, no, no.
(et je le sais, que ça a mal fini. Mais bon.)
La rose du papier peint (ma non-rencontre avec Riad Sattouf)
- Par clopine
- Le 23/11/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
C'est un peu de la faute des enfants : ce sont eux qui m'ont mise au courant. Les enfants, c'est-à-dire le Clopinou et sa nouvelle amie C.,qui habitent ensemble et se séparent le matin à la gare de Rouen : elle part au Havre, lui à Paris. On pourrait en faire une chanson de Maxime Le Forestier...
C. est une très jeune femme qui m'étonne "tant et plus", et parmi ses caractéristiques, elle a un don de l'écoute étonnant. Je ne suis pas habituée à une telle attention, qui me surprend et me ravit toujours. Du coup, j'ai bien peur de me "lâcher" devant C., qui écoute toujours "tout", avec cet air extrordinairement sérieux et concentré qu'elle prend et qui n'arrive pas à atténuer sa joliesse (car elle est diablement jolie, parbleu !!!).
C. a retenu que je plaçais très haut Riad Sattouf, donc zou : nous voici partis tous les trois à l'Armitière, ce lundi où l'auteur venait présenter le dernier tome de son autobiographie.
J'étais ravie, et je me promettais de faire des efforts : car je sais que Clopinou me surveille comme du lait sur le feu, et qu'il craint toujours mes divagations et débordements. Mais pour que je sorte de ma solitude et que j'aille ainsi au-devant de quelqu'un, il faut cependant que j'ai de l'enthousiasme. Oh, je remets parfaitement l'évènement à sa juste valeur, et j'ai appris à ne pas trop attendre de "rencontres" organisées sur fond promotionnel. Impossible de parler vraiment à qui que ce soit : ce ne sont que des "non-rencontres". J'ai ainsi "non-rencontré" ni Michel Onfray, ni Pierre Assouline. J'en hausse encore les épaules...
Mais ce soir-là, me projetant face au dessinateur (génial) qu'est Riad Sattouf, j'avais encore une autre motivation : je suis tant à la recherche de réponses. Depuis les attentats de Charlie Hebdo et des autres, depuis l'incroyable coloration en brun néofasciste que prend le monde, me voilà comme une girouette cherchant le vent.
Sattouf, grandi en Irak, en Syrie, Sattouf, témoin de l'incroyable évolution paternelle , Sattouf, qui venait de quitter Charlie quand... Mon sac était plus que plein de questions débordantes. Certes, mes questions sont assez tristes, surtout pour un auteur "comique", qui fait, comme ses deux premiers films en témoignent, dans la dérison. J'ai désormais besoin d'autre chose que de pochades, même si celles-ci, comme des bonbons au poivre, cachent derrière leur bouffonneries quelques vérités bien senties sur la déliquescence générale du genre humain !!!
J'étais assez émue d'être avec les deux jeunes gens - comment ne pas avoir honte de ce que ma génération leur propose ? - mais je tentais, dans la file d'attente qui s'épaississait de minute en minute, de sérier les questions que je voulais poser lors du débat qui clôturerait la conférence...Quelles étaients les plus importantes ? J'en discutais avec les enfants, dans la queue, au milieu des profs (elles et ils avaient des têtes de profs et des fringues qui sentaient la camif) et les dignes Dames qui patientaient trouvaient évidemment que je parlais trop fort, quand soudain je me rendis compte de mon erreur : il ne s'agissait pas d'une conférence, mais d'une séance de dédicaces.
Patatras. Ce fut la Dame qui me précédait dans la queue qui me précisa les choses, en se retournant : "Vous ne pourrez pas poser de questions,voyons... Vous ne savez donc pas comment ça se passe, vous n'avez jamais été dans un salon du Livre, devant un dessinateur ?" Je rougis intérieurement, en pensant à mon unique non-rencontre assoulinienne... "Il va faire un dessin par livre, ", reprit la Dame. "C'est pour ça qu'il y a tant de monde. Sinon, pensez !..."
(suite à... tout de suite)
Le petit bout de la queue de la chatte...
- Par clopine
- Le 22/11/2016
- Commentaires (0)
Une fois n'est pas coutume : je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas (encore) lu. Voici sa couverture :

C'est un livre féministe sur les gros mots. D'aucuns vont hurler au pléonasme, parce que pour plein de mes contemporain(e)s, "féminisme", c'est DEJA un gros mot... Mais justement : les mêmes qui repoussent, l'aîr rigolard et un peu dégoûté à la fois, le mot "féminisme", ignorent ou oublient que presque tout ce qui est féminin, pas "féministe", hein, simplement "féminin", est très souvent connoté péjorativement...
Bien entendu, il n'y a pas que les mots. Les rémunérations aussi, la reconnaissance sociale itou, dès qu'elles sont féminines, subissent une nette dégradation... Mais à travers le simple vocabulaire, à travers les mots de tous les jours, la dépréciation, le mépris, inconscient ou non, le fatalisme ("la femme restera toujours la femme") et l'insulte se font jour : la situation féminine réelle est ainsi dévoilée - et à travers les mots et les paroles, la vérité de la domination, obstinément, dévoile son ricanement.
Je ne reviens pas sur l'insulte "con", n'est-ce pas... Mais je veux juste dire qu'aujourd'hui, entre cent idées reçues (au boulot, tiens "ah moi je préfère travailler avec des hommes, parce qu'il n'y a rien de plus vache -sic- que les femmes entre elles"), ce qui ouvertement est féminin est toujours associée au vulgaire, à l'honteux, à "ce qui ne devrait pas être dit".
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, les medias et la nivellation vers le bas de nos écrans, l'irruption des termes argotiques et la banalisation des répertoires sexuels aidant, le triste passage de Coluche à Bigard quoi, eth bien un simple terme féminin comme celui de "chatte" ne peut carrément plus être employé. J'ai des copains, des copines, qui racontent ainsi des anecdotes sur leur animal - en employant le mot "chat". Si on leur pose la quesiton, oh, bien sûr, ils vont avouer qu'il s'agit d'une femelle... Mais il faudra leur poser la question pour qu'ils osent prononcer le mot, qui sera bien entendu l'occasion de ricanements salaces...Ö ma chère Colette, toi qui en fis carrément le titre d'un de tes romans, croirais-tu cela ?
Alors ce livre "féministe" est forcément salutaire, et je m'en vais en faire, d'une manière ou d'une autre, l'acquisition.
Rien que pour avoir l'occasion d'appeler une chatte, une chatte...
Tristes transports...
- Par clopine
- Le 20/11/2016
- Commentaires (0)
Une amie bien informée nous prévient que plusieurs centaines (oui, vous avez bien lu, centaines !)) d'arbres risquent d'être abattus à Rouen, et que la grande décapitation a d'ores et déjà commencé sur les quais...
Mais le pire reste à venir sur les boulevards de l'Yser et des Belges. Tous les rouennais, même ceux qui, comme moi, ont fort peu de connaissances historiques, ressentent que ces boulevards-là correspondent très certainement à d'anciennes limites de la ville. Le donjon, seul lieu où la présence de Jeanne d'Arc (hormis la place de son bûcher, évidemment) est attestée, est juste en-deça. Au-delà, ce sont les collines "du bon côté" de Rouen,( l'ensoleillé ), qui commencent, avec les privilégiés qui étagent leurs belles maisons sur les flancs des côteaux de Mont-Saint-Aignan ou Bois-Guillaume...
Oh, évidemment, l'intention est louable, comme tous les pavés de l'enfer : il s'agit de doubler la ligne métro-bus existante, et qui remplit parfaitement son office depuis une bonne vingtaines d'années. Mais tout aussi évidemment, alors que partout ailleurs dans le monde des villes se mettent au vert et aménagent sérieusement leurs déplacements en minimisant la circulation routière, à Rouen, on imagine l'inverse. Au lieu de prendre sur la chaussée pour n'y laisser qu'une voie et faire passer les transports en commun sur la voie ainsi gagnée, on envisage sérieusement de piquer les emplacements des trottoirs et donc d'abattre les rangées de platanes et autres essences qui y figurent. La main sur le coeur, "on replantera" - sans prendre en compte les difficultés qu'ont les pousses à grandir, sur dix arbres plantés seuls deux arrivent à survivre, et d'ailleurs, on les replantera où ?
...
De plus, supprimer ces arbres c'est bien évidemment augmenter encore la fournaise estivale, surtout si la circulation automobile n'est pas diminuée. Les prostituées qui hante le boulevard des Belges seront épargnées, puisque les horaires de travail sont nocturnes, mais je ne pense pas que ce soit la principale préoccupation des commerçants qui s'opposent à toute réduction du trafic. Il faut que le client puisse circuler tout seul dans sa bagnole et parvenir ainsi jusqu'au pas de leurs portes, disent -ils. Ont-il oublié que le centre ville, piétonnier depuis soixante ans, n'a certes pas souffert de l'interdiction automobile ? Oh, bien sur, c'est devenu un exploit d'acheter un paquet de nouilles dans le centre : il n'y a plus que des boutiques de fringue. Mais la foule qui se presse rue du Gros n'a pas diminué, du fait d'être devenue piétonne, au contraire...
Plus que jamais, le bien public s'oppose aux intérêts financiers du consumérisme : et ce sont les beaux arbres des boulevards qui risquent de payer la note...
VERTU ATHEOLOGIALE
- Par clopine
- Le 17/11/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
J'éprouve, comme Fontenelle sur son lit de mort (mais je suis encore vivante, hélas...), une telle "difficulté à vivre" en ce moment, que je tente par tous les moyens de trouver des ressources. Comme ce ne sont pas mes contemporains qui semblent pouvoir m'en procurer, il faut donc que je descende, que je creuse, que j'exhume de moi-même ce qui pourrait me permettre de retrouver ma belle aisance d'autrefois. Non que j'aie jamais été si assurée que cela, mais cependant : mes doutes étaient légers, relevaient de la spéculation intellectuelle, et n'étaient pas entachés de cette culpabilité qui m'étreint aujourd'hui, quand je pense aux générations futures de l'humanité, et plus spécialement, évidemment, à nos enfants, à Clopin et à moi...
Aujoud'hui, le poids est si lourd, l'avenir si sombre, et la Terreur si proche : décrire cet espèce d'étau que je ressens est au-dessus de mes forces. Tout juste puis-je évoquer ce monde où Trump est aux manettes là-bas, Poutine en tsar ici, Daech à la Barbarie et où la banquise fond, pour peindre mes appréhensions.
Désolée d'être pédante, mais le doute s'enveloppe d'effroi, et le plus simple serait donc certainement de se voiler la face et de ne rien dire, comme l'Agamemnon de Timanthe : mais il y a le mot "pèse" dans le concept d'"aposiopèse" (ce qui signifie "ne pas pouvoir décrire l'affliction donc utliser des stratagèmes pour laisser la place à l'imagination...").
C'est là où pourrait pointer, oh, juste par le bout de son nez, le regret d'être athée : ni consolation, ni vertu ne s'offrent - a priori - à moi. La foi en un autre monde merveilleux pourrait être aussi commode que le voile de Timanthe - mais je ne l'ai certes pas à ma disposition.
Quant à la vertu... Le christianisme a eu beau jeu de reprendre les quatre vertus platoniciennes, "cardinales", (c'est-à-dire qui demandent des efforts personnels) et d'y ajouter, parmi les trois vertus "théologiales" (c'est-à-dire tombant tout droit de dieu, boum gare là-dessous, rien à faire, pas à se biler, tu l'as ou tu l'as pas, c'est pas ta faute à toi, Lolita), l'espérance...
Qu'est-ce que je peux bien faire, aujourd'hui, de ce mot d'"espérance" ? Que peut-on "espérer" "de bon ? Que Juppé devance Le Pen, l'an prochain ? On n'a vraiment plus que ça, comme perspective ? A part hausser les épaules, l'athée que je suis ne voit pas trop en quoi espérer...
Mais pourtant, je sursaute. Je ne vais pas me mettre à laisser l'espérance, à côté de la compassion, de l'hymne national et de la figure historique de Jeanne d'Arc, dans les seules mains des croyants, c'est-à-dire de ceux qui m'inspirent une vague pitié, quand ils sont sincères, et une vraie répulsion, quand animés de leurs croyances débiles, ils entendent régir le monde...
Il faudrait inventer des vertus "athéologiales", et placer l'espérance au premier rang d'entre elles. Seule l'espérance poosède la fermeté de l'aiguillon, pour continuer d'avancer...
(mais en suis-je encore capable ?)
Ne plus sauver Ovide, mais partager la cambrure aux reins...
- Par clopine
- Le 16/11/2016
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
C'est peu de dire que l'élection de Trump m'inquiète. Elle m'attaque aussi totalement que la feuille de chou est mangée par les chenilles de la piéride : de tous les côtés à la fois...

Et me voici effrayée à l'idée de me racornir, de me réfugier dans la solitude et la plainte : du coup, je divague, pense à ceci, cela, à Sisyphe sans l'imaginer heureux, Pas plus qu'Ovide, d'ailleurs, finissant si tristement sa vie...
Et du coup, je me souviens des "tristes pontiques" , la traduction de Darrieussecq d'Ovide. Et voilà : c'est de la fin de la préface du livre que survient l'espoir, ou, au moins, (et du coup, j'ajoute un peu de moi à la si belle langue de Darrieussecq) une sorte de consolation...
"Qu’un homme triste et désespéré ait écrit sur une plage perdue, il y a deux mille ans : ce geste me concerne, ce texte me demande quelque chose. Quoi exactement, je ne sais pas. Je ne peux plus sauver Ovide, et il ne saura pas que je le lis. Le lire, pourtant, c’est participer à quelque chose qui, malgré tout, ne disparaît pas. Un monde commun. Une humanité, un espoir atemporel, une gravité. Partager la cambrure aux reins, la parole, la pensée. Quelque chose qui fait que nous sommes debout sur la Terre, à tourner dans le vide, sous des étoiles qui restent inconnues."
Réminiscences et temps qui passe...
- Par clopine
- Le 15/11/2016
- Commentaires (0)
Le temps, qui vient un peu plus chaque jour me voler mes yeux, mes dents, mes cheveux, ma peau, laisse cependant, (sans doute en guise de signature), derrière lui, de plus en plus nombreuses, ces fameuses réminiscences analysées par Proust. Enfin, il n'est pas, dans mon cas, question de viennoiseries (d'autant que je ne suis jamais allée à Vienne), mais de brefs "flashs", qui me renvoient à des moments passés. pas forcément intenses, d'ailleurs, les moments en question, ni spécialement spectaculaires. Et je ne ressens pas non plus l'abolition du temps qui fit la consolation de Marcel...
Simplement, il est vrai que ces détours mémoriels me remettent, un bref instant, dans la peau de celle qui les vécut. Et il est vrai aussi que plus je vieillis, plus ces "flashs" sont nombreux, imprévisibles, et plus ils m'emplissent d'une sorte de nostalgie - pas à cause de ce que je fus, mais à cause de ce que je suis...
Si vous ajoutez à ce poids du temps, rendu donc encore plus lourd par ces échappées où, d'un coup d'un seul, je peux arpenter telle rue de Prague, accrocher mon manteau à telle patère de l'école élémentaire d'autrefois, caresser le dos d'un chaton sous une haie de framboisiers, alors que ni le chat, ni les framboises n'existent plus que dans la douceur laissée sur la paume de ma main et le goût fondant de ma bouche d'autrefois, si vous ajoutez à l'âge qui multiplie mon passé le lent glissement vers une solitude que novembre souligne, accentue et, en quelque sorte, réfléchit, vous comprenez que la période n'est pas très facile à vivre.
Il est vrai que la solitude préserve de la bêtise : sauf de la sienne propre, et la mienne m'a toujours adressée son bon gros sourire niais et complaisant à la fois. Si je veux m'en dégager, si j'attrape ma liseuse, la bécasse s'avance encore un peu, et me pousse à ouvrir la télé, l'écran indigeste, le répertoire de lieux communs avec lesquels les conversations quotidiennes ventilent la vacuité des jours : "que veux-tu manger ? As-tu payé les impôts ?"
Il faudrait travailler, bien sûr. S'envelopper de labeur, comme on met une couverture sur les épaules d'un accidenté... Bah. Je dis ça, et j'ouvre la télé...
Worlds, worlds, Worlds...
- Par clopine
- Le 13/11/2016
- Commentaires (0)
Car il s'agit de la même humanité, celle qui vote Trump ou Le Pen, celle qui brandit le nom d'Allah et la kalach (quand ce n'est pas le couteau à décapitation), celle qui aime tant le silence des tables de nuit des assassins, et trouve obscènes les paroles des homosexuels, des violées, celle qui admet du bout des lèvres la présence de l'autre, pourvu qu'il soit l'inférieur. Nos mondes sont différents, mais derrière tous les "words, words, words", nous restons bel et bien des humains !
Nous n'avons pas de Shakespeare pour décrire le tragique de ce nouveau siècle : tout juste Houellebecq, c'est dire.
...
J'ai téléchargé, avec bien du mal, les oeuvres complètes d'Hugo sur ma liseuse : mais comment croire encore à la littérature ? Même celle-là, l'hugolienne dans laquelle j'ai appris à lire, avec son souffle puissant, son empathie, son humanisme : rien n'y fait. Novembre peinturlure tout en marron -et nous sommes dans la merde pour longtemps.
...
Peut-être en relisant Mac Cullers dans 'illuminations et nuits blanches". Carson est une amie. Mon amie. Elle était croyante, bien sûr, et du Sud des Etats-Unis (ah ! Si seulement je pouvais passer une semaine avec elle ! Ou trois jours ! Ou une journée seulement, et nous causerions !) , et c'était une personne si "impossible" qu'à la seule perspective qu'elle puisse avoir un enfant, son entourage s'évanouissait d'horreur, c'est dire le personnage. Et pourtant, dans cette si mince autobiographie, avec cette façon pataude de vouloir être aimée, avec la simplicité avec laquelle elle relate sa rencontre avec Annemarie Schwarzenbach, (sans dire le nom, d'ailleurs, mais je ne connais pas Véronique Aubouy pour rien, nom de zeus !), avec tout ce qui fait Carson, elle trouve encore le moyen d'être elle-même et d'être mieux que quiconque, ce qu'un Trump (mais il ne s'agit pas de Trump, bien sûr, mais de pourquoi Trump est là, pourquoi tous ces gens qui votent pour lui en sont arrivés là), ne saurait comprendre...
Elle a répondu ceci à qui lui demandait de déposer ses manuscrits dans une bibliothèque où la ségrégation raciale jouait encore (en 1961 !) :
" Comment pourrais-je, en toute conscience, déposer mes archives dans un lieu où le droit de les lire et de s'en servir n'est pas accordé à tous ? Votre bibliothèque mérite-t-elle vraiment de s'appeler "publique" ? J'ai toujours cru, je crois toujours, que tous les hommes ont été créés par Dieu. Et l'idée que je me fais de Dieu m'interdit de penser qu'il ait pu ne pas les avoir créés tous égaux à ses yeux".
(et pas un mot sur Truman Capote, dans son autobiographie. Bien fait !)
Coup de pied au cul...
- Par clopine
- Le 12/11/2016
- Commentaires (0)
J'ai lu que "les gens", tous les lambdas de ce monde, commençaient à coucher leurs impressions, à tenir des chroniques, à être agités par l'envie du témoignage, en cas de bouleversements sociaux. Ainsi, pendant la "drôle de guerre", les journaux intmes ont fait florès (ma mère, par exemple, qui a arrêté au retour de mon père de la drôle de guerre, en 1940). Comme si sortir du quotidien, de force, vous amenait à vouloir témoigner justement de ce quotidien. Comme si l'extraordinaire vous rendait vous-même extraoridnaire...
C'est peut-être un peu, avec ce que tout l'avenir nous réserve de sombre, ce qui m'arrive en ce moment. Je me dis que si l'on dessinait une mappemonde sur l'unique critère coloré du "marron", décliné en plus ou moins d'extrêmisme, de néofascisme, de dictatures qui ne disent pas leur nom et de celles qui balancent tranquillement la couleur, eh bien, du noir de Daech au caca d'oie américain, notre monde afficherait tranquillement sa couleur actuelle : celle de la merde, en fait...
Ceci dit, du coup, tenir ce blog que je délaissais, non à cause d'une vie trépidante ou de projets à mener (les obligations qui nous retiennent, Clopin et moi, auprès de Mamie nous empêche tout projet de voyage, même à court terme), mais par lassitude et parce que je suis moi aussi dans une drôle de période d'attente : encore 32 mois avant ma retraite, mon "élimination des cadres", tenir ce blog, donc, me redevient une tentation : je pourrais y consigner non seulement mes habituelles divagations mais aussi tous les signes, même les plus ténus, de cette lutte qu'il faut désormais entreprendre (à moins d'être sourd, muet, aveugle et cul-de-jatte, on ne peut guère nier qu'il faut désormais, jour après jour, défendre des valeurs qu'on ne croyait pas voir ainsi remises en question, puisqu'elles sont universelles, au fond. Mais voir la mappemonde ci-dessus !)
Alors, aujourd'hui, la première pierre (mais c'est déjà un trop grand mot, disons, caillou, fétu, poussière) que je veux poser sur ce blog pour témoigner de ce que je tente de faire, si dérisoirement, dans le tourment de l'époque, vient d'un SMS du fiston : Riad Sattouf vient signer la semaine prochaine à l'Armitière.

J'ai découvert Riad il y a une dizaine d'années, grâce à sa colonne hebdomadaire dans Charlie Hebdo. J'ai instantanément, non pas "été séduite", mais "appelée" : il s'agissait de petites vignettes qui racontait des histoires vues dans le métro. Le rapport complètement hallucinant -et d'autant plus hallucinant qu'il était d'une banalité admise par tous- entre parents et enfants, entre ados, etc. Les propos qui s'échangeaient, sur fond de provocations débiles, d'insultes grommelées, de vacuité intellectuelle- le tout servi par un dessin minimaliste à la Reiser. Moi qui vit aux champs, moi qui ai le plus grand mal à emprunter le métro parisien sans flancher devant la misère et la violence qui s'étalent là, la "vie secrète des jeunes" de Riad Sattouf était le regard auquel je me raccrochais, car ce type n'est pas seulement une éponge avec un crayon noué autour, c'est le témoin à la fois lucide, pertinent et bienveillant, oui, bienveillant, d'un monde en réalité catastrophique...
J'ai guetté les allées et venues de l'auteur. Son départ de Charlie (après les attentats, je lui ai envoyé un mail le suppliant de revenir, ne serait-ce qu'une fois, dans le journal anéanti), ses essais cinématographiques ("les beaux gosses" et "Jackie au royaume des filles" -des pochades, certes, mais toujours cette lucidité derrière), ses albums (histoire de mes dix ans)...
J'admire tout chez ce mec, le dessin et la retenue dans la morale, le témoignage et l'implacable dérision. Sattouf, c'est l'anti-Houellebecq, pour moi, non parce qu'il serait "angélique" (tu parles) ou "de l'image" plutot que "du mot", mais parce qu'il y a une telle vérité dans le miroir qu'il nous tend que je me penche, fascinée, pour tenter de regarder le monde à travers ses yeux à lui. Ca tombe bien : il le dessine, le monde.
Et puis tout récemment il y a eu la parution du chef d'oeuvre : "l'arabe du futur." Instantanément un best-seller, et la raison du succsè mérité est ici évidente : nous sommes tant coupés, ous autres occidentaux, de ce qui se passe dans la tête de notre frère ou de notre soeur maghrébine (ou africaine, ou mettez ici tout ce qu'on ne voie jamais à la télé) que la bd de Sattouf fait le même effet qu'un voyage dans une terra incognita. Et le guide, c'est Ryad, le petit arabe aux cheveux blonds...
Bien sûr, on pense au "Persépolis" de Satrapi. Bien sûr, on sait depuis "Danse avec Bachir" que la bd est suffisamment expressionniste pour rendre compte des émotions humaines, mêmes les plus extrêmes. Mais je n'avais encore JAMAIS VU un livre où un fils donne à voir ce qui , pourtant, explique toute notre époque : l'évolution de son père. Ce n'est pas Sattouf, c'est bien lui, le père, "l'arabe du futur", qui dessine les mercédes (symbole absolue de réussite) avec des roues carrées (ce qui interloque l'enfant, parce que pour rouler...) .Enfin, lui, qui se voulait "l'arabe du futur"... Ah ! Le récit n'est pas achevé (et c'est un genre de récit qui ne s'achève jamais, puisqu'il s'agit de la recherche du temps perdu de Sattouf....) mais je voudrais tant savoir ce qu'aujourd'hui, ce pauvre bougre de père de Sattouf est devenu (et la mère, bon sang, la mère ! Cette française qui ne s'exprime pas autrement que par des revendications purement matérialistes, envie d'avoir des supermarchés et d'une vie plus facile, faire bénéficier à ses enfants de l'éducation française, mais qui, je ne sais comme Sattouf s'y prend pour faire passer ça dans ses dessins, a surtout été follement amoureuse de son père...)
Bon vous avez compris que j'aime et l'oeuvre, et le type qui sait faire ça.
Alors, première petite bataille gagnée : j'ai prêté à Clopinou et sa nouvelle copine les bouquins de Sattouf. Et je voudrais aller le voir à l'Armitière avec eux. Non que j'attende quoi que ce soit d'une séance de signatures, mais pour que Clopinou (et.) et moi ayons partagé ça. Pour nous en souvenir...
Quant à Hollande, je serais lui, je me grouillerais de lui refiler la légion d'honneur, ou n'importe quel colifichet, à Sattouf. Parce que ce ne sera pas Marine Le Pen qui le fera, pour sûr.
L'amer hic...
- Par clopine
- Le 09/11/2016
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Il y a ceux qui voient dans cette victoire de Trump une "leçon" donnée par le peuple aux "élites", et qui se réjouissent d'avance d'un "changement" radical, avec le pouvoir donné à ceux qui ne l'ont pas...
Mais Trump, c'est juste l'opposé. C'est celui qui, s'arrogeant une légitimité provenant de la brutalité, de la violence, de la xénophobie et du repli sur soi, va en profiter pour écraser tout ce qui ne correspond pas à une vision du monde basée sur l'arrogance (l'homme blanc serait supérieur) et la peur (de l'autre). Or, le peuple est en majorité non-blanc, et est constitué en majorité de ces "autres" qui sont si différents... C'est donc la négation du peuple. Trump est ce que le peuple devrait redouter le plus, parce que justement il prétend lui ressembler.
Comment affronter le regard si clair de mon fiston de 22 ans, en sachant le monde dans lequel il va devoir (sur)vivre ?
...
Faudra-t-il qu'il affronte de (trop longues) années de chaos, avant que les valeurs fondamentales, les seules qui puissent légitimer l'espèce humaine, les valeurs humanistes et universelles, ne refassent surface ? Avant que les extrêmistes de tout poil, ici Daech, là Poutine et son rêve de Russie impériale, et plus loin Trump et ses barrissements hystériques de tribun dicatorial, soient ensevelis dans le linceul de leurs haines et de leurs violences ?
Il faudra oublier l'amertume de voir ma génération aboutir à ce si pitoyable résultat. Il faudra avoir le courage de l'espérance. Il faudra combattre tous les Trump et tous les Le Pen, en se persuadant que nos armes émoussées -la démocratie, la fraternité, la justice, le soin de l'autre, la préservation de notre planète- auront finalement raison de tous les batelages racoleurs des néofascistes.
C'est pas gagné. Mais l'effroi doit être maîtrisé, et la plus grande rigueur doit être apportée à la lutte, ici et maintenant : combattons les idées du F Haine, exigeons de nouvelles formes de représentativité démocratique, expliquons en quoi le communautarisme est le plus grand danger de la démocratie, et pensons à ce monde si vulnérable, qui est pourtant notre seul bien commun.
Nounou
- Par clopine
- Le 29/10/2016
- Commentaires (1)
Le chien -qui est un bon chien -met à la patère tous ses instincts de chasseur, quand il s'agit du chat Victor Mowgli, dit "Rouky". Ce dernier, véritable trompe-la-mort qui a échappé déjà trois ou quatre fois à un destin funeste, "n'a pas eu de chance", comme on le dit des gamins de la D.A.S.S. - et en prime, il a une nature allergique qui le rend vulnérable aux piqûres d'insectes... Vous imaginez, dans les hautes herbes drues de Beaubec, ce que ça peut donner...
Sauf que Ti'punch le bon samaritain est là, pour le nettoyer, le lécher, lui gratter les petites plaies. Rouky n'a absolument aucune appréhension, et vient même s'offrir au chien, pour une séance qui ressemble à un rite d'épouillage, façon singe. Ca semble même le ravir, en fait , et en voici la preuve !

Les habits de Jeanne...
- Par clopine
- Le 28/10/2016
- Commentaires (0)
Ecouté, tard, hier au soir, une émission sur Jeanne d'Arc : je n'y ai pas appris grand'chose (on mettait cependant très fortement l'accent sur le rôle supposé de Yolande, la mère de Charles, dans la manipulation royaliste de la pucelle...), mais une fois de plus, j'ai été surprise par le traitement de l'incident des habits : n'y a t-il que moi que cela chiffonne, si j'ose dire parlant toilette ?
...
Je rappelle le contexte : Jeanne est tombée devant Compiègne, emmenée à Rouen, interrogée pendant 4 mois par le tribunal ecclésiastique présidé par le petit Cauchon. Elle résiste à tout, mais flanche quand on l'emmène devant l'échafaud : là elle renie ses fameuses "voix" (celle qui boutent !) et promet de reprendre des "habits de femme".
Revenue en cellule, elle fait voltte-face quelques jours après, et réapparaît "en habits d'homme".
L'explication la plus souvent entendue à ce sujet est qu'elle aurait subi une tentative de viol dans sa cellule, et que, pour échapper à ce type de violence, elle aurait repris l'habit qu'elle portait pendant toutes ses campagnes, à l'armée. L'habit d'homme, donc.
Mais sur le site d'Hérodote, on dit qu'elle "s'est fait voler ses habits de femme, et que par crainte d'agression, elle reprend ses habits d'homme.
Ben je trouve qu'aucune explication n'est bien claire. D'abord, a-t-elle fait état devant ses juges de ses craintes, soit de subir une nouvelle agression après une première, soit d'être agressée sans qu'il y ait eu de tentative ?
Et si elle en a fait état, cela n'empêche pas de s'interroger sur le processus dans son ensemble.
Parce qu'enfin, autant on peut comprendre qu'à la suite de ses "aveux", on donne à Jeanne des habits de femme, autant on peut s'interroger, à mon sens, sur la facilité avec laquelle elle reprend son habit d'homme. Avait-il été laissé tel quel dans sa cellule ? A-t-elle sonné un gardien, comme on appelle le service blanchisserie d'un hôtel 5 étoiles, pour qu'on lui rapporte son habit ? Comment s'y est-elle prise ?
Et en quoi l'habit d'homme pouvait-elle la protéger d'un viol ? Certes pas une solidité physique ! Alors, le côté symbolique ? Jeanne, en femme, serait une proie. En homme, elle redevient illico la (possible) envoyée de dieu, et donc refroidit ainsi les ardeurs les plus agressvives de ses geôliers... J'ai du mal à y croire... Elle était accusée d'hérésie, mais aussi de sorcellerie. Pas d'habit qui tienne devant la crainte de fréquenter une sorcière, à mon sens, à l'époque...
En tout cas, cette histoire d'habit montre au moins l'importance de la symbolique du vêtement. Dire qu'en 2016, pour toute une partie du monde (notamment méditerrannéen); nous en sommes encore comme dans l'année 1430... Soupir.
J'aimerais bien qu'un "vrai" historien me donne sa version, et surtout me dise sur quels éléments les différentes suppositions sont établies..
La montagne (et bêle ?)
- Par clopine
- Le 24/10/2016
- Commentaires (0)
J'ai regardé sur france 2, hier au soir, l'émission-moulinette (*) sur Jean Ferrat. Hagiographique, forcément hagiographique, j'y ai quand même appris que notre homme s'est plus ou moins arrêté de bosser à 45 ans, pour se retirer dans un village d'Ardèche et s'éloigner de son engagement politique originel, le Parti Communiste, en adhérant au projet fou de José Bové (pour rappel : construire un nouveau monde altermondialiste en s'appuyant sur le monde paysan) et en râlant, lors d'une de ses dernières prises de parole publique sur la place de son village, contre les électeurs qui avaient à 10 %, voté pour le Front National (il a bien fait de mourir, Jean Ferrat...)
Certes, l'émission était pénible mais le bonhomme diablement attachant et, si l'on en croit ce qui était dit, resté sincère et "sans tache" (autre que ce foutu attachement au PC stalinisé, attachement qui ne commença à prendre un coup dans l'aile qu'en 1980, bien tard, Monsieur Ferrat, bien tard...).
J'ai surtout commencé à frétiller quand l'écran a rediffusé une émission de 1969, qui réunissait sur le plateau Brassens et Ferrat. Hélas, et évidemment, l'émission ne s'est intéressée qu'à la censure qui s'est abattue pendant (des billets envoyés par l'Elysée furax pendant toute l'émission) et après le débat sur Ferrat, interdit d'antenne du coup. (je suppose que Brassens ne pouvait plus être censuré, d'ores et déjà, car devenu intouchable à force de talent...)
Pourtant, d'après les bribes qu'on nous a montrées, le "dialogue" (en fait, chacun des hommes s'adressait à l'interviewer) avait porté sur les convictions croisées de "l'anarchiste", l'indépendant Brassens qui ne faisait guère confiance qu'à lui-même, face au communiste Ferrat, persuadé que la lutte collective était la seule voie de salut. Visiblement, les deux hommes se fichaient comme de colin-tampon, ce soir-là, de leur art, mais tentaient d'expliquer leurs positions respectives. j'aurais bien aimé voir l'intégralité du débat, mais las ! Nous n'eûmes droit qu'à l'anecdotique...
Et à la dithyrambe. D'ailleurs, à ce sujet, un doute m'a saisie (non ! Je ne dirais pas qu'il m'habitait ! Na !!!) quant à la première épouse du chanteur. Le documentaire nous la présentait comme "celle qui avait appris le métier à Ferrat", puis qui se plaignait de ne pas avoir eu de succès. On suggérait que c'était par amour pour elle que le chanteur avait cessé sa carrière, mais qu'évidemment, ça n'avait pas arrêté la déchéance de la malheureuse, se suicidant grâce à l'alcool, pendant que le gentil Jean se consolait dans les bras d'une jeunette dévouée et rencontrée sur la place du village (ça ne s'invente pas).
Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis raidie devant l'histoire "touchante" qui nous était racontée là. Le soupçon m'a gagnée : et si les textes des chansons, au moins de certaines, avaient été écrits par elle, et non par lui ? Cela expliquerait mieux que l'icônique "garçon pur qui arrête la scène à cause de ses problèmes pulmonaires mais qui est un authentique un vrai" ait ainsi stoppé ses activités, et qu'il n'ait plus guère écrit après la mort de cette première épouse (à 50 ans...)
Bon, je fabule peut-être, mais c'est la faute de l'émission, niaiseuse à souhait. ..
Evidemment, pas un mot d'explication sur la vie en Ardèche de celui qui célébrait tant les ouvriers d'usine : pourtant, c'est bien là, en pleine nature, qu'un type un peu sensible peut trouver sans trop renier son origine ni ses engagements la beauté qui fait tant défaut dans la vie laborieuse des petites gens. Le village ardéchois était splendide, la forêt le sertissait, les frondaisons d'automne étaient de la beauté pure...
Nul doute qu'avec 20 ans de plus au compteur, Ferrat le compagnon de Bové aurait fini écolo !
(*) : le saccadé des phrases, la liturgie sentimentale, les prises de vues sempiternelles (fenêtres éclairées se découpant dans la nuit, jardinsoù des chaises de fer s'encombrent de feuilles mortes, suspens foireux du type "le tournant de sa vie causé par un lourd secret" - et on apprend qu'il est sorti avec une jeunette, etc. : l'émission sur Ferrat était si interchangeable avec n'importe quel magazine de ce type, qu'il soit consacré aux faits divers, à l'actualité des stars ou au sport, qu'on avait peine à la regarder, même si l'on était curieux du chanteur dont tout le monde connaît au moins "la montagne" et "ils étaient vingt et cent" en passant par "ma môme elle joue pas les starlettes". J'appelle ça les émissions moulinettes, parce que le spectateur, réduit à un tube digestif, n'a d'autre rôle que de recevoir la pâtée saucissonnée qui lui est servie là.
Pas pied (identité ?)
- Par clopine
- Le 18/10/2016
- Commentaires (2)
- Dans Mes textes
Je ne l'ai exprimé qu'à ma grande soeur, mais mon agacement n'est pas loin d'être universel. Pourtant, ce n'est pas "mon genre" de fustiger pour un motif qui, finalement, est léger... Mais justement : c'est un peu de "genre"qu'il s'agit.
Sans doute est-il très humain de "se venger", d'autant plus s'il s'agit plus d'une simple moquerie, d'un petit pied de nez, qu'une réelle volonté de blesser l'autre. Mais cependant, le peu de subtilité de ceux qui m'infligent, soit sans le savoir, soit en le sachant, la petite piqûre de rappel concernant mon nom, (c'est-à-dire, en fait, mon identité) me saute aux yeux à chaque fois.
Car oui, c'est vrai, je suis mariée, devant Monsieur le Maire et deux témoins, et j'ai signé "le parchemin" honni par Brassens. Ce qui a dû prendre, allocution du Maire comprise, environ dix minutes.
Quand on m'en parle, je réplique généralement que certes, je suis mariée, mais si peu, qu'on ne saurait en faire état sans se tromper sur mon compte...
J'ai hélas l'impression que personne ne me croie. Ni celles (elles sont plus nombreuses qu'on ne croit) pour qui le mariage a été un aboutissement ou un commencement. Ni celles qui n'ont pas trahi leur célibat.
IL aurait fallu que j'aie la certitude de vivre dans une société affranchie de tout son poids de patriarcat, de tout son machisme, de toute idée de bien à transmettre, pour éviter la question. Or, la société dans laquelle je vis ne correspond en rien à mes idéaux. La réalité étant têtue, c'est sur le conseil du notaire que nous sommes, Clopin et moi "passés à l'acte", juridiquement parlant. Brassens, lui, n'avait pas d'enfant (et encore moins de deux lits différents !)
Mais je ne me sens pas mariée. La lecture du "deuxième sexe" a été déterminante pour moi : fonder une vie commune sur un serment, c'est surtout "rentrer dans le rang", ne plus poser problème, ne plus être 'autre", ne plus être "soi".
Mon opinion sur le mariage n'a donc pas changé, et pourtant : malgré mon sursaut, on me parle de "mon mari", on semble même m'en féliciter...
Pourtant, je peux agiter mes mains devant mes interlocuteurs : ils n'y verront aucune bague. Je peux leur montrer mon courrier : on m'y appelle du seul nom que je me connaisse, certes celui de mon père, mais pas celui de mon compagnon. J'ai dû, à deux reprises, envoyer un courrier à l'administration fiscale, qui s'obstinait, ben tiens, à m'appeler du nom de Clopin... J'ai obtenu gain de cause. Mes bulletins de salaire en font autant, ainsi que la sécurité sociale.
Pas de photo au mur, pour commémorer "l'évènement". Nous aurions voulu, Clopin et moi, ne le dire à personne - mais dès le lendemain, un "bon copain" du Clopinou a été lui raconter. L'enfant fut, à l'époque, fort mécontent d'avoir été tenu dans l'ignorance : c'est qu'il devenait, l'horrible mot, "légitime"...
Je trouve que ceux qui m'apprécient devraient tenir compte de ces signes, ou plutôt de cette absence de signes, qui entourent mon statut légal. Et parler de "mon compagnon" plutôt que "mon mari"...
Quant aux autres, l'espèce de sourire narquois qu'ils arborent en parlant de mon "mariage" (décidément, je ne m'y fais pas !) est le signe de la connivence qu'ils entretiennent, autour de ce sujet là comme de tant d'autres... la bonne conscience de ceux qui veulent que vous leur ressembiez...
Je devrais prendre cela comme un exercice de mortification salutaire : tu te crois différente ? Je te rappelle gentiment que, malgré tes grands airs, la gourmette sociale qui pèse à ton poignet n'est pas un bijou, mais une menotte, même si elle te protège...
Madame.
Pourquoi j'aime Eric Chevillard...
- Par clopine
- Le 14/10/2016
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
... A cause, évidemment, de phrases comme celle-ci (qui pourrait servir de citation à la feuille de l'A.R.B.R.E., par exemple !) :
ô tempora, ô mores...
- Par clopine
- Le 13/10/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Je crois que cela fait quelques siècles que chacun se plaint de son époque. Mais j'ai cependant l'impression (partagée visiblement par les membres de ma famille...) que tous nous souffrons d'un mal endémique à notre temps où, soi-disant, la "communication" est libre, facile, aisée d'un bout à l'autre de la planète, prépondérante et à la portée de tous...
Allez j' illustre.
C'est un sujet qui intéresse, à mon sens, tous les candidats qui sont comme moi à la veille (ou presque, disons que cela se compte désormais en mois...) de la retraite. A combien se montera la pension mensuelle ? Toutes ces années, passées à l'intérieur des murs, à louper le printemps et mal vivre l'automne, combien vont-elles me "rapporter", finalement ?
Intéressante question, à laquelle j'ai eu un début de réponse grâce aux calculs et estimations envoyées par courrier...
Oui, mais voilà. Si je veux partir non à la date prévue, mais en prolongeant de quelques mois, histoire de mettre un peu de beurre dans mes épinards (et autres légumes clopiniens...), ça va se chiffrer à combien ?
Bref, j'étais en demande d'une simulation, une vraie, hein, pas du genre de celles que certaines filles avisées pratiquent couramment dans leurs rapports avec l'autre sexe...
Pas de problème, me direz-vous. Il y a des gens qui sont là pour ça, dans ce très estimable établissement qui se nomme la "CARSAT" et qui est chargé des relations entre le futur retraité, celui qui a vu partir, mois après mois, les sous gagnés à la sueur de son front, et sa (ses) caisse(s) de retraite.
C'est bien entendu là que le bât commence à blesser, et j'invite tout de suite les âmes sensibles à stopper net la lecture de ce compte rendu - rigoureusement authentique, mais si navrant, au fond, qu'on en viendrait presque à envier les anglais brexités et réfractaires aux droits sociaux, c'est dire...
DONC, j'ai téléphoné à la CARSAT, un beau matin tireli tirelo, et un petit peu sur mon temps de travail, je l'avoue...
Je suis bien évidemment tombée sur une saloperie de répondeur, qui énumérait les choix possibles, aucun d'entre eux ne répondant à ma demande de simultation, et qui m'invitait fortement à aller consulter le site internet de la CARSAT.
Ce que je fis tout aussitôt, sacrifiant sans regret ma pause de midi.
Oh qu'il est beau, le site de la CARSAT. On vous y invite à vous inscrire pour avoir un "identifiant", on vous propose des tas d'informations, et on va même jusqu'à mettre, à droite de la page d'accueil, un encart intitulé "prendre rendez-vous avec un conseiller".
Ca me plaisait bien.
Je me voyais déjà arriver dans un bureau, avec mon dossier sous le bras, m'asseoir devant un(e) fonctionnaire ou assimilé(e) (maintenant, quand on va dans un bureau, la probabilité de parler à une stagiaire prétendant à un CDD de six mois et quatre jours a fortement augmenté...), et apprendre le montant prévisionnel de ma pension, si je partais le 1er août 2018, ou le 1er octobre...
J'ai donc cliqué.
On m'a alors demandé de remplir un questionnaire attestant de mon identité, de mon domicile, du motif de ma demande de rendez-vous, etc. J'ai rempli, l'âme sereine et l'estomac vide (ben oui, c'était, je vous le rappelle, la pause du midi...) tous les renseignements demandés.
je suis donc passée à l'écran suivant, qui vérifiait les renseignements fournis à la page précédente. Quelle conscience professionnelle, me disais-je in petto, remplissant ligne après ligne et consciencieusement tout ce que l'on me demandait...
Et je suis passée à l'étape suivante, la trois, qui s'intitulait "Chosir votre lieu de rendez-vous".
Là, il n'y avait rien.
sauf un choix "autre lieu de rendez-vous", qui semblait déplacé, puisque je n'avais encore rien choisi...
J'ai quand même cliqué dessus, puisqu'il n'y avait rien d'autre. Que ceux qui n'auraient pas fait comme moi lèvent le doigt !
On m'a répondu qu'il n'y avait pas d'autre lieu de rendez-vous...
Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber et suis allée me rassasier, mais enfin j'étais mécontente, car si mon estomac était calmé, ma légitime curiosité sur ce qui allait m'arriver, elle, ne l'était pas.
Alors j'ai poireauté un peu et, à une heure décente, soit 14 heures, j'ai rappelé au téléphone la CARSAT.
Je suis évidemment tombée sur le même répondeur que le matin, avec aucun des choix ne me convenant. Or, prise d'une subite inspiration, j'ai décidé de patienter au bout du fil après l'annonce enregistrée qui me conseillait, après tous les autres choix et pour la modique somme de 0,75 euros la minute, de retourner sur le site internet.
C'est un tuyau que je vous donne confidentiellement : accrochez-vous quelques minutes après les annonces enregistrées, et, ô joie, vous entendrez une voix humaine en direct.
un vrai être humain, constitué comme vous et moi !
et qui vous répond avec un vraie voix...
Pour vous annoncer, un peu gênée, que la CARSAT ne donnne pas de rendez-vous avec un conseiller.
Comment ça ?
Béh non.
Mais encore ?
Non, vous dis-je.
Mais pourquoi, alors, le site, et l'encart, et les renseignements, et les étapes, et les beaux écrans ?
Ah, ça ?
....
Ca, c'est parce que le site est national, et que les agences CARSAT sont régionales. Et l'agence régionale ne donne pas de rendez-vous avec un conseiller...
J'ai senti ma digestion se bloquer d'un coup. Ce n'était pas que j'étais contrariée. C'est juste que je trouvais que la CARSAT était une belle enfoirée, que je sentais que la personne qui me répondait foireusement n'allait certes pas partager mon indignation (surtout qu'on risquait, d'après le répondeur, d'être enregistrées...) et qu'éberluée, j'apprenais qu'il me faudrait faire les simulations moi-même, ou bien attendre les bulletins envoyés de façon systématique mais tous les cinq ans (c'est-à-dire en 2021 pour un départ prévu en 2017-2018 !!!), ou bien lui donner les éléments là maintenant mais de toute façon je ne saurais que le montant correspondant à ce que j'avais fait dans le privé... Pour le public, c'était ailleurs (mais pourtant, j'avais bien reçu par la poste un récapitulatif complet, privé + public, non ?)
A l'heure où je vous écris, je ne sais toujours pas le montant estimatif de ma pension de retraire, s'il me venait à l'idée de partir le 1er août 2018...
Mais je continue à payer tous les mois, bien entendu.
Soupir.