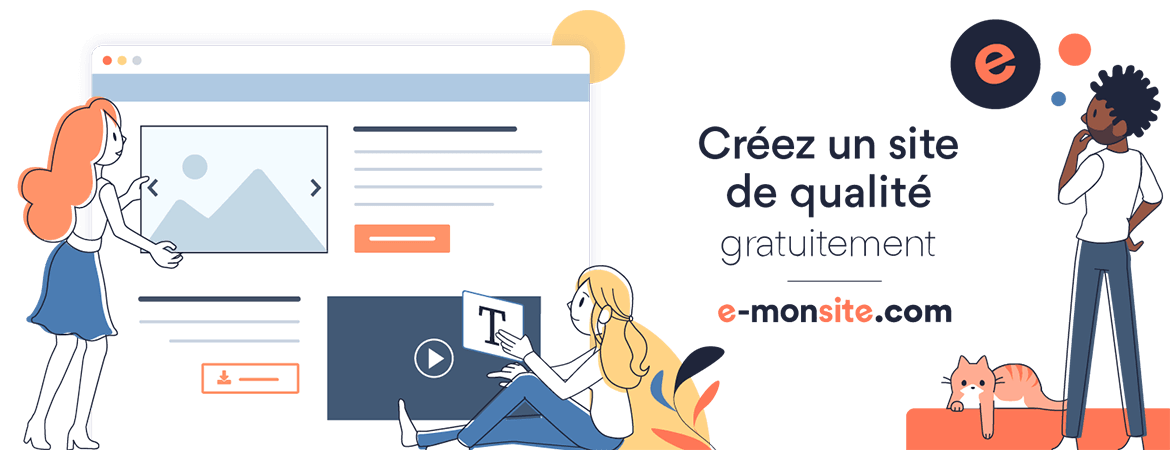Mes textes
100% Clopine
Me voici toute encouragée...
- Par clopine
- Le 27/01/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
J'ai reçu un superbe message de mon amie Véronique Aubouy, la cinéaste qui a consacré une partie de sa vie à Proust, et qui a réalisé un film expérimental d'une beauté troublante (comme son sujet), intitulé "Je suis Annemarie Schwarzenbach".
C'est la magie du net (et de Marcel Proust) qui nous a liées elle et moi, car sans cela, je n'aurais jamais eu la chance de la rencontrer. Et c'est aussi, bien sûr, la seule vraie "pro du cinéma" de mon entourage : c'est dire si son avis compte pour moi, et pour Clopin.
Or, elle est carrément enthousiaste au sujet "Des racines et des haies" !!!
Oh, j'entends d'ici les vilaines petites voix malveillantes qui vont mettre son avis positif sur le compte de son amitié et de sa gentillesse, histoire de me décourager... Mais ce n'est pas vrai. C'est vraiment sincèrement qu'elle nous félicite, et la preuve en est : elle nous donne un conseil qui est un des plus pertinents que j'ai entendus jusqu'ici.
Pertinent, et vertigineux...
Ecoutez plutôt :
Louis et Giono...
- Par clopine
- Le 23/01/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Tout sépare ces deux-là, et pourtant : l y a dans les notes sur l’affaire Dominici l’analyse parfaite de la violence que le langage fait subir aux êtres. Gaston n’a pas les mots du juge, et Giono, qui connaît parfaitement les deux langages, le paysan et le judiciaire, note tous les quiproquos, tous les « à-côtés » qui font que l’innocent va devenir coupable.
En ce sens, (en ce sens seulement, certes, mais pourtant !) le travail d’Edouard Louis rejoint celui de Giono : ils démontent tous deux cette violence sociale inouïe sous-jacente au langage…
Une amie qui lit la « vie catholique » (! En mémoire de sa mère !!) et qui connaît mon athéisme enraciné m’empêchant à tout jamais d’acheter l’hebdomadaire confessionnel), m’a envoyé l’interview du jeune Edouard. Notation d’icelui, que je trouve parfaitement juste (mais que je reproduis de mémoire, vous m’excuserez donc) : « la société des hautes classes sociales trouve formidable le langage populaire, ses images, ses trouvailles, son charme – mais quelqu’un qui parle comme parle le personnage de « ma soeur » dans mon livre se fait immanquablement blakbouler au premier entretien d’embauche… »
Perso, j’ai vécu cela à l’hôpital, où je partageais la chambre avec une jeune fille en droite provenance d’un foyer de la DASS : c’était pathétique, parce que la jeune fille n’avait pas l’air bien malade, et que je soupçonne qu’elle avait joué, non pas la comédie, mais qu’elle avait accentué ses symptômes (nous étions dans la section de gynécologie) pour se retrouver là et donc avoir un prétexte pour que son éducateur prévienne sa mère.
l'état des lieux
- Par clopine
- Le 20/01/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Cette maison était née d'une utopie : celle du "retour à la terre" et du rêve d'autarcie des enfants de 68. Mais si ce genre de projets avient inéluctablement vocation au délitement, la maison, elle, était toujours là.
Dès l'entrée en possession, les trois compères qui s'étaient unis, jeunes et sans un rond, pour l'acheter, avaient commencé les travaux. Et, en quelque sorte, ces travaux n'étaient pas terminés, ne seraient jamais terminés. Mais les deux femmes pour qui les maisons avaient été construites (car trois années avaient été consacrées à faire naître, du néant d'un champ, une impressionnante longère, plus solide, plus vaste encore que la première. Et les deux maisons cohabitaient, comme pourraient cohabiter une mère et sa fille), ces deux femmes n'étaient plus impliquées dans cette vie interne des maisons : les travaux continuaient encore, et encore, mais un peu à la manière du canard, qui continue à courir avec la tête tranchée...
C'était donc bien plus qu'une maison que je devais affronter. C'était une histoire, un projet, une union avortée. J'étais bien trop angoissée par mes réactions à la situation que j'avais pourtant acceptée, mais que je n'acceptais plus, (à savoir élever mon enfant loin de son père), pour comprendre que la Maison avait besoin d'une proie, pour continuer à susciter, année après année, l'élan laborieux qui présidant à ses embellissement ; ce que je ressentais confusément, par contre, c''est que je n'étais pas chez moi.
Tout ici m'était pénible, et difficile. Je venais de passer quelque vingt ans dans la grande ville, où les portes s'ouvraient grâce à des vigicodes, où les tiroirs des placards de cuisine, munis de roulements à bille, s'ouvraient et se fermaient du bout des doigts, où la chaleur provenait de l'électricité ou du gaz, sans qu'on se pose plus de questions que cela. J'arrivais dans une maison qui gardait encore la rudesse des habitats paysans d'antan : j'avais, en réalité, tout à apprendre...
(suite à demain)
Rivalité (le complexe de Manderley)
- Par clopine
- Le 19/01/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Dans les années 70-80, il ne faisait pas bon évoquer, comme relevant de votre personnalité, des sentiments de jalousie ou de rivalité. La sentence tombait illico, accompagnée d'un regard méprisant : "la jalousie, c'est rien que de la peste émotionnelle chez les petits-bourgeois". On était sensés être tous égaux, libérés, en accord profond avec nous-mêmes et désirables à hauteur égale (ce qui permettait d'ailleurs à quelques petits sournois, en loucedé, d'en profiter un maximum. Il suffisait de ne pas être trop regardant avec l'hypocrisie...). Bien entendu, à partir de là, "que le meilleur gagne" : les plus coriaces des égocentriques remportaient souvent le morceau...
Cependant, aussi stupides et dénuées de toute vérité psychologique qu'aient été les idéologies de ce temps-là, elles avaient au moins le mérite de tenter de changer les rapports des uns aux autres. Ce n'était pas leur faute si la réalité a la vie dure, et si les combats les plus cruels utilisent parfois, simplement, pour armes, les mots...
Ce jour-là, je remontais en frissonnant l'allée qui menait à la longère brayonne où j'étais sensée vivre désormais. A main droite, un panier, contenant un chat. A main gauche, un enfant, qui serrait ses doigts dans mes paumes, et qui était très certainement le meilleur passeport possible pour franchir le seuil de cette demeure, où on allait, sans cesse, me demander mes papiers...
Je n'étais pas d'un tempérament particulièrement jaloux. Il me semblait tout simplement que j'étais "en-dessous" de la jalousie. Je n'arrivais jamais à "revendiquer" une affection, encore moins une quelconque "exclusivité" de sentiments. Je n'étais tout bonnement pas à la hauteur de moi-même. Alors, venir vivre "chez une autre"...
C'était pourtant ce qui était en train de m'arriver. Je me souvenais de "Rebecca", de Daphné du Maurier, et j'éprouvais le complexe de Manderley, de celle qui n'est pas à sa place, qui n'est pas chez elle, parce qu'elle est chez l'autre. Et encore : chez Du Maurier, la première est morte, et c'est juste son souvenir qui torture la seconde. Dans mon cas, rien n'était éclairci, au nom de la bonne vieille idéologie baba qui voulait qu'on devait tout partager...
C'était tout simplement une horreur à vivre, mais cela n'était rien encore. Car il me faudrait, afin de pouvoir survivre, non seulement comprendre ce qui m'arrivait et tenter de résoudre les équations mortifères dont résultait la cohabitation, mais encore discerner que mon vrai problème n'était pas la femme qui résidait (encore) là, et qui elle aussi avait un enfant de l'homme qui nous réunissait ainsi, sans que nous l'ayant un seul instant souhaité, toutes deux.
Non, mon vrai problème, mais je n'allais l'apprendre que petit à petit, c'était elle.
Elle.
La maison.
Cette longue longère au lourd toit d'ardoises d'un bleu-gris changeant, ces murs de torchis, ces fenêtres fermées de volets de bois, ce jardin potager qui s'étendait à droite et à gauche de l'allée empierrée comme une déclaration, cette porte massive, peinte en bleu et fermée à clé, car il fallait passer par une autre porte pour entrer : elle me regardait arriver, cette maison-Manderley, et si je ne l'avais pas pressenti, elle allait bien entendu mettre les choses au point : car ma vraie rivale, c'était elle.
(suite à demain)
Un chien en hiver
- Par clopine
- Le 17/01/2016
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Promenade hivernale avec Ti'punch, ce matin. J'ai vu, il y a des années, des dessins de jeunesse de Van Gogh qui étaient caractéristiques de cette ambiance : la froidure, les tons assourdis, quelques flocons de neige, les flaques luisantes et grises... Et un chien batifolant à loisir là-dedans, levant les lièvres et guettant les écureuils...
J'ai toujours un peu pitié de ces maîtres qui ne peuvent se passer d'une laisse, en promenade, comme s'ils craignaient une fuite. La relation entre mon remarquable chien et moi-même est bien plus forte que n'importe quel collier, n'importe quelle laisse. Et c'est de lui-même, désormais, sans que j'ai même besoin de le rappeler, que Ti'Punch revient vers moi pour se faire attacher (symboliquement, je me contente souvent de poser la main sur lui, et il reste ainsi immobile), quand un piéton ou un cycliste nous croise...
Je repensais à ce lien exceptionnel qui relie le chien à l'homme, hier, en revoyant, chez des amis, notre premier documentaire "la Bergère et l'Orchidée". Cinq ans ont passé, mais le portrait de Jeanne a gardé sa fraîcheur. Et je suis toujours aussi épatée par sa prestation : elle marche, devant, à son rythme, le bâton à la main. Toute la troupe "ed'moutons" suit derrière, comme un seul homme. Pas un qui déborde, qui la dépasse, qui s'égaille à droite, à gauche. Certes, il y a les chiens, qui travaillent avec elle, et contiennent le troupeau. Néanmoins ! Quiconque a eu affaire, même une seule fois, à quelques moutons, ne peut qu'être impressionné par la maîtrise absolue de cette femme, silouhette engoncée, l'hiver, dans une doudoune unisexe qui la rend comme invisible, alors que c'est l'acuité de son regard, sa relation aux bêtes, son endurance et sa fabuleuse maîtrise qui sont les seuls garants de son troupeau...
Dans le film, il y a une scène où un de ses chiens déclare son amour à Jeanne, qui en est presque gênée devant la caméra. C'est ce genre de modestie affective qui me va droit au coeur - portée, en plus, par un regard d'un bleu céleste,qui éclaire d'un seul coup un visage passé, ridé mais souriant...
Non, Clopin a raison, nous n'avons pas à rougir de ce premier essai. Si c'était à refaire, seule la construction du film serait bien plus soutenue. Mais Jeanne continuerait à l'éclairer de l'intérieur...
(à part ça, Clopinou a été tellement abasourdi de ce qu'il lit, sur les réseaux sociaux, à propos d'Edouard Louis, qu'il a décidé de répondre et de défendre le jeune auteur. Clopinou, c'est mon fils à moi ça.)
Signe Extérieur nuit...
- Par clopine
- Le 15/01/2016
- Commentaires (2)
- Dans Mes textes
Entendu Delphine Horvilleur, femme-rabbin, sur France Cul ce matin : "toutes les religions ont des signes ou des symboles, mais la valeur de ces signes n'est pas la même. La kippa est un signe parfaitement compatible avec les valeurs universelles, puisqu'elle signifie que l'Homme est petit devant Dieu, avec majuscule, c'est-à-dire avec l'acceptation "être humain qui croit en dieu". La burqa, elle, signifie que la femme est petite devant l'homme. Ele n'est donc pas compatible avec les valeurs universelles..."
Quand le journaliste bronche et lui demande alors pourquoi les femmes juives se voilent-elles les cheveux, si ce n'est en signe de soumission aux hommes, Horvilleur botte en touche : "oui, c'est vrai, il faut que les religions, et pas seulement le judaïsme, revoient la place qu'elles accordent aux femmes, et plus généralement la place faite à l'altérité (homosexuels, convertis, étranger)"...
Je trouve que tout ceci est spécieux. La grande majorité de mes collègues, par exemple, portent des croix catholiques, solidement accrochées à leur cou et apparentes (par-dessus les vêtements). Si l'on accepte ceci, pourquoi refuser cela ?
La burqa est interdite dans l'espace public. J'aurais comme une tendance à interdire tous les signes religieux, sans distiinction. Et s'il existait un signe, un symbole d'athéisme, l'interdire aussi par là-dessus.
Parce que ce que je crois ou ne crois pas n'appartient qu'à moi... Et que si j'ai le droit d'exprimer mes croyances ou incroyances, je partage l'espace public pysique. Cet espace devrait donc être, dans mon esprit, dégagé de toute expression ostentatoire des uns ou des autres...
Quant à l'espace public immatériel... Ah là là... Ce vaste foutoir qui, au nom de la liberté d'expression, permet toutes les dérives... Il pose le problème le plus crucial de notre temps, à mon sens, et je n'ai aucune réponse valable à apporter, sinon le respect strict de la loi en la matière. Loi bafouée tous les jours que le bon dieu ne fait pas !
Du danger des invitations...
- Par clopine
- Le 14/01/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Je devrais commencer à me préparer pour le week-end de l'ascension 2016. Or, je n'en fais rien. Je m'étais promis, pourtant, de mobiliser bon gré mal gré Clopin ou Clopinou, voire n'importe quel passant de Beaubec me tombant sous la main, pour "tester" la prestation que m'a demandée Véronique Aubouy, dès le mois de décembre, ou pendant les fêtes. Et nous voici à mi-janvier - et je n'ai même pas encore rouvert mon vieux pléïade à la couverture toute pourrie désormais...
Il s'agit pourtant d'un truc absolument fabuleux pour quelqu'un comme moi : à savoir que je dois jouer, en mai prochain, le rôle de "narratrice", en quelque sorte, dans un film sur Proust et les châteaux aristocratiques, film qui doit être tourné à Trévarez, et pour lequel Véronique a eu la gentillesse de penser à moi.
C'est un vrai cadeau, parce que Trévarez, c'est CECI (excusez du peu !), et que je suis sensée raconter un épisode de Sodome et Gomorrhe, la soirée chez la princesse de Guermantes où le narrateur n'est pas bien sûr d'être invité...
Or, c'est une scène qui me va bien, parce qu'au fond, moi non plus je ne suis pas bien sûre d'avoir été invitée... Non à une soirée mondaine, mais bien plus fondamentalement : à la vie, tout simplement. A vivre...
Nous sommes quelques uns dans ce cas, qui nous rend parfois difficiles à comprendre aux yeux des autres, des légitimes...
J'emploie le "nous" : il me semble en effet qu'il y a là comme une communauté qui, bien que non déclarée, existe cependant. Je ressens parfois une sorte d'attirance-répulsion vers telle ou telle personne, anonyme ou connue... Et, comme par hasard, j'apprends souvent que cette personne, elle non plus, n'a pas reçu la bonne invitation, à son entrée dans ce bas-monde. Depardieu, tenez, en est un bon exemple. Le mélange de force et de douceur qui émane si étrangement de lui est-il dû à ce déséquilibre, qu'il nous faut sans cesse compenser ?
Allons, je ferai mieux d'arrêter de divaguer et de me concentrer sur la tâche que l'on m'a assignée. Donc, commençons : "Je dois me rendre chez la princesse de Guermantes, et je ne suis pas bien sûre d'y avoir été invitée...."
Le cadeau le plus extraordinaire...
- Par clopine
- Le 12/01/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Je vais vous raconter l'histoire du cadeau le plus extraordinaire jamais reçu, et un de ceux qui m'ont fait le plus plaisir, à part évidemment ceux dûs à la nature (un bébé, des animaux, des fleurs, des fruits, des arbres et des branches...).
Je l'ai reçu au lendemain d'une soirée non pas "banale" mais disons "ordinaire" - de celles qui nous arrivent parfois, ou même souvent, à Beaubec...
Ces soirées-là se passent souvent en juin, et se déroulent sous la vigne, juste devant le potager - enfin, je dis "le potager", mais c'est surtout une "déclaration" : pour arriver à la maison, il faut le traverser, et ce qui est signifié là, c'est déjà un mode de vie. Non que nous soyons les seuls à avoir un potager, m'enfin, nos voisins, souvent, relèguent la chose à côté, ou derrière leurs maisons, ou l'entourent d'une petite haie... Clopin, lui, l'affirme catégoriquement : sa terre produira les aliments dont nous nous nourrirons.
Donc, dans les assiettes, à Beaubec, on trouvera souvent les légumes aperçus en arrivant, et qui sont bien entendu d'une qualité supérieure à celle du commerce. Je n'en suis pas plus orgueilleuse, parce que tout cela, les tomates pleines de saveur, les fèves, les carottes et les salades, les pommes de terre et les haricots, les petits pois et les concombres, les navets et les courgettes, les légumes-racines et les légumes-feuilles, tout procède de Clopin, et si peu de moi...
Ma partie, c'est la cuisine, et avec le temps, (et le plaisir de recevoir les copains), j'ai acquis une certaine maîtrise de la chose
. Et puis c'est ma façon de donner, à moi.
Donc, ce soir-là, la table était gaiement mise sous la vigne, et nous recevions trois amis : Philippe J., et sa compagne, qui étaient venus accompagnés de leur ami Victor...
Je connais Philippe depuis trente-cinq ans au bas mot, et j'ai toujours trouvé de l'intérêt à sa conversation. Pourtant, son univers est très différent du mien : ensiegnant-chercheur en mathématiques à l'université, guitariste accompli, motard (d'énormes motos anglaises et classieuses, la dernière était d'un vert chou très particulier), professeur d'aïkido et adepte d'une certaine réserve devant les idéologies de son époque, rien ne le rapproche a priori (sinon des utopies passées, que nous avons vécues ensemble) de la sorte de cas définitivement à part que je suis... Et pourtant : c'est toujours un vrai plaisir de le recevoir.
Surtout s'il vient avec sa compagne, et Victor...
Les fragilités de Clopin
- Par clopine
- Le 11/01/2016
- Commentaires (2)
- Dans Mes textes
Jamais, plus qu'hier, je n'avais ressenti la fragilité de Clopin en face de la maladie et de la mort. Depuis le décès de son père, ce qui était une répugnance est devenue (presque) une phobie : hier encore, deux amies évoquaient Parkinson, ou Alzheimer. Clopin s'est enfui de la pièce...
Je pense que c'est d'avoir accompagné son père jusqu'au bout, perdant du même coup le statut de fils pour devenir, par obligation, celui qui prend en charge, qui ne lui permet plus d'évoquer la déchéance. Ceci, joint à la troublante ressemblance physique qu'il développe maintenant avec notre défunt Papy, m'amène à vouloir relire les sublimes pages que Proust accorde au phénomène, qui, dans la Recherche, transforme la mère en grand'mère, après la mort de cette dernière.
Je ne crois pas, pour ma part, (je suis même sûre du contraire) ressembler désormais à ma mère (encore moins, et pour cause, à mon père). Peut-être parce que ma mère est partie alors que j'étais encore jeune, égocentrique, en construction ?
Peut-être est-on plus fragile vis-à-vis de la maladie, la déchéance, la mort, quand on est un vieil orphelin ?
Je ne peux pas protéger Clopin, pourtant, à l'aube de notre vieillesse, de ce genre de sujet de conversation : j'ai bien peur qu'elle ne se renouvelle de plus en plus, au fur et à mesure que nous irons. Mais comment parler légèrement de ce qui est réellement effrayant ? Pour ma part, j'ai lu Montaigne, et suis persuadée que "La mort est le sort commun des hommes, et c'est folie de n'y pas penser, ou de le la représenter comme une chose lointaine." Mais sans doute, pour y penser journellement, vaut-il mieux le faire seule, et ne pas trop s'y attarder.
L'art est le seul mensonge qui dit la vérité
- Par clopine
- Le 09/01/2016
- Commentaires (3)
- Dans Mes textes
J'ai écrit hier cette phrase chez Assouline : elle m'avait été inspirée par la lecture de "Histoire de la violence" d'Edouard Louis - ce titre est d'ailleurs, à mon avis, assez inadéquat, et c'est à peu près le seul reproche que je ferai à l'ouvrage... Bon, une simple recherche sur internet m'a permis de constater qu'évidemment, je n'étais pas la seule à l'avoir eue : Bergson, entre autres, l'a émise bien avant moi.
Mais pourtant, c'est pour moi la conclusion et surtout le message du livre dont je viens de finir la lecture : parce que Louis a réussi la prouesse de dépasser, dans ce second livre, le tour de force du premier "En finir avec Eddy Bellegueule". Enfin, à mon sens, bien sûr, c'est-à-dire au point de vue littéraire, en tout premier lieu.
"En finir avec Eddy Bellegueule" était non seulement un ouvrage "terrible" au niveau du récit de ce qui y était raconté, mais encore un livre "polyphonique" où plusieurs langages se cotôyaient : celui, trivial, violent, populaire de la famille lumpen-prolétaire du narrateur, mais aussi une langue presque savante, bourdieusienne, qui venait mettre en quelque sorte la grille d'analyse de la sociologie sur l'histoire : moitié-pansement, moitié-réquisitoire. Personnellement, je n'avais jamais vu une pareille entreprise : un tout jeune homme utiliser sa propre histoire en tentant de la comprendre par une science toute nouvellement acquise. Il y avait du savant qui s'auto-inocule un prototype de vaccin dans l'entreprise. Et une telle violence relatée, pour peu que l'on soit sensible à la souffrance, même et surtout quand elle n'est PAS revendiquée (je veux dire quand on ne convoque PAS le pathos pour provoquer la compassion du lecteur), mais simplement racontée "pour ce qu'elle est" : une sorte de malheur inévitable, ne peut que provoquer chez le lecteur un intérêt passionné (et dans mon cas, quelque peu maternel : mon Clopinou a l'âge d'Edouard Louis...)
Je n'étais donc déjà pas d'accord avec les critiques d'"En finir avec...", qui fustigeaient d'une part, la manière dont l'auteur "vendait" sa famille en racontant des "turpitudes" sur elle, et d'autre part, sur l'accusation de "racolage" qu'on formulait ici ou là : Louis aurait volontairement et avec complaisance exploité l'espèce de martyr qu'il avait subi dans son enfance pour appâter le voyeurisme du lecteur.
Il me semblait que ces critiques en disaient beaucoup plus sur la langue de bois du politiquement correct ("ne jamais dire que le populaire peut être ignorant, violent, grossier et mortifère, parce que c'est "le peuple") et sur les fantasmes et phobies que l'homosexualité fait naître, après des siècles de tabou ("un homosexuel est forcément un être vil dont les motivations sont bien entendu tordues, blamâbles, entre exhibition et envie d'acquisition du pouvoir"), que sur les lignes que j'avais lues, et dont l'harmonie était évidente. Quand un livre aussi dense, construit d'une manière si étonnante, se lit en plus avec une facilité qui provient de la limpidité de l'écriture, on peut sans guère se tromper estimer qu'il ne s'agit pas là de quelque chose d'intéressé ou de volontairement scandaleux, mais plutôt : d'une vraie littérature...
Néanmoins, c'était avec quelque inquiétude que j'attendais le second livre du jeune homme. Je savais qu'il s'y servirait d'un sordide "fait divers" dont il avait été victime. Il était évident (surtout après un épisode politique, assez malheureux et maladroit, où Louis avait tenté de censurer une conférence d'un intellectuel "de droite", ce qui n'est jamais le bon moyen pour contrer une parole. Ce n'est pas en tentant de fermer un robinet que vous empêchez l'eau de couler sous les ponts...) qu'il serait mal accueilli par tous ceux qui avaient déjà "éreinté" le premier ouvrage...
Et ça n'a pas loupé...
Au nom d'Edouard
- Par clopine
- Le 06/01/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Dès la parution de son nouveau livre, "Histoire de la Violence", la tempête se déchaîne. Un article absolument scandaleux dans le Magazine Littéraire, qui cumule à peu près tout ce qui se fait de pire dans le genre critique - attaques personnelles visant l'homme et non l'oeuvre, insinuations fondées sur des a priori comme la volonté de "racolage" de l'auteur, petites saloperies à droite à gauche comme de désigner l'ancien nom de l'écrivain (il s'appelait "Bellegueule" et son premier livre explique mieux que tout pourquoi il a changé de nom) comme le "vrai", affirmations gratuites (Edouard Louis ne ferait rien d'autre que "mal digérer Bourdieu", alors qu'il est carrément à l'ENS de sociologie, bref !), mépris à tous les étages (le livre ne serait qu'une autofiction pathétique, le genre de l'autofiction serait lui-même une bâtardise) : n'en jetez plus, la cour est pleine (d'excréments).
Je ne peux pas charger le livre sur ma liseuse, donc je ne peux rendre compte de ma lecture, je me promets pourtant d'y parvenir. Cependant, la violence des réactions me semble proportionnelle à la superbe insolence d'Edouard Louis. Transfuge de classe, il aurait pu adopter l'attitude respectueuse du prolétaire pétrissant sa casquette et baissant le nez devant "not'bon maître". Il n'en est rien : il a fustigé une conférence présidée par Marcel Gauchet - et même s'il s'est trompé d'attitude, en tentant de faire exercer une censure qui est toujours un tort, il avait néamoins raison sur le fond. Il est jeune, et il emmerde tous les homophobes de la terre. Et plus tous se déchaînent contre lui, plus il m'est sympathique...
Vas-y Edouard ! Et continue d'écrire EN TON NOM !!!
Hiver ?
- Par clopine
- Le 30/12/2015
- Commentaires (2)
- Dans Mes textes
Drôle d'hiver
Mi-vert
Envers
et contre tout :
Attente !
La poésie, c'est rien que du cinoche...
- Par clopine
- Le 29/12/2015
- Commentaires (2)
- Dans Mes textes
 Comme tout le monde, c'est à l'école que j'ai appris mes premières poésies, et c'est en classe qu'on m'a "expliqué" ce que c'était qu'un poème...
Comme tout le monde, c'est à l'école que j'ai appris mes premières poésies, et c'est en classe qu'on m'a "expliqué" ce que c'était qu'un poème...
Or, plus je vais, moins je suis d'accord avec ce que l'on m'a appris. Oh, bien sûr, "de la musique avant toute chose" : ce n'est pas un professeur qui l'a dit, mais bien Verlaine ; pas question donc de remettre ce prédicat en question. Mais cependant, le reste...
Tenez, prenons un des plus célèbres poèmes de Rimbaud : le dormeur du val. Archétype de la poésie apprise et analysée en classe (la pauvre !). C'est donc ceci :
C'est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Qu'est-ce que j'ai appris à son sujet ?
Il semblerait bien....
- Par clopine
- Le 28/12/2015
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Il semblerait bien que je dispose maintenant, par la grâce de Clopin et de son fils aîné, d'un nouvel espace où déposer mes élucubrations, pensées diverses et en vrac, bavardages, parlottes, divagations et autres considérations. Dont acte. Cela faisait deux ans que j'attendais ça, mais un tour du monde, un peu de procrastination et une ombre, oh, juste une pincée de mauvaise volonté aidant, nous y voici...
Donc, merci ! Je ne serais sans doute jamais arrivée, sans eux deux, à me sortir de l'ornière "overblog" : payer pour ne pas avoir à subir de la pub, et payer pour un service moindre que lorsque c'était gratuit ! Avis à la population : fuyez overblog, à toutes jambes, à tous claviers azertys...
Bien, le temps de prendre la main sur cet espace et je reviens. Je connais déjà le sujet de mon premier "vrai" billet ici : poésie et cinéma !
Ah, et puis, tout de suite, message aux trolls : j'ai désormais la possibilité de choisir mes lecteurs et les éventuels intervenants de cet espace... A bon entendeur, salut, et bonjour aux autres...
Clopine revenue.
Combien de « T », dans Télérama ? Un, deux, trois ???
- Par
- Le 26/12/2015
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
La journée d’hier, bousculée, tirée à heu et à dia entre plusieurs contraintes contradictoires, ne me laissait guère espérer être devant mon poste, à 22 h 05 pétantes. Pourtant, j’y étais, étonnée certes d’être là, avec un petit arrière-plan de remords (j’aurais d^u être ailleurs, certainement) mais bien décidée à en profiter !
Faisant partie de la grande tribu des « gouldeusiennes », j’avais tout pour être une téléspectatrice comblée. Une signature, Monsaingeon, évoquant un travail ému et rigoureux (je me souviens d’un Pablo Casals plus que pertinent). Des archives inconnues, des citations provocatrices tirées du Journal de Glenn Gould (ah ! Les poils blancs de sa chienne sur son premier pantalon de concert !), et quelques rediffusions de Bach où le génie des deux hommes, l’auteur et l’interprète, vous empoigne comme un vent d’octobre, violent et suave à la fois…
Tout pour être heureuse…
Ti'Punch, chien à câlins - 8/6/07
- Par
- Le 26/12/2015
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Bon. Il faut se rendre à l’évidence : nous n’aurons jamais de chien de ferme, comme on l’entend par ici, c’est-à-dire soit la pauvre créature hargneuse, s’étranglant à aboyer au bout d’une chaîne dès que quelqu’un pénètre dans la cour, soit, en version plus aimable mais faut pas s’y fier de trop près, en version « près de son maître », chien ne quittant pas d’une semelle le patron et n’accordant qu’une vague indifférence au reste du monde.
 Quant à avoir un chien à moutons, il faut y renoncer aussi. Julot, notre aristocratique border-colley, avait beau descendre directement des premiers prédateurs, les loups donc, il ne faisait que fixer ses yeux jaunes sur les moutons, plein d’appréhension, et semblait à jamais incapable de les affronter. Ti’Punch, notre nouveau chien, un croisé border-labrador, développe certes un peu plus d’agressivité (grâce à moi, qui ai voulu l’habituer tout petit pour éviter l’échec julotien) . Mais à y regarder de plus près, il s’agit surtout, pour lui, de courir à fond de train, de tourner autour du troupeau en battant de la queue, de croire que si les moutons se mettent eux aussi à courir c’est juste pour jouer avec lui, de provoquer la brebis en charge du maintien de l’ordre et de revenir, quand cela lui chante, avec la langue rose et pendante de deux bons tiers, l’air étonné : « Comment ça vous m’appelez depuis un quart d’heure ? Comment ça je ne dois pas faire courir les bêtes ? Mais je n’ai rien compris, moi.. De toute manière je ne peux pas penser à tout et être partout, parce que je n’ai que quatre pattes.. »
Quant à avoir un chien à moutons, il faut y renoncer aussi. Julot, notre aristocratique border-colley, avait beau descendre directement des premiers prédateurs, les loups donc, il ne faisait que fixer ses yeux jaunes sur les moutons, plein d’appréhension, et semblait à jamais incapable de les affronter. Ti’Punch, notre nouveau chien, un croisé border-labrador, développe certes un peu plus d’agressivité (grâce à moi, qui ai voulu l’habituer tout petit pour éviter l’échec julotien) . Mais à y regarder de plus près, il s’agit surtout, pour lui, de courir à fond de train, de tourner autour du troupeau en battant de la queue, de croire que si les moutons se mettent eux aussi à courir c’est juste pour jouer avec lui, de provoquer la brebis en charge du maintien de l’ordre et de revenir, quand cela lui chante, avec la langue rose et pendante de deux bons tiers, l’air étonné : « Comment ça vous m’appelez depuis un quart d’heure ? Comment ça je ne dois pas faire courir les bêtes ? Mais je n’ai rien compris, moi.. De toute manière je ne peux pas penser à tout et être partout, parce que je n’ai que quatre pattes.. »
Julot, le pré et les moutons - 5/3/06
- Par
- Le 26/12/2015
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
II faut bien reconnaître qu'avec les meilleures intentions du monde, Saint-Exupery a beaucoup nui à la cause ovine : quelle idée, cette histoire de mouflet réclamant qu'on lui dessine UN mouton. UN mouton ! Quelle aberration! Même simplement dessiné sur le carnet d'un aviateur, c'est horriblement malheureux, un mouton tout seul ! (presqu'autant qu'un petit prince sans sa rose...) N'importe quel berger vous le dira : une vraie vie de mouton, c'est, d'un, de I'herbe, de deux, dès qu'on lève la tête hors des touffes, la vision de l'autre, du semblable à soi, du tout pareil, en train de faire exactement la même chose que vous, au même moment. II n'y a que cela qui rassure vraiment. Hors du troupeau, point de salut. A la moindre alerte, il faut vite se serrer les uns contre les autres, le nez dans la laine et la bonne odeur de son voisin. S'il faut courir, courir ensemble, tous ensemble, quitte à sauter les uns par-dessus les autres comme des athlètes olympiques, au 110 mètres haies !
 Donc, DES moutons. Voila qui est dans I'ordre des choses. Des moutons, un pré, et un chien, bien sûr.
Donc, DES moutons. Voila qui est dans I'ordre des choses. Des moutons, un pré, et un chien, bien sûr.
A Beaubec, il s'appelle Julot.
C'est un chien de berger, ce qui signifie déborder d'enthousiasme dès que la barrière du pré s'ouvre, s'élancer en prenant tout juste le temps, au bout de dix pas, de jeter un rapide coup d'oeil en arrière pour bien vérifier les intentions du maître (« C'est bien cela ? Je ne me suis pas trompé ? On va bien aux moutons ? » ), redresser fièrement son panache noir, dont le bout blanc viendra caresser son échine au terme d'un arc de cercle presque parfait, et débouler à toute berzingue, en traversant le pré à I'oblique. C'est un vrai bonheur : le vent aplatit les poils autour du museau, les muscles, les pattes, tout obéit à la perfection dans une course parfaite, et les moutons, comme un seul homme (évidemment), se rassemblent en une masse compacte, tremblante, prête à obéir...