l'appel à tartes : 8 et fin.
- Par clopine
- Le 05/08/2016
- Commentaires (2)
- Dans Mes textes
L’appel à tartes (8) : pratiquer le jeté d’éponge.
Avec son accent anglais prononcé qui augmentait encore la bonhomie du personnage, M. Monk (non ! Je ne parlerai pas à sa tête ni à aucune autre partie de son corps, même à la récré !) nous donna ses consignes oulipiennes, d’une simplicité enfantine.
Il s’agissait d’écrire un Haïku, au beau milieu d’une page. On allait commencer par ça, et on verrait après.
Tout le monde connaissait-il les haïkus ? Oui, n’est-ce pas ? C’était court, japonais, ça mélangeait les plans du rapport au monde, et il suffisait surtout de respecter le fameux rythme des trois vers :
5
7
5
Mais ce ne serait pas très grave, même si ça dérapait un peu, parce que le but du jeu allait être, in fine, de mélanger les haïkus produits les uns après les autres, façon shaker, pour goûter la saveur collective et légèrement exotique qui allait en sortir.
Le soupir de contentement qui s’échappa des diverses poitrines, de divers formats, situées autour de moi fut unanime, ainsi que la détente provoquée par l’accessibilité de l’animateur, parlant à toutes, demandant les prénoms, et prodiguant conseils et encouragements…
Et toutes se mirent avec ardeur au travail, se permettant même quelques plaisanteries… Des journées pareilles, clôturées comme le voulait la tradition, en début de soirée, par un apéro-spectacle (nos animateurs se mettant scène deux par deux voire tous à la fois, comme le jeudi soir, pour des séances hilarantes façon « papous dans la tête »), réalisaient enfin les promesses du menu qui m’avait amenée jusqu’ici, m’asseoir à cette table.
Sauf que j’en sortis, sans rire, les larmes aux yeux.
Oh, pour une fois, ce n’était pas le froid glacial de l'animateur, ni un « bon conseil » donné par une personne à qui je n’en demandais pas, ni même une phrase de rejet, ni même un haussement d’épaules qui m’empêchait de partager la liesse collective.
C’était le haïku.
Moi qui, par plaisir, griffonne parfois sonnets et madrigaux, et qui peut produire des alexandrins comme une poule de Gournay pond des œufs (elles sont réputées pour ça), j’ai un sérieux, mais alors, un sérieux, hein, vraiment très sérieux problème avec les haïkus.
Et pourtant ! La « musique de l’impair » verlainienne m’est familière… Et mon surnom l’indique : mes quelques problèmes pédestres, sur cette terre, me permettent, surtout dans les escaliers, de claudiquer à tous les rythmes imaginables.
On aurait pu donc croire que, pour écrire un « simple » haïku, il me suffirait de monter ou descendre, en imagination, un escalier tournoyant sur lui-même : cinq marches, une pause, sept marches, une pause, cinq marches, le palier.
Eh bien cela m’était tout simplement impossible.
Sans rire.
Pendant que mes camarades, impatientées, me regardaient biffer des feuilles entières de débuts de phrases, et prenaient très certainement mes difficultés (qui retardaient, une fois de plus, « tout le monde » ) pour une nouvelle démonstration de singularité voulue, vaniteuse et imbécile, pendant que l’animateur me soufflait qu’il me suffisait de prendre des mots, sans trop me soucier ni du sens ni de l’effet, qu’il fallait que j’oublie tout ce que pouvait comporter, comme sens plus ou moins sublimés, le concept même du haïku, bref, que je n’avais qu’à faire n’importe quoi et que ça irait très bien comme ça, je soufflais comme une baleine, croisais et décroisais les doigts, tambourinais sur la table pour compter mes pieds, et finissais par tout raturer.
J’en appelai à la Fontaine, que je tiens pour le maître absolu de l’aisance rythmique :
« La Cigale, ayant chanté » ( youpi !!! 7, indiscutablement !!!)
« tout l’été » (noooon… 3, seulement 3 !!! )
Je pensais simultanément à quatre, six, huit phrases à la fois, je tentai de me dépêcher, mais le verdict tomba aussi verticalement que la lame du bon docteur Guillotin sur les vers d’André Chénier.
Je n’étais capable que d’écrire des bouts de phrases de quatre, six, huit pieds, ou autre, mais aucun de cinq, ni encore moins de sept.
Point final (3). Impossibilité absolue (9). J’ai envie de vomir (6).
« On « me conseilla (toujours sans que j’eus sollicité quoique ce soit), de faire des alexandrins et d’en prélever des bouts : mais j’étais devenue trop paniquée pour ça, et retournais à mon pitoyable résultat :
« Trop difficile (5, et encore, avec l’indulgence du jury, si on veut bien quoi)
Je n’aime pas le Japon
Ni non plus souffrir »
Il fallut bien s’en contenter, et je passais le reste de la matinée à faire semblant de participer, tout en me demandant ce qui avait bien pu m’arriver.
Certes, je ne suis pas foutue de manier des baguettes pour manger mes nouilles yakisoba à la sauce au gingembre, je ne raffole pas non plus des sushis, ni d’ailleurs de la civilisation japonaise, en gros, et en particulier sa constante propension à construire des centrales nucléaires sur des zones sismiques. Je reste si froide devant un jardin zen que j’en viens à réclamer une petite laine, n’ai vraiment aimé, du mont Fuji, que la scène de « lost in translation » où il est transformé en trou de golf, et je n’ai aucun goût pour les films de Takahata ou Yamazaki, sans compter mon impatience devant les moindres mangas, qui me font le même effet que les poupées de porcelaine aux yeux vides asseyant leurs rubans au-dessus des téléviseurs d’antan.
Mais de là à être infoutue d’aligner cinq mots, puis sept, puis cinq…
A la pause déjeuner, je croisai devant le marchand de sandwichs notre animateur Ian Monk, à qui je tentai de décrire l’effet terrible et destructeur que mon impuissance à écrire le moindre haïku causait à mon ego. Il eut envie de me tapoter sur l’épaule, je le vis bien, fut plein de gentillesse à mon égard, et me conseilla simplement de « ne pas trop intellectualiser tout ça ».
On voyait bien qu’il ne faisait pas partie du groupe d’Hervé Le Tellier, tiens…
Je me suis résignée et ai terminé comme j’ai pu, une semaine aussi décevante qu’inutile. Aussitôt le dernier texte écrit pour le « roman collectif » (je ne voulais quand même pas partir en laissant le travail collectif « en plan »), je me suis levée et suis partie, sans vouloir « profiter » du repas du soir et de la grande soirée de restitution des chefs d’œuvre de la semaine, que toutes attendaient pourtant avidement… La seule question qu’on posa, à ma sortie, ne fut pas pour s’inquiéter de mon départ ou de ses motifs, ni même pour me souhaiter un bon retour, mais fut : « mais qui donc allait lire mon texte (de cinq lignes…) le soir ? ».
C’était leur seul souci… Je répondis « n’importe qui fera l’affaire », et sortis donc sans dire « au revoir »… Il est vrai, dieu me pardonne, que personne ne m’avait dit « bonjour ».
Voici ma triste histoire finie. Pas tout-à-fait, cependant. Mon mail figure dans la liste d’adresses du « groupe », j’ai donc (pour combien de temps ?) accès aux échanges post-formation… J’ai donc appris par ce biais, sans que quiconque m’en avertisse autrement que par omission, que le groupe avait décidé de n’utiliser aucun de mes textes pondus pendant la semaine.
…
C’est un nouveau jeu oulipien, supposé-je : le lipogramme en correction, bienveillance et chaleur humaine…
FIN
PS :
Hervé Le Tellier a aussi présenté, le soir de son « show », un numéro basé sur les homonymies d »André Breton » : le « mur » de l’appartement du poète rapproché des « murs » sur facebook, où des inconnus postent leurs photos de vacances. C’était plutôt féroce pour le poète, mais surtout très cruel pour les malheureux « André Breton » qui étaient ainsi ridiculisés : je n’ai même pas souri. Par contre, affublé d’un égouttoir à nouilles et d’un tuyau d’aspirateur sur la tête, le même Le Tellier a tenu sa place dans une parodie hilarante, façon Monthy Python, qui célébrait les morts conjointes de Shakespeare et Cervantès, où le loufoque le disputait à la drôlerie. J'aurais donc goûté au moins cela, mais ma voisine m’apprit, d'une petite voix savourant sa satisfaction "d'en être", que l’auteur de la pochade, Olivier Salon, était avec Le Tellier considéré comme le « must du must », la "crème", du club très fermé des oulipiens, « loin devant les autres ».
Bon sang.
Même entre eux, c’était donc la compèt ? Peut-être était-ce pour cela que je n’avais pas trouvé ma place, et sans doute vraiment "dérangé le monde ": je n’aime pas non plus les compétitions : comme une tendance à jeter l'éponge...
Commentaires (2)
- 1. | 05/08/2016
- | 07/08/2016
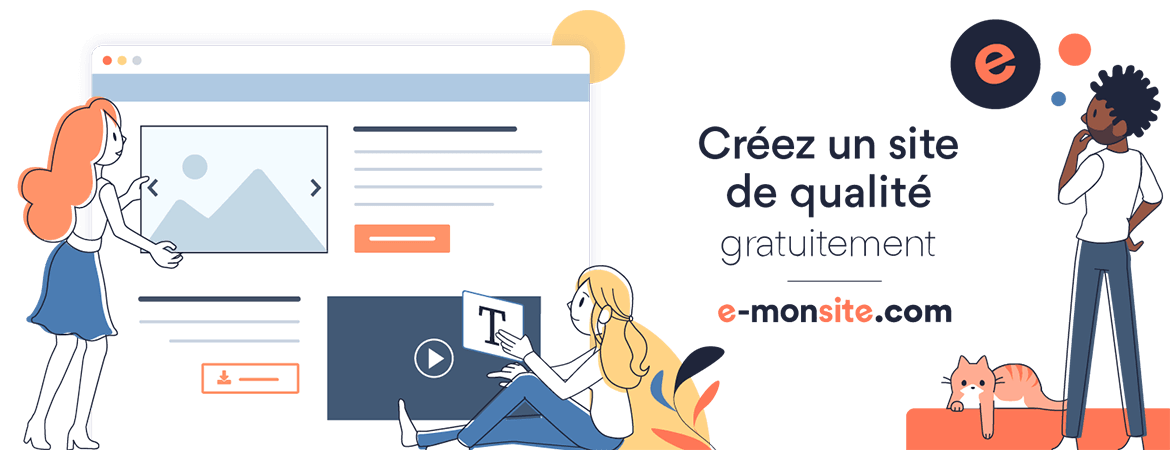
point n'est besoin de génie
haïku fini
(les rimes sont en prime !)