Petite histoire de Noël...
- Par clopine
- Le 18/12/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
NOEL 197…
Michel C. était le garçon le plus recherché du lycée. A cela, deux raisons : ses cheveux longs, épais, bouclés, qui dansaient sur ses épaules au moindre mouvement et encadraient une tête d’’ange aussi blond que celui de la flagellation du Christ de Fra Angelico, et sa chambre en ville, luxe inouï qui n’était pourtant dû qu’aux exclusions successives des internats de ses précédents établissements. Il passait en effet son temps à faire tourner la tête des filles : il était charmant. Un jour, il avait embrassé par derrière la prof de maths dans le cou : il l’avait confondue avec une de ses copines.
Il avait tant de succès qu’il était charmant avec moi aussi, qui n’était pourtant qu’une terne camarade de classe : et ce fut ainsi que cela arriva.
Il s’agissait de la fête de Noël du lycée. Il y tiendrait un rôle de tout premier plan, car il avait été sollicité par la prof de français pour jouer des scènes d’une pièce de Ionesco, « Rhinocéros » : il était fabuleux, et je l’écoutais avec tant d’attention que, prenant soudain conscience qu’il me racontait tout cela à moi, qui n’avait évidemment aucune chance d’être sollicitée pour quoi que ce soit, il me proposa, sous le coup de la pitié et de l’inspiration, de participer également au spectacle.
Evidemment, il n’y avait plus de place pour la pièce de théâtre : tous les rôles avaient été distribués. Mais peut-être pourrais-je intervenir avant, en lever de rideau en quelque sorte ? Voyons, je devais bien avoir un talent caché : n’y avait-il rien que je sache faire, vraiment ?
Si, répondis-je. Je connaissais un poème par cœur.
Un poème ? Oui, cela pourrait peut-être faire l’affaire, il allait en parler à la prof (qui, visiblement, ne savait rien lui refuser). Et de quel poème s’agissait-il ?
Je pris une profonde inspiration, le regardai droit dans les yeux : « Il n’y a plus rien », de Léo Ferré.
Rien que ça.
Léo Ferré a dû en effet écrire le plus touffu et surtout le plus long poème de sa carrière pour déclarer « qu’il n’y avait plus rien ». Non seulement le nombre de mots pour le dire est considérable, mais encore le tout, sur fond de Rejet Absolu et Défintif de la Société, est panaché d’anathèmes, de déclarations emphatiques, et d’amères considérations sur l’Ingratitude Humaine.
Cela correspondait tout-à-fait à la jeune fille de 17 ans que j’étais, bien entendu.
Mais mémoriser ce monstrueux texte était un exploit en soi, et je savais que je pouvais le faire : j’avais le temps nécessaire pour cela, n’est-ce pas, et pouvais y consacrer toutes mes soirées…
Et c’est ainsi que par un soir de décembre de l’année 197…, l’élève la plus mal dans sa peau (car si certaines jeunes filles étaient en fleurs, j’étais plutôt en boutons…) , la plus encombrée d’elle-même, la plus mal fagotée de tout l’établissement (je portais un chandail avachi, dans les tons roux, boutonné sur le devant et aux antipodes des modes « indiennes » de ce temps-là) se présenta debout, seule sur scène, devant tout ce que le lycée comptait de personnes influentes, assises en rangs serrés.
Le proviseur et les professeurs les plus importants, bien sûr. Mais aussi les représentants des associations de parents d’élèves (comme ma propre mère, qui était la Présidente de l’association catholique et de droite), les grands élèves de Terminale, qui occupaient les premiers rangs, et enfin la piétaille lycéenne.
Oh ! Patti Smith peut bien décrire combien elle a tremblé, devant le jury suédois du prix Nobel de littérature ! Elle peut bien, la main sur le cœur, raconter comment elle s’est emmêlée dans sa chanson (elle devait, pour célébrer Bob Dylan le récipiendaire même pas foutu de venir chercher un prix immérité, chanter « It’s a hard rain ») : « Unaccustomed to such an overwhelming case of nerves, I was unable to continue. I hadn’t forgotten the words that were now a part of me. I was simply unable to draw them out. This strange phenomenon did not diminish or pass but stayed cruelly with me.”
Elle ne m’arrive en réalité pas à la cheville ! Car, arrivée au trois quart du poème (et cela devait faire environ vingt bonnes minutes que j’étais ainsi livrée aux lions), moi aussi j’ai eu, non un banal trou de mémoire, mais un « case of nerves », dû à la brusque conscience du silence absolu qui entourait ma voix imprécative : tous m’écoutaient, et c’était à la fois si inattendu et si impressionnant que j’ai flanché, j’ai reculé, et me suis précipitée dans les coulisses.
Où Michel C., déjà grimé pour la suite du spectacle (et je ne le reconnus pas, car il était affublé d’une fausse barbe), me demanda d’une voix émue si j’avais fini, et, apprenant que non, me prit carrément par la main pour me rapporter, comme une mère chienne transporte son chiot dans la gueule, sur le devant de la scène.
Le silence avait continué ! Tous attendaient ! J’ai donc fermé les yeux, repris le poème là où je l’avais laissé …
J’ai encore dans l’oreille le tonnerre d’applaudissements qui a accueilli le dernier vers : « Nous aurons tout… Dans dix mille ans ! »
Mais moi, n’est-ce pas, je n’ai pas eu besoin d’attendre dix mille ans pour « tout avoir ». Car le soir même, quand la soirée s’acheva, que les chaises furent rangées le long du mur, les élèves à l’internat et le proviseur dans son appartement de fonction, Michel C . m’a raccompagnée à la maison, et là, dans le jardin, sous les froides étoiles de décembre qui brillaient moins que l’unique projecteur du lycée, j'ai reçu un long baiser.
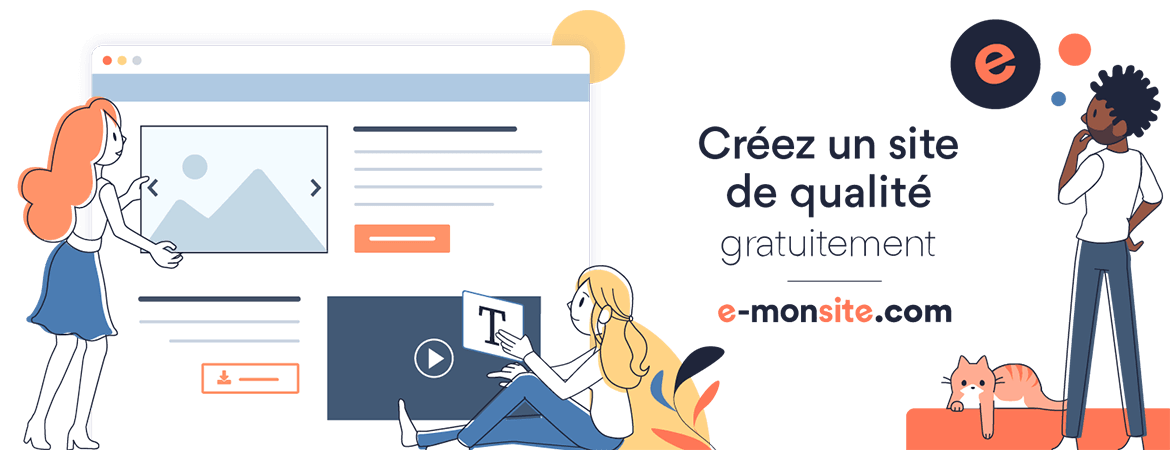
Ajouter un commentaire