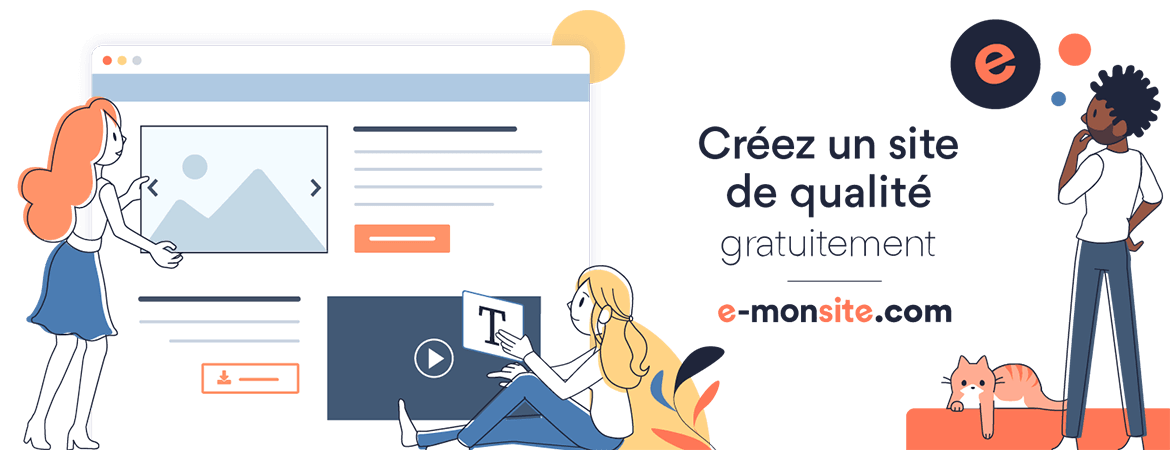Mes textes
100% Clopine
Et que ça pète !
- Par clopine
- Le 23/08/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
L'autre bonne surprise, l'autre jour au Havre, ce furent les arches de Vincent Ganivet. J'ai rarement vu une oeuvre plus agréablement consensuelle que celle-là : monumentale, elle reste légère. Havraise, elle se moque (oh ! Très légèrement ! Et sous forme d'hommage !) des lignes au cordeau et des perspectives rigoureuses de l'aïeul Perret. Identitaire, elle rappelle que la fortune de la Ville vient de ces cartons à chaussures de géants que sont les containers qui débarquent tous les jours au Port. Et quant à la couleur ? Eh bien, il faut que ça pète n'est-ce pas !
On m'a dit que le Conseil Municipal est divisé sur la question de pérenniser l'oeuvre : alors qu'il n'y a vraiment pas photo. Peut-être l'oeuver déplaira-t-elle dans cinquante ans... Ben on s'en fiche un peu, non ? En tout cas, tous les visiteurs sont unanimes : c'est un vrai signal de notre temps, comme Guggenheim à Bilbao. Alors, pourquoi bouder son plaisir ?
(et regardez bien la dernière photo prise par Clopin : revisitation de l'affiche célèbre du chocolat Meunier...)



De grâce !
- Par clopine
- Le 22/08/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Je suis allée, pile poil avant la fermeture, voir l'expo "Pierre et Gilles" au musée du Havre. C'est avec Jim que j'ai découvert ce musée, l'année où j'ai commencé à "travailler pour de bon". Embauchée par la mairie, je faisais tous les jours l'aller et retour Rouen-Le Havre en train. J'ai gravé délibérément, dans ma mémoire, les moindres détails du tout premier trajet, quand il me semblait qu'avoir un emploi régulier revenait à fixer les vis sur son propre cercueil. J'avais surtout l'impression, à l'époque, que j'abandonnais ma jeunesse - c'est-à-dire la fréquentation unique de gens de mon âge, pour me frotter à la laideur adulte : je regardais "l'homme à la pipe", un professeur qui trimballait une lourde sacoche de cuir et qui empuantait le compartiment de son tabac (encore autorisé à l'époque !), je le trouvais vieux, laid, j'allais pourtant le croiser tous les jorus pendant quatre ans et demi dans cette fichue gare, dans ce fichu train.
Autant dire que Le Havre ne me portait pas à la légèreté. Jim n'était pas d'accord avec moi : il adorait cette ville, et ne vivait à Rouen que, je crois, faute de mieux, c'est-à-dire faute d'une maison dans les environs de la forêt de Montgeons. Mais il comprenait bien que cette ville étant un symbole, pour moi, de l'esclavage salarié (même si mon emploi ne faisait pas appel à ma force musculaire, mais à quelques compétences touchant les neurones, il n'en restait pas moins un prolétariat), je n'eussse nulle envie de m'y attarder le soir. Je prenais le train et rentrais à toute vitesse dans la "communauté" où je vivais, à l'époque. J'y arrivais épuisée, cherchant Jim, ce qui déclenchait de la part de nos colocataires quelques railleries peu bienveillantes, d'ailleurs...
J'ai fait exception pour le musée d'art moderne - André Malraux, qui ouvre sur le port un oeil cyclopéen et quelque peu étonné. Jim me servit de guide, et la soirée fut plaisante, clôturée par les inévitables moules-frites d'un mastroquet quelconque.
Trente-cinq ans plus tard, j'étais de nouveau devant le musée, et j'allais de nouveau, le soir, manger des moules (août est la saison où elles sont le plus savoureuses). Cela me faisait une drôle d'impression de revenir au Havre. Heureusement, l'univers de Pierre et Gilles ne porte pas à la mélancolie (encore que... Les larmes scintillantes que les compères placent au coin de chaque point lacrymal ponctuent de tristesse leur univers presqu'enfantin, coloré comme les sucreries d'une fête foraine).
Ce qu'il y avait de bien, c'est l'absence totale de séparation entre les collections habituelles et l'exposition "provocante" installée pour le cinq centième anniversaire de la Ville. Ce qui permettait de relativiser la dite-provocation. Entre le portrait, par Pierre et Gilles, d'Isabelle Huppert, et celui de son arrière grand'mère, l'intention, sinon la manière, n'est-elle pas la même ? Ne s'agit-il pas ici, et là, de témoigner d'une personnalité complexe, mmmhhhh ?


(suite à demain pour l'expédition havraise !)
Un été pour rien...
- Par clopine
- Le 19/08/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Le mois d'août est si pluvieux - j'entends de toutes parts que "l'été est pourri". Et, pour la récolte de miel de Clopin, c'est en plus un été pour rien : les ruches infestées de varroas n'ont rien donné... A croire que les abeilles ont attendu qu'on se lance dans un film à leur défense pour, pile poil, se lancer dans une grève revendicatrice...
Mais bon, je l'avoue, je ne suis pas si mécontente que ça du mois d'août 2017, parce que, du même coup, j'échappe aux mouches, aux rubans adhésifs qui pendent au plafond pour les attraper, aux mini-drames autour de la table le soir quand une personne "qui ne supporte pas..." commence à paniquer quand une guêpe s'approche (et il est vrai que l'allergie existe. Mais aussi combien de répulsions non justifiées par aucune pathologie ?), et par les moustiques la nuit : une année, j'avais même installé une moustiquaire, qui a l'avantage de transformer n'importe quel lit en accessoire de princesse au petit pois. Pas de danger cette année : à peine si une mouche ou deux vombrissent aux fenêtres...

Et le jardin ne semble pas trop souffrir, pour l'instant, de l'humidité. Même si le petit banc ne sert pas à grand'chose...

BBah, c'est cela, habiter une chaumière en Normandie !

La Moustache de Jacques
- Par clopine
- Le 09/08/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
a
à Jacques Chesnel
C'est chez Clopin que l'histoire de la moustache de Jacques me fut racontée, un soir d'été - un de ces soirs bleutés et rafraîchis si typiques de Bray. C'est-à-dire sous la glycine et la vigne, autour de la table de bois posée sur les pierres inégales. Devant, un chemin tout aussi pierreux sépare en deux le grand potager, où les trémières d'août, le soir, referment leur corolles colorées en bordure des carrés légumiers.
Toutes choses, maison, jardin, meubles et pierres, procèdent de Clopin : c'est pourquoi je les emprunte plus que je ne les habite. Cependant, je participe à cette demeure entourée. Mes oreilles, précisément, sont les précieux instruments qui m'aident à vivre ici ; et les récits partagés ont besoin de moi pour exister un peu plus longtemps que la nourriture (substantielle, biologique, potagère et savoureuse) servie à la table de Clopin.
La moustache de Jacques remplit elle aussi une fonction existentielle : à tel point que Jacques, de lui-même, en fait état. Il en est fier, bien sûr, en prend soin, la présente presque comme on tendrait sa carte d'identité à un flic soupçonneux. Jacques est désormais un vieux monsieur : on aurait donc tendance à sourire de ce qui apparaît, de prime abord, comme une coquetterie de personne âgée.
On aurait tort. Jacques a eu plusieurs vies, et bien remplies, et dignes d'un homme - je veux dire : pleines d'humanité, de rencontres et de musiques. Musicien lui-même et critique de jazz, peintre, curieux professionnel, amoureux et "mobilis in mobile". Une remarquable ouverture au monde. L'âge n'arrive pas, ou si peu, à l'immobiliser. Tout juste le ralentir, et encore...
Cet homme possède donc une moustache sans doute moins dense aujourd'hui qu'autrefois, blanche et non plus roussâtre, mais toujours frémissante. S'étendant en pointes droites, de part et d'autre de la bouche souriante, à la façon d'un mousquetaire ou d'un Cyrano. Et si vous demandez à Jacques depuis combien de temps il arbore ce pileux ornement, il vous répond simplement "depuis toujours".
C'est-à-dire depuis qu'elle a commencé à pousser ?
Oui, c'est cela. Jamais rasée. Toujours conservée en l'état...
Comme un tatouage alors ?
Ma question éveille un sourire chez Jacques qui, du coup, se rapproche de la table, croise les avant-bras, se penche au-dessus des couverts : et voici que c'est un adolescent maigre, malicieux et bouillonnant qui raconte. 17 ans en 1945, 16 ans en 1944, 12 en 1940. De quoi être avide et affamé pour le reste de sa vie.
Il habitait à Caen, chez ses parents bien sûr. Une grande maison. Et la première chose qu'il a vue ce matin du 19 juillet 1944, qui lui est depuis restée fixée à la rétine, c'est, à travers les vitres de la fenêtre donnant sur l'extérieur, le canon d'un tank qui, lentement lentement, remontait la rue.
Un char canadien.
Cela faisait des jours que les alliés bombardaient Caen, tentaient de déloger les allemands. Des jours et des morts, par centaines, par milliers. Toute sa vie, Jacques tentera de repousser l'horreur de ces sifflements, explosions et déchirements. Toute sa vie, Jacques opposera la légèreté de la musique de jazz à l'horreur humaine. Et toute sa vie, il pensera avec reconnaissance aux jours qui ont suivi l'entrée des Canadiens dans sa rue.
Car ce fut précisément dans la grande maison familiale que l'état-major des troupes canadiennes s'installa. Le maigre gamin en fut remué jusqu'à l'âme. Il assistait, lui, le simple Jacques, à une histoire héroïque qui allait dépasser à jamais le cadre si quotidien, si étriqué, de sa vie d'adolescent...
Et au passage, il allait attraper dans le paquetage des jeunes officiers le jazz américain, sans doute le plus beau cadeau que la vie pouvait lui offrir à ce moment-là : tout était donc, d'un seul coup d'un seul, exaltant, tout permettait enfin à ses 17 ans de repousser l'horreur et d'enfin jouir de la légèreté "des tilleuls verts, sur la promenade", promise par Rimbaud.
Le capitaine canadien à la manoeuvre chez eux était fort, le verbe haut, le geste ample, et résolu. Il plissait les yeux quand il rencontrait une difficulté. Et, entre autres, il lui fallut résoudre un problème conséquent : une batterie, (trois soldats allemands qui, semblait-il, n'avaient aucunement l'intention de se rendre) semblait inexpugnable dans une maison de la rive droite de l'Orne. Ce verrou, fortement armé de mitrailleuses, commandait un des quartiers de la Ville : les yeux du capitaine, au soir du deuxième jour, ne furent bientôt plus que des fentes, minces comme des meurtrières...
Jacques fut le témoin muet et dissimulé des instructions du capitaine : un soldat, mais pas n'importe lequel, fut appelé. C'était un Huron, oui, oui, comme dans les récits du 18è siècle, au corps recouvert de l'uniforme canadien, uniforme qui ressemblait tant à celui des soldats anglais, mais ne pouvait dissimuler le teint cuivré, les hautes pommettes et l'amande des yeux noirs. Ce fut court : il s'agissait, au mépris des règlements militaires, d'envoyer le Huron seul, en pleine nuit, au beau milieu de Caen. Seul, et avec son seul (et non répertorié dans l'équipement fourni) couteau...
Le Huron rentra vers quatre heures du matin. Jacques, qui n'avait bien entendu pas fermé l'oeil, n'entendit qu'un seul mot tombant de la bouche du canadien, en français du Québec : "C'est fait maintenant". Trois corps, proprement égorgés, gisaient près des mitrailleuses désormais silencieuses.
Est-il besoin d’ajouter que le capitaine canadien possédait, outre une remarquable propension à utiliser les compétences d'autrui, la plus superbe des moustaches, « à la mousquetaire » ?
....
La nuit était tombée, dans le jardin de Clopin, quand Jacques a terminé son récit. Les trémières étaient définitivement closes sur elles-mêmes, le potager respirait paisiblement, tout était calme. La lumière de la lampe-tempête posée sur la table éclairait la paix nocturne... Mais quelque chose, pourtant, continuait à frémir dans la nuit brayonne : c'était les deux pointes, tendues comme des vibrisses de chat, de la moustache de Jacques.
les ardents Dardenne...
- Par clopine
- Le 04/08/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Il faut absolument que Clopin, qui ce matin vidait les étables, écoute la Master Class des frères Dardenne diffusée sur France Cul.
Perso je l'ai écoutée pendant que je repassais, et j'ai été si avide que j'en ai fermé le clapet de la vapeur : le "pschiitt" m'empêchait se bien saisir toutes les paroles. Tant pis pour les plis qui, du coup, vont persister sur les vêtements : le travail qui était décrit là était autrement plus important à mes yeux, et à mes oreilles...
Il y a un mot qui n'a pas été prononcé de toute l'émission, et qui pourtant la résume, et résume aussi ce cinéma-là : c'est le mot "rigueur". Dans le cas des frères, il s'associe évidemment avec le mot "doute", qui semble être une autre de leurs caractéristiques. Bon sang. Comment peut-on être aussi "humble", aussi "en recherche" que ces deux-là, comment mettre ainsi cent fois l'ouvrage sur le métier, comment arriver à avoir un tel recul ?
J'ai eu comme un petit pincement de fierté en apprenant leurs débuts en qualité de... documentaristes. (c'est dingue où mon orgueil va se nicher, ahaha !) Mais maintenant que je le sais, ça me semble être une évidence..
J'ai eu aussi comme un grand sentiment de solitude : dans leurs récits, il apparaissait nettement qu'une de leurs forces est d'être deux, certes, et là je peux m'identifier (toutes proportions gardées évidemment !!) puisque chez nous aussi nous sommes deux, mais aussi qu'ils disposent d'un réseau qui les aide à prendre de la distance critique. Je trouve que Clopin et moi sommes bien seuls. Animés de convictions, sans doute. Mais sans échanges avec nos "semblables", je veux dire avec des personnes qui effectueraient le même type de travail : jamais une Ariane Doublet, par exemple, dont j'admire le travail sans aucune réserve, ne nous a recontactés, malgré mes timides avances lors de la sortie de son dernier documentaire. Pourtant, l'humble "scénariste" que je suis aurait tant à gagner à échanger avec quelqu'un comme elle...
Les Dardenne ont parlé du "rythme" de leurs films. C'est exactement ça, me suis-je dit. Clopin et moi nous devons chercher à trouver ce rythme : puisque nous travaillons à deux, il faut que nous marchions du même pas. Ou même, soyons folle, que nous arrivions à danser ensemble !!!
Il faut évidemment que je me garde de l'exaltation qui, chez moi, me pousse à un débordement d'enthousiasme qui ressemble fort à un soufflé - au grand risque d'être trop cuit et de retomber calciné. N'empêche que cette master classe a éveillé chez moi de telles aspirations que... Clopin, oui, doit absolument l'écouter aussi !!!
Rien qu'une bande de prétentieux...
- Par clopine
- Le 31/07/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Je crois que cela remonte à la soirée que nous avons passés à Amiens, chez des amis, et où nous avons assisté au "son et lumière" projeté sur la façade de la Cathédrale. Ca m'a fait une drôle d'impression. 50 minutes à s'en prendre, littéralement, "plein les mirettes" - et même si la musique n'est pas forcément à la hauteur du bâiment gothique, il n'en reste pas moins que revoir la façade avec ses couleurs d'origine - des bleus francs, des jaunes ocrés et des rouges carminés - est assez inoubliable.
Mais néanmoins, depuis, je nous trouve, nous les humains et plus particulièrement les plus cinglés d'entre nous, qui, sous la bannière d'une foi ou d'un désir d'expression parfaitement insensés, se permettent d'avoir envie de "créer", particulièrement prétentieux. Oui, nous sommes des petits prétentieux, tentant de sublimer nos pauvres existences si imparfaites. Et les plus talentueux ont, encore en prime, la prétention d'être simples et affables !
Devant la cathédrale d'Amiens, j'aurais dû pourtant penser en priorité à Ruskin, et à Proust... Mais si la pensée de Marcel m'a effleurée, c'est bien parce que sa prétention à lui était de bâtir une cathédrale littéraire. Et il y a réussi, le bougre, mais quelle folle vanité que toutes ces entreprises, ces myriades d'egos se répandant, s'épanchant... E tpuis je ne fais pas de distinction, n'est-ce pas. Peintres, sculpteurs, écrivains : tous du même bois, dont on devrait sans doute, un jour, afin de ramener l'être humain au plus près de son essence terrestre, faire de bons fagots, y foutre le feu, avec l'Art au milieu !
Je dis ça alors mêms que je suis en train de participer à la réalisation d'un film, me direz-vous... Et bé oui. Ca s'appelle une contradiction. Elle me saute aux yeux tout le temps, comme samedi dernier : il nous restait un peu de temps, à Clopin, Clopinou et moi-même, après une séance de prise de vues au rucher de Clères. J'ai suggéré une visite au Parc... Sitôt dit, sitôt fait. Et pour ramener n'importe quelle engeance humaine à la modestie, franchement, rien ne vaut la contemplation des oiseaux encagés à Clères ; ce devrait bien plutôt être nous dans les cages, pour laisser enfin l'Art là où il éclate, muliticolore et indépassable...



La Vie avec Clopin (aujourd'hui : ah bon, tu sors ?)
- Par clopine
- Le 26/07/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Aujourd'hui : " Tu sors ? Ah mais, puisque tu sors, est-ce que tu pourrais en profiter pour" ?
OUI, je sors faire des courses, et NON, je n'en "profiterai" pas pour mettre ton courrier à la boîte, porter un cageot de poireaux à repiquer chez René sans savoir si ce dernier est là ou non, déposer des DVD chez Sylvie mais en passant par l'arrière de la maison m'as-tu bien recommandé, de quoi faire peser sur moi les soupçons de tous les voisins alentour, aller à la pharmacie chercher les médicaments sans savoir précisément ce qui était marqué sur l'ordonnance ni quoi répondre à la laborantine qui me demandera si c'est par boîte de 6 ou 12, filer acheter "vite fait" à Emeraude un produit dont j'ignore l'utilisation, l'apparence, la consistance et l'orthographe du nom et qui sera d'ailleurs en réassortiment, monter "un instant" chez ta mère (!!!) ce qui prend au minimum, dans tous les cas, un bon quart d'heure, rien que le temps de trouver les clés et d'arrêter cette p. d'alarme que d'ailleurs j'arrive à déclencher malgré tout, passer faire la queue à la poste pour chercher le colis que tu attends mais dont j'ignore juste que, pour le retirer, il me faut une procuration que tu ne m'as pas donnée, aller déposer au bureau de Jean-Michel au lycée un paquet de tracts de ton association et pour ce faire passer, dans le hall d'entrée, devant cinquante ados qui sont justement (comme ça se trouve !), apparemment désoeuvrés et prompts à jauger la première grande personne qui n'a pas forcément le look adéquat pour trouver grâce à leurs yeux rigolards , retirer de l'argent au distributeur qui bien entendu sera en panne, ne pas oublier d'aller acheter du "steravax"(???) pour tes moutons chez le vétérinaire qui ne retrouve pas trace de ce produit et même que ce n'est pas chez ce vétérinaire-là mais chez son confrère-concurrent que tu as passé commande, ce que nous arriverons finalement à comprendre après un petit laps de temps argumenté, c'est bêta pas vrai ? Et aller chercher "ton dossier" en Mairie en ignorant bien entendu dans quel service et pour quel usage...
Eh bé non. Je déclare hautement, après trente ans de "sorties où j'en ai bien profité pour", qu'aujourd'hui, je vais juste aller acheter des pêches et des abricots chez Duponchel. Juste ça.
Sancta simplicitas.
Une vie pour des musiques...
- Par clopine
- Le 20/07/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Jean-Louis était par ailleurs un (très) bon guitariste amateur, adepte du picking et des mélodies de Marcel Dadi. J'appris, grâce à lui, à pousser la porte des magasins d'instruments de musique, à y passer du temps - même si, au final, il n'achetait qu'un jeu de cordes en métal et trois médiators... Et ce fut bien grâce à ce folk revisité, très anglo-saxon et bien plus "avancé", à mon sens, que le Malicorne à la mode de ce temps-là, qui lui marchait avec les tentures indiennes et l'odeur de patchouli, que je découvris Bert Jansch mais aussi Pierre Bensusan. De Jansch , plus qu'"Angie", me resta l'infinie tristesse de son "needle of death", dont la pochette était toujours accessible sur un coin de table, chez nous, tant on écoutait le disque. Il est vrai que la relation avec Jean-Louis était elle aussi atteinte d'une mortelle piqûre....
Jean-Luc, avec qui je vécus un peu, après la rupture d'avec Jean-Louis, était lui aussi guitariste amateur, mais (très) mauvais. Il n'importe : je retrouvais auprès de lui, non l' éclectisme des goûts musicaux de Jean-Louis, qui avait une très large palette, mais la même curiosité intellectuelle qui nous poussait à hanter les festivals folks où l'on retrouvait Pentangle et -surtout, surtout- la salle Sainte-Croix des Pelletiers, à Rouen. Là où se tenaient les concerts , plus particulièrement, et où un certain Michel Jules avait voué, façon carmélite de la musique de jazz, sa vie à l'association "Rouen Jazz Action". Pour dire toute la vérité, j'avais un peu de mal avec le "free jazz" de l'époque, à cause de ce que je ressentais comme une mégalomanie égocentrique - ces interminables solos de musiciens acharnés à faire rendre l'âme à leurs instruments, par tous les moyens possibles, et ce n'est pas sans une certaine lassitude que j'accompagnai Jean-Luc quand il "suivait" telle ou telle tournée de jazz, dans toute la région. Mais enfin, l'époque était aussi bouillonnante, et de Pat Metheny à Chick Coréa, du Kolhn Concert à Twin House, quelqu'un comme moi pouvait largement faire son miel des multiples nectars proposés. Je sortais pas mal la nuit, par ailleurs, et j'avais une propension à dénicher, dans les discothèques des copains (car c'était une époque où les premiers échanges entre amis passaient toujours, obligatoirement, par une recension des discothèques des uns et des autres, et par des emprunts ininterrompus et vivifiants), ce qui allait devenir une constante de mon écoute musicale : le jazz, entre 1959 et 1963, de Davis et Coltrane. Un peu Monk aussi, d'ailleurs... Bref : j'allais pour toujours rôder autour de minuit ...
J'avais donc déjà associé ma vie aux musiques qui en étaient contemporaines, peu ou prou, quand j'ai rencontré le raz-de-marée musical qui allait forcément avoir le plus d'impact sur moi. Tsunami incarné dans un bonhomme assez petit, aux membres débiles, mal tenu, d'une laideur "intéressante" certes, mais qui le rattachait aux gnomes et autres contrefaix : celui que j'appelle ici "Jim", et qui allait me faire vivre, pendant presque dix ans, chaque jour, environ 20 heures sur 24 (littéralement !), dans un océan de musiques. N'allez pas croire que j'exagère ou que j'use d'une licence poétique. Vivre avec Jim, c'était vraiment être engloutie dans des dizaines, des centaines, des milliers d'heures d'écoute. La maîtrise de philosophie que Jim avait obtenue à l'université de Mont-Saint-Aignan n'était-elle pas consacrée à la musique ? N'avait-il pas obtenu un premier prix de composition, décerné par ceux-là mêmes qu'il allait pourtant nommer, toute sa vie, comme " ces connards du conservatoire" (quand ce n'était pas "ces gros connards du conservatoire" !), grâce à un octuor de clarinettes, jamais joué depuis son audition, d'ailleurs, et perdu pour toujours désormais ?
Pour de vrai, je ne sais comment j'ai pu résister à tout ça : l'argent si chichement gagné mais entièrement dévoué aux collections, les copains déboulant au beau milieu de la nuit pour obtenir conseils et partitions, le piano trois-quart de queue (il fut une période où Jim dormait dessous, car l'instrument prenait tout l'espace de l'appartement) omniprésent, les piles de disques et de bandes magnétiques, la musique arpentée jusqu'à l'obsession... Je me réfugiais dans ma chambre, sous les toits de la petite maison de ville, d'où me parvenaient, exactement comme la chaleur monte d'un poêle et vient se coller à la charpente, des bouffées multicolores et empressées : un bouquet composite d'à peu près toutes les musiques, voire de n'importe quoi...
De ce formidable éclectisme surnagent quelques souvenirs, les plus prégnants quoi. D'abord Erik Satie. Une sorte de "double" de Jim, qui en appréciait l'insolence, l'humour, la finesse, l'économie de moyens et la formidable élégance, au final. Peut-être est-ce l'arrangement orchestral que Debussy a fait des gymnopédies qui rattachera toujours cette musique à mon pauvre ami (désormais anéanti par la maladie d'Alzheimer) ? Ou bien la ressemblance physique entre Jim et Satie influe-t-elle, encore aujourd'hui, sur l'émotion qui se dégage à chaque fois, pour moi, des si simples et si beaux accords, pour la version au piano seul ?
suite à plus tard
Des musiques pour une vie...
- Par clopine
- Le 18/07/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Oui, je pourrai résumer ma vie par ces quelques musiques qui l'ont jalonnée - chacun de nous possède ainsi un répertoire intime, coloré et changeant, qui peut raconter à sa manière toute l'histoire.
Je passerai très vite sur le concours de chant organisé par le club Mickey de la plage de Blonville -sur- mer, en 196?, où je n'ai remporté, que le second prix, et encore, en beuglant un tube quelconque de ces années-là, yéyées et d'une telle pauvreté artistique que c'en était presque un crime - victoire douce-amère, dont je me remis très vite : ce n'était pas moi qui chantais, à la maison, la place était déjà prise par ma grande soeur à la satisfaction générale : je n'eus donc aucun regret en savourant les carambars et en affichant la casquette Minnie, d'un rose douceâtre, trophées dérisoires qui attestaient de mon incomplète victoire. De toute façon, était-ce bien de la musique, que tout cela ? Encore aujourd'hui, j'ai comme un sursaut de révolte à l'évocation des noms de Maritie et Gilbert Carpentier, iniques pourvoyeurs de mon enfance, boucheurs de cérumen, abêtissant jusqu'à l'envie les jeunes téléspectateurs qui avaient, les malheureux, l'impression d'être modernes...
Le premier souvenir musical gravé dans ma mémoire date de mes dix-huit ans, quand j'avais fui la maison parentale. C'était à Rouen, à l'abbatiale Saint-Ouen. Je traînais, cet après-midi là. J'étais (enfin) libre, et j'usais encore avec parcimonie et prudence de l'avenir qui semblait (enfin, derechef) m'appartenir. J''ai entendu des voix, à l'intérieur de l'abbatiale. Je suis entrée par la porte latérale : je ne sais pourquoi, l'accès était libre pendant la répétition du concert du soir. C'était une chorale comme je n'en avais encore jamais entendue, accompagnée d'un orchestre nombreux. Au moins 50 choristes et une bonne quinzaine de musiciens, au bas mot. Je me suis assise à côté d'une Dame, replète et élégante, accompagnée d'un Monsieur bien mis.
La musique a comme forcé un barrage - les fameux bouchons qu'on avait enfoncés dans mes oreilles à force d'entendre la voix de Pierre Bellemare sur Europe 1 - et j'ai ressenti une telle émotion, d'un coup, que j'en ai eu les larmes aux yeux. Je me suis timidement penchée vers la Dame, et ai osé demander : "excusez-moi, mais connaissez-vous le nom de cette musique ?"
La Dame était à ma hauteur, assise à mes côtés, mais son regard s'est pourtant abaissé vers moi, me ratatinant de la prunelle, avec comme un ricanement gêné : "Mais enfin ! C'est le requiem de Mozart, le "Kyrie", voyons !! Vous sortez d'où ?"
J'ai rougi. Et je rougis encore d'avoir rougi.
Mon second souvenir musical entame une longue série : celle des découvertes que les garçons de ma vie d'alors m'ont offertes, sans que j'ai rien eu besoin de demander. Debussy, par exemple. Jean-Louis (dans ma génération, c'était très difficile d'échapper aux "Jean quelque chose") m'avait offert un "coffret-intégrale", mais la pauvreté de ma culture musicale m'en interdisait la compréhension, donc l'émotion, pour la plupart des oeuvres, auxquelles je n'accèderais qu'au terme d'un apprentissage difficile.
. Sauf pour un morceau, qui m'a paru tout de suite accessible et ouvrant la porte : les "danses sacrée et profane", avec ces échappées de harpe qui allégeaient le martèlement rythmique. J'entrais dans un monde dont j'ignorais jusque là l 'existence...
La suite à plus tard
Reconnue ?
- Par clopine
- Le 21/06/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Comme les pélerins du Moyen-Age, les cinéastes, pour arriver à leurs fins, ont "besoin de trois sacs : un sac de patience, un sac d'argent et un sac de foi".
L'expression m'a faite sourire : lors de la première sortie de notre dernier documentaire à Neufchâtel-en-Bray, un participant du film, vers qui je m'avançais dans le hall d'entrée pour le saluer, a cherché à me "qualifier" pour expliquer qui j'étais, à sa compagne. "Et voici Clopine", a-t-il dit, "qui, pour le film, a... porté les sacs.." J'en ai sursauté, et du coup, le participant en question s'est trouvé aussi déconfit que Bacri dans "le goût des autres", gaffant lourdement (et sans s'en rendre vraiment compte) sur les homosexuels...
Quand je raconte cette anecdote, Clopin me rétorque qu'il s'agissait probablement d'une sorte de tentative d'humour... Je n'y crois guère. D'autres me disent "ah oui, mais c'est parce que tu dois avoir des problèmes de reconnaissance".
Peut-être est-ce vrai - mes problématiques caractérielles sont effectivement emmêlées dans des écheveaux si complexes qu'on m'attribue aussi, souvent, une "personnalité clivante", manière élégante de dire que je suscite, sinon du rejet, du moins une sacrée dose de méfiance ("Qui c'est celle-là ?").
Mais peut-être aussi n'est-ce pas moi qui ai des "problèmes de reconnaissance". Peut-être, et même sûrement, est-ce que le chemin qui reste à parcourir, dans les inconscients masculins, pour dépasser les préjugés et attribuer à une femme un autre rôle que subalterne est encore diablement long. Peut-être, et même sûrement, n'aurons-nous enfin conquis l'égalité que lorsque nous serons toutes, et sans erreur, "reconnues" non pour ce que nous paraissons, mais pour ce que nous faisons ?
En attendant, soupir ! Me voici repartie dans une aventure cinématographique, et s'il s'agit de patience, d'argent et de foi, là, oui, je le "reconnais", je porte les sacs !!!
Une Histoire subjectivée...
- Par clopine
- Le 06/06/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Evidemment, j'aurais pu m'en douter : la critique de Finkielkraut et Zemmour sur Patrick Boucheron (lue sur Wikipédia), est évidemment débilos. Jugez-en plutôt (à propos de l' Histoire mondiale de la France) :
"Pour l'essayiste Alain Finkielkraut, Patrick Boucheron serait caractéristique d'un enseignement de l'histoire « que nul scrupule, nulle probité intellectuelle n'arrête, quand il s'agit de souligner les failles et les fautes de la France dans son rapport à l'altérité ». L’ouvrage serait un « bréviaire de la bien-pensance et de la soumission ». Il décrit ses auteurs comme des « fossoyeurs du grand héritage français » qui « n’ont que l’Autre à la bouche et sous la plume » mettant en doute que le fait d'affirmer qu'il n’y a pas de civilisation française et la France n’a rien de spécifiquement français puisse contribuer à résoudre la crise du vivre-ensemble.
Eric Zemmour dans un article intitulé « Dissoudre la France en 800 pages », fait un compte rendu critique de l'ouvrage qui s'inscrit, selon lui, dans la volonté de déconstruction de notre « roman national » présente dans l'Éducation nationale depuis les années 1970. Il dénonce une histoire selon laquelle il n’y aurait « pas de races, pas d’ethnies, pas de peuple », mais que des « nomades » et estime que Boucheron veut « renouer avec le roman national, mais ne garder que le roman pour tuer le national ». Le parti pris particulier de l'ouvrage serait que « tout ce qui vient de l’étranger est bon »
Bon, qu'attendre d'autre de ces deux-là que la pire attitude réactionnaire, me direz-vous ?
Eh bien, ils auraient pu au moins discerner ce que Boucheron apporte de neuf à l'étude historique en général, et aux sujets qu'il traite en particulier. A savoir ce qui m'a sauté aux yeux dès le début de son dernier ouvrage "Un été avec Machiavel" - et que je n'avais pas repéré dans son "Léonard et Machiavel" (dix ans déjà !) mais qui se dessine de plus en plus dans l'oeuvre en cours. Et qui, à mon sens, vaut au moins d'être signalé, sinon d'être interrogé, et que je ne peux appeler, au risque d'être pédante, autrement que par cette lourde formule "l'histoire subjectivée"...
Boucheron, en effet, rompant en cela avec ses illustres prédécesseurs, les Leroy-Ladurie, les fondateurs des Annales, ou les Fernand Braudel, n'hésite jamais à apparaître "en tant que tel" dans ses thèses historiques. En littérature, cette manière de faire est surtout illustrée par Binet, par exemple dans son "hHhh", ce qui permet à ce dernier de subjectiver au maximum son récit historicisé. Mais au moins ce dernier appelle-t-il ses ouvrages "romans".
Chez Boucheron, l'éblouissante érudition et le sérieux du travail historique rendent plus problématique cette apparition de la subjectivité de l'auteur à l'intérieur de l'écriture - mais elle est pourtant bien là. Onfray la saluerait sans doute, y voyant la réponse à l'injonction nietszchéenne de ne pas séparer l'Idée de la vie de celui qui l'émet. Pour moi cependant, ce que je n'avais pas repéré avant d'ouvrir "un été avec Machiavel", elle relève surtout, non d'une "mode", le mot serait trop méchant et déplacé, mais d'un courant caractéristique de notre époque, et qui pourrait voir son illustration métaphorique dans le... selfie...
Ah, j'ai tout de suite envie de demander pardon à Boucheron de cette opinion. Mais le style littéraire (pourtant élégant et précis à l'extrême, certes) qu'il emploie de plus en plus confine, au moins j'en ai eu l'impression cette fois-ci, à une certaine préciosité contemporaine qui essaime "partout". Car la subjectivité, fille de l'individualisme triomphant, est désormais "partout". par exemple, on ne voit plus un seul documentaire (de "j'irai dormir chez vous" à "rendez-vous en terre inconnue", pour ne citer que les deux formats les plus "grands publics") sans que l'auteur n'y soit mis en scène, n'y apparaisse et n'y prenne la parole. Pas un seul texte littéraire où l'autofiction, voir la biographie la plus élémentaire (les citations des petits filles d'Eric Chevillard) n'entre avec fracas...
Et ce n'est pas le moindre paradoxe que cette prétention à l'individualisme le plus exacerbé n'envahisse "collectivement" tous les différents domaines de la création ou de la science - pour Patrick Boucheron, l'Histoire, donc. C'est pourquoi en le lisant, j'avais comme une sorte d'"effet de mode", de "marque de contemporanéité" qui s'installait entre moi et le plaisir de la lecture, en venant la perturber. Les qualités très réelles de cette écriture-là, et qui m'enchantaient il y a dix ans (je relevais que le vocabulaire employé par Boucheron dans "Léonard et Machiavel" pour décrire son rapport à l'Histoire relevait en fait... des termes de l'amour physique !!!), me semblent maintenant trop marquées par cette irruption continuelle de la subjectivité, donnée comme triomphe de l'individualisme, mais partagée si universellement dans tant de domaines de création qu'on n'y voit, finalement, que le grégaire d'une génération.
(je ne sais pas si je suis claire, m'enfin, tant pis.)
Je suis bien difficile, me direz-vous ? Ah, mais c'est que je relis, en ce moment, pour les besoins de la bonne cause, les mémoires entomologiques de Fabre. Et là, la langue transcende son époque, devient intemporelle et universelle. Et j'aime tant Boucheron, au fond, que je voudrais qu'il s'affranchisse, non seulement des cadres de ses prédécesseurs -ça, ça y est, c'est fait- mais encore des modes paradoxales de son époque, qui veulent qu'on se proclame individu libre, mais qu'on illustre cette déclaration par des procédés si communs à tous qu'ils en deviennent non seulement quelconques mais quasiment moutonniers.
Délices d'une Littérature Augurée
- Par clopine
- Le 05/06/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Petit triomphe personnel à l'écoute des Papous en rediffusion : j'ai inscrit dès le premier tour "Gombrowitz" sur ma feuille. Non que j'aie reconnu le livre dont l'extrait était issu (je ne l'ai pas lu), mais à cause de la chute de la dernière phrase : la forêt verte. Il n'y a guère que Gombrowitz (et parfois Chevillard) pour ainsi instiller, à la fin d'une phrase, un looping plongeant dans l'incertitude du lecteur. In cauda admirum, en quelque sorte.
Pour être parfaitement honnête (je m'y emploie de plus en plus, tous les jours, dans une tentative renouvelée d'être au plus près de moi, même si je me déplais), j'avais pensé un bref instant à Beckett. Mais il aurait alors fallu que le texte soit écrit pour le théâtre (Almassy y a pensé aussi, elle a supposé Pirandello) - or il était trop littéraire, trop travaillé à mon sens. Et puis cette chute : non, il n'y avait que Gombrowitz...
Rien n'égale la satisfaction de deviner juste au DLA ; rien n'égale non plus l'inutilité de l'exercice (qui rajoute donc à sa beauté pour moi), ni l'indifférence généralisée qui l'entoure. Rien d'étonnant, donc, à ce que je n'y sois pas mauvaise.
Une petite victoire qui s'ajoute à la convoitise littéraire qui va m'amener à acheter "Un été avec Machiavel" de Boucheron. J'ai bien envie d'ajouter que ce sera le joyau de la semaine prochaine, mais je m'interdis toute publicité, même détournée, ahaha.
Escapade dieppoise
- Par clopine
- Le 28/05/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Nous avions passé l'après-midi chez une amie, avions profité d'une miraculeuse véranda perchée d'où l'on voyait, par toutes les fenêtres cernées de blanc, la baie de Quiberville, clignotante et mouvante , sertissant la pièce où nous nous trouvions d'un bleu changeant et rafraîchissant, nous avions dégusté le tourteau et les bulots préparés par notre hôtesse avec une simplicité efficace (et une excellente mayonnaise), nous étions promenés sur la digue, devant les cabines de plage dressées comme des dominos, et voilà qu'il était vingt heures et que je n'avais pas envie de rentrer.
Ca tombait bien : il nous fallait faire de l'essence, et donc retourner à Dieppe...
Nous sommes rapidement tombés d'accord, Clopin, Ti'Punch et moi : d'autant que les couleurs étaient miraculeuses. Nous n'avons quitté Dieppe qu'à vingt trois heures, et la lumière semblait encore se propager, comme si la nuit avait définitivement laissé tomber l'idée d'envahir la place !



Léonard de Wiki
- Par clopine
- Le 25/05/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Emission sur Virginie Despentes, sur France Cul, ce matin.
Le drôle, c'est que je me suis endormie hier avec 'l'illustre Gaudissart" ouvert sur mes genoux (en liseuse !) , en trouvant le dialogue entre Gaudissart et le fou plutôt raté, et même franchement raté. J'ai aidé mes paupières à s'alourdir en divaguant là autour : le quiproquo entre l'homme "sensé" et le "fou" avec évidemment renversement des valeurs, (le plus fou n'étant bien sûr pas celui qu'on croit), ça donnerait quoi, aujourd'hui ?
Evidemment, ça ne pourrait donner "quelque chose" que si on travaillait un peu et la sociologie aliéniste, et l'écriture : mon sommeil est devenu coupable une fois de plus, puisqu'il m'a prise dans la conscience de tout le temps que je perds, au lieu de m'atteler à ce pourquoi je suis douée et qui m'intéresse : la littérature...
Bref. N'empêche que "Gaudissart", avec cet ego hyperdimensionné, est un tel "type" de l'aliénation moderne à la marchandise, que Balzac a fait preuve, là, d'anticipation, à mon sens.
Et voilà qu'une fois la nuit passée, dans un petit matin au ciel d'un bleu intense, à l'air frais et léger, un de ces matins de mois de mai où l'on voudrait être une oiselle, je mets la radio, et boum ! Le journaliste de France cul, avec cette sorte de jubilation dans la voix qui trahit celui qui sait qu'il va étonner, surprendre, et briller par surcroît, compare justement Vernon Subutex, le héros de Despentes, à.... Gaudissart ! Coîncidence....
Plus précisément, il mettait sur le même plan la "statue de Gaudissart" érigée à Vouvray avec la "page facebook" soi-disant créée par Vernon Subutex ; il voulait souligner que les héros littéraires échappaient parfois, ainsi, à leurs créateurs, et se carapataient dans l'existence réelle... Et qu'une page facebook vaut bien, de nos jours, une statue d'hier.

Je n'en suis pas si sûre. Oh, je ne mésestime pas du tout le profond bouleversemet que la technologie informatique a produit sur nos vies (et sur la mienne en particulier). L'honnête homme de jadis ne peut que s'incliner bien bas devant ce qu'il faut nommer, faute de mieux, la "mise en commun des connaissances collectives", c'est-à-dire la montagne, l'Everest, l'infini cosmique de savoirs désormais accessibles au premier internaute venu. Nous sommes tous des petits Léonards de Wilipédia, en quelque sorte, et ce n'est pas sans tout bouleverser.
Mais le rapport entre la statue de Gaudissart et la page facebook de Vernon Subutex n'est pas aussi limpide que cela - parce que le héros de Despentes n'est pas fier de lui, qu'il utilise internet pour se cloîtrer, qu'il en profite pour se mettre sous le boisseau, en quelque sorte (tout comme votre servante, en fait).
La page facebook de Subutex n'est qu'une addiction parmi d'autres. Que Despentes soit pleine d'indulgence pour les addictions est soulageant, sans doute, mais le fait est cependant là : on n'en sort pas grandi. Il y a une certaine veulerie à préférer l'éphéméride à la durée, l'immatériel à la sculpture, l'inconsistant à l'âpre bagarre du réel.
Mais peut-être est-ce cette foutue culpabilité, dont je faisais état plus haut, qui me fait parler ainsi. Je pense aux heures perdues chez Assouline. Non à cause d'Assouline, qui reste pour moi un "mec bien", surtout par la précision de sa posture : il est avant tout un homme méditerranéen, le sait, l'assume, et cela lui suffit. Mais à cause des trolls qui empoisonnent la République des Livres, et auxquels j'ai, de manière aussi insensée que Gaudissart achetant le vin d'un fou, conascré du temps bien trop perdu...
la haine aux champs, entre paradoxes et contradictions
- Par clopine
- Le 11/05/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
La colère des habitants des villages, exprimées par un vote F Haine à plus de 60 % dans bien des cas, (comme dans mon village !) , est aussi fuligineuse, énigmatique, pardoxale, à première vue, que ces rassemblements de nuages de différentes natures, qui viennent se bousculer dans une apparente contradiction, avant que leur entrechoc, en même temps que l'odeur d'ozone qui monte de la terre, ne libère les trombes de l'orage.
Parce qu'enfin, si l'on y songe, tout ici est contradictoire : la première peur que l'extrême-droite agite, afin de désigner un coupable commode, est celle de l'autre, du différent, de l'étranger - et plus précisément de l'arabe musulman (mais un peu aussi le noir et le juif, pour faire bonne mesure...) ; comment nos villageois peuvent-ils tomber dans ce piège, alors que, définitivement, ils n'ont que des contacts absolument minimes avec les populations désignées du doigt, qui ne sont en rien des "rivaux " pour eux, en termes par exemple d'emploi ou d'occupation de l'espace social ? Oh, ce n'est pas que le paysan n'éprouve pas le mépris, la peur et la méfiance envers celui qui ne vit pas comme lui (et dont la liberté fantasmée est sans doute le socle d'un désir inavoué, comme le fermier qui, déplorant le meurtre de ses poules, ne peut s'empêcher d'admirer la beauté du renard). Mais de tout temps, l'ostracisme s'abat, dans ma campagne, sur le manouche, pas sur un autre définitivement absent. A-t-il transposé cette haine rien que par la grâce d'une propagande qui ne reflète en rien son vécu ?
L'autre paradoxe concerne l'Europe, autre cheval de bataille de l'extrémisme. Or, la majorité des agriculteurs sont, depuis 60 ans, complètement dépendants de la PAC, et ne pourraient survivre sans elle. Comment concilient-ils (alors même que la majorité des élus locaux des petits villages sont des agriculteurs, en activité ou retraités...) l' caspiration à sortir de l'espace commun, qu'ils semblent plébisciter par leurs votes, avec leurs pratiques quotidiennes ? Vous me direz qu'il s'agit sans doute là du même tour de passe-passe qui fait que le paysan (là encore, sans doute, par envie et dépit mêlés) n'a pas de mots assez durs envers le fonctionnaire : or, il n'en est plus très loin, et sans la machine administrative qui lui permet de toucher les subsides publics, il serait encore plus exposé aux aléas d'un marché fluctuant et dévastateur.
Autre source d'étonnement : il n'existe pas, en France, de catégorie professionnelle plus structurée et plus collective que celle des agriculteurs. Leur syndicat plus que majoritaire, la FNSEA, non seulement s'appuie sur la légitimité du nombre, mais encore a réussi à structurer les réseaux sociaux autour de lui de telle sorte qu'il contrôle non seulement les chambres d'agriculture, mais encore le ministère lui-même. Comment une telle force de frappe ne réussit-elle pas à procurer un sentiment de sécurité à ses adhérents, qui leur permettrait d'envisager l'avenir avec sérénité, et d'être moins sensible au discours alarmiste, démagogique et antirépublicain de l'extrême-drfoite qui déclare que "tout va à vau-l'eau" et que "tous sont pourris" ??? Comment une catégorie sociale qui a su à ce point utiliser le système d'organisation politique pôur assurer sa représentativité et défendre ses intérêts peut-elle, en même temps, manifester un tel rejet de ses propres représentants ?
Enfin, ce vingt et unième siècle est caractérisé par la prise de conscience de l'interaction de l'homme et de son milieu, et par l'omniprésence et la célébration du monde sensible - or, l'agriculteur, le paysan, (à défaut de l'anonymat citadin permettant l'audace et la créativité), bénéficie d'un contact direct avec ce qui est désormais la pierre angulaire de la sensibilité collective : la célébration de la Nature. Pourquoi donc adhère-t-il à un discours qui, attisant les rancoeurs, lui souffle qu'il est injustement méprisé, alors que son mode de vie est, au moins dans la majorité des publicités, désigné comme vertueux et exemplaire ???
Qu'est-ce qui donc, de maniière paradoxale, rend perméable les ruraux à la démagogie outrancière des thèses néo-fascistes ? Je ne crois pas que l'ignorance de l'histoire et le manque d'intelligence interdisant le recours à la raison pour privilégier l'affect immédiat, soient par essence plus largement présents dans les villages que dans les zones urbaines - au contraire, même, ai-je envie de plaider...
La réponse relève peut-être, enfin c'est celle que j'avance (à tâtons !) de la psychologie victimaire. Je veux dire que, plutôt que de s'admettre victime, chercher à se réparer et donc opérer une remise en cause de soi-même, il est toujours plus facile, pour l'ego, d'accuser l'autre, "à l'aveugle" s'il le faut. Sartre, via l' existentialisme, faisait preuve d'un jusqu'au boutisme dans la démarche : il n'y avait pas, pour lui, de bourreaux, simplement des victimes trop consentantes. Sans aller jusque là, on peut cependant constater que, si le paysan analysait correctement ce qui lui arrive, il ne se tromperait ainsi de coupable, et s'il fallait accuser quelqu'un, ce ne serait certainement pas l'immigré magrébhin qui devrait s'avancer à la barre...
Moi je dis que sa colère est légitime, les questions que pose le monde rural sont parfaitement cohérentes - mais les réponses qu'il apporte, à savoir cette adhésion à l'extrême simplisme d'un discours de haine, sont totalement à côté de la plaque.
Oui, j'estime que le rural a parfaitement raison de se sentir floué, méprisé, en danger et montré du doigt. Cela fait soixante ans qu'on lui ment, qu'on le pousse à détruire ce qui le fait vivre, qu'on l'insulte et qu'on grignote de tous côtés son espace. Et j'ai envie de dénombrer, une par une, les incessantes attaques auxquelles il doit faire face, alors même que les armes dont il dispose sont factices et ne servent qu'à lui cacher la réalité...
(la suite à demain, si j'ai suffisamment la gnaque, bien sûr).
La haine aux champs, et le silence autour... (2)
- Par clopine
- Le 10/05/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Effarée : je suis effarée de ce que j'entends. Ou plutôt, de ce que je n'entends pas.
Législatives, Europe, Culture, état de grâce, ni droite-ni gauche, Code du Travail, etc. Autant de sujets tout-à-fait légitimes, je n'en disconviens pas...
Mais pourtant. Les petits villages, autrement dit les ruraux, votent à une écrasante majorité pour un parti sous la bannière de l'extrême-droite, et voilà, rien ne se passe, rien ne se dit...
Comme si toute cette colère, parce qu'impuissante au fond, ne pouvait être entendue... Comme si ceux qui votaient là étaient insignifiants...
Mais merdalors ! C'est sans doute le fait le plus significatif, au contraire, le plus demandeur d'analyses, de solutions, de préconisations, d'engagements, qui nous soit arrivé...
Et rien ? Pas une seule parole solennelle, un "je vous ai compris" ?
On ne devrait parler que de ça, surtout dans les quartiers des villes. Les 90 % de parisiens qui ont voté Macron ne devraient même penser qu'à ça, je trouve. Se demander ce qui se passe à Beaubec la Rosière, et ailleurs.
Parce que ça pue vraiment. Et détourner la tête n'a jamais fait disparaître la moindre odeur nauséabonde, à mon sens...
M'enfin il doit être plus urgent de se demander qui Macron va nommer dans les Ministères, plutôt que d'analyser ce monde en perdition : cette ruralité française qui n'arrête pas d'agiter les bras en signe d'alerte, vainement, avant d'en finir par empoigner, désespérement, les fourches de la violence...
La haine aux champs...
- Par clopine
- Le 10/05/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Ainsi donc, il me faudrait remercier les citadins, sans qui "nous" aurions, pour notre grande majorité, la nausée aux lèvres et les poings serrés aujourd'hui - mais pourtant, pour ma part, j'ai bien la nausée et les poings serrés. La statistique est formelle : tous les petits villages des alentours ont choisi Le Pen. A Beaubec, deux personnes croisées sur trois sont dans ce cas.
Deux personnes sur trois.
J'habite au creux de cette défaite.
Je me souviens -c'était en 2002, et les électeurs du F Haine avaient encore honte d'eux-mêmes- d'une conversation avec un petit notable du coin. 65 ans, agriculteur, d'une famille belge venue s'installer en Oise Picarde au début du 20è siècle (comme beaucoup), maire d'un patelin de 250 habitants, président d'une communauté de communes rurales, bien placé à la Chambre d'Agriculture dans la Commission d'attribution des aides agricoles, et ayant des responsabilité à la FNSEA. Profil typique, loin d'être un imbécile, possédant un haut niveau d'instruction et ayant même envisagé, un temps, une reconversion de son exploitation en bio. Un de ces élus "de proximité" qui, pour assumer les tâches liées à leur mandat, arrivent au siège de la Com'com en tracteur, plutôt que de rester bloqués par la neige...
Nous marchions tous les deux au milieu des champs, et il s'est tourné vers moi : "le problème ici", me dit-il, "c'est que les plus intelligents sont tous partis à la ville, ou y partent. Il ne reste que les trop idiots pour penser par eux-mêmes".
J'ai reculé en entandant cette phrase, et j'ai eu un grand geste de dénégation : je ne pouvais admettre que cet homme, qui tenait dans ses mains des délégations de pouvoir du milieu social dont il était issu, dont il était le représentant, méprisât autant ses concitoyens. Si même lui pensait ça...
Aujourd'hui, il faut cependant bien admettre que la "ruralité" offre le visage d'un repli sur soi morbide et haineux... Comment en est-on arrivé là ? Et comment combattre ce phénomène, qui semble ne pas cesser de s'amplifier, de s'ancrer, de ne plus reculer devant l'autocomplaisance et l'autojustification, "droit dans ses bottes" ?
Il y a quelques pistes de réflexion, à mon sens, dont la première est la perte de sens, d'identité, de valeurs et d'espoir du monde rural, sacrifié inexorablement depuis plus de 50 ans. Et si la France veut se mettre "en marche", il lui faudra, à mon sens, mettre en tout premier de la file, afin de rythmer efficacement la progression de tous, le pas du plus désemparé, du plus en colère, du plus faible intellectuellement des siens : l'électeur moyen de mon village "français" - celui dont Chirac se servait en arrière-fond de sa propagande, et qu'il faudrait désormais repeindre en un nauséeux bleu-blanc-rouge sur fond brun...
Une bouddhiste zen à ma table...
- Par clopine
- Le 06/05/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
V. est une femme grande, souriante, bienveillante, dont la tête brune, couronnée de boucles légères, épaisses et virevoltantes, résume l'énergie et la vivacité. Et elle est bouddhiste zen.
Dieu sait qu'à ma table, se sont déjà assis des individus si différents les uns des autres qu'on a peine à croire à leur même appartenance à l'espèce : un peu comme, chez les chiens, certains couples improbables, du dogue au chihuahua, font douter de leur compatibilité. Mais je crois bien, ma parole, que V., que j'estime et respecte, est la convive la plus inattendue que j'aie jamais restaurée.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos qu'elle m'a tenus, car elle a tenté, non de me convertir ou de démontrer la justesse de sa religion, mais simplement de témoigner de son chemin. Ingénieur biochimiste, rien ne semblait, en effet, la prédestiner à frahcir les portes des ashrams, à la méditation zen et aux "expériences mystiques", qui semblent la motiver par-dessus tout. A travers son discours, V. soulignait que, contrairement aux monothéismes, le bouddhisme reniait la thèse de la réincarnation ("se réincarner dans un corps, voilà la promesse que le catholicisme proopse à l'âme immortelle, ce qu'aucun bouddhiste ne peut concevoir"), doutait fortement des dogmes et règles de vie ("pas besoin d'aller voir tel ou tel gourou à l'autre bout de la planète : on peut rencontrer Bouddha partout", "il n'existe pas de notion comme "le salut de l'âme" qu'on gagnerait ou perdrait suivant nos actions, la sanction n'existe pas"), s'appuyait sur une notion fluctuante, mouvante de la réalité ("rien n'est jamais pareil, d'une seconde à l 'autre, tout est affaire de perception et d'énergies") et considérait enfin l'univers infini à la portée d'une expérience individuelle, totalisante et mystique ("arriver par certaines méthodes comme la méditation à la transcendance absolue, gage de la compréhension et de l'expérimentation intime de l'énergie vitale de l'Univers").
J'en avais les yeux ronds. Il est vrai que je ne connais rien au bouddhisme, ni au zen en général et que ma méfiance instinctive envers la religion me tient éloignée de tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à une spiritualité basée sur une croyance en l'immortalité. Je suis du genre à ne pouvoir pratiquer le yoga qu'en le considérant comme des exercices de gymnastique corporelle, à penser qu'un des drames de l'être humain est son impossibilité à accepter sa finitude, ce qui le conduit à croire aux plus invraisemblables promesses, comme consolation de sa mortalité, et à regretter que dans un pays comme le Népal ou le Tibet, l'argent consacré aux temples ne soit pas plutôt employé, par exemple, à installer un rationnel et efficace réseau d'assainissement. C'est dire si je suis bouchée à l'épanouissement mystique que semble rechercher V. Oh, je m'accorde bien une âme, où le noyau dur de ma personnalité réside et englobe ma raison, mes sentiments, mon corps et ma posture au monde, et je revendique aussi la pratique de certaines vertus, comme la compassion et l'attention aux faibles, que certaines religions ont tendance à confisquer à leur seul usage. Mais je n'arriverai jamais à croire cette âme immortelle, et aucun principe supra-matériel ne me paraît régir le monde dans lequel je vis, et où je suis appelée, comme tout ce qui m'entoure, de la fourmi à notre étoile, à disparaître.
C'est dire si V. et moi ne pouvons guère nous comprendre. Tout juste nous accordons-nous pour déplorer, en commun, les ravages et les souffrances que les religions, au nom de dieu ou de l'amour, infligent à l'humanité et au monde sensible (tiens, un évêque polonais vient d'encourage l'abattage des arbres, au motif que dieu demande à l'homme de dominer son monde, ben tiens, et passe-moi la scie que je coupe la branche sur laquelle je suis assise), et, au moins pour ma part, à combattre la résignation engendrée, ici-bas, par la promesse d'un "au-delà". Mais pour le reste...
Ma curiosité envers l'univers indhou , en fait, ne s'est éveillée qu'il y a quelques années, et fort partiellement, je l'avoue : j'avais écouté, sur France Cul, la retransmision du "Mahabharata" (quelques dizaines d'heures de spectacle...) , cette épopée grandiose et fluviatile censée illustrer l'origine du monde. Là comme dans toute autre récit des origines, quels que soient l'ethnie ou le groupe en question, il s'agit de définir l'humanité, et surtout de la dégager, comme un tailleur de pierre dégage un moellon du filon d'une carrière, de l'animalité qui l'entoure. Le nom qu'une peuplade se donne signifie toujours, à la base "nous les êtres humains". Ce qui est commode pour exterminer tout ce qui n'est pas ce "'nous", et spécialement le voisin d'en face... Bref.
Je manque donc totalement des connaissances et des références nécessaires, pour pouvoir apprécier les expériences que V., avec urbanité et générosité, tentait de partager : tout juste ai-je l'impression qu'il s'agit ici d'un développement de la pensée humaine complètement différent, dans ses prémisses et ses conclusions, à notre histoire occidentale. Nous, qui sommes passés de l'appartenance commune à un monde collectif et religieux, (ou à une tribu, ou à un clan) à la conscience aiguë de notre individualité (et encore aujourd'hui, l'humanisme de la Renaissance est considéré par certains comme "le début de la fin", la cause du déclin moral de l'homme occidental), pouvons-nous comprendre un mode de pensée qui permet à la fois une société hyper-hiérarchisée, d'une cruauté et d'une brutalité patentes (comme les castes indhoues), et une ouverture intime vers une transcendance proprement "inouïe" ???
IL me faudrait, pour le comprendre, beaucoup plus de temps qu'il ne m'en est assigné, et aussi, comment dire ? Il faudrait sans doute que je ressente une urgence qui m'est étrangère, et que V. semble, elle, au contraire, considérer comme la marque la plus naturelle de son histoire personnelle, circonstanciée dès le début (ses cinq ans !!) par l'irruption de l'au-delà et du surnaturel dans son quotidien. Je ne veux ni ne peux la "juger", pas plus qu'elle ne veut ni ne peut, sans doute, m'entraîner à sa suite. Et j'estime beaucoup trop ses engagements (écologistes) et sa vie (d'agricultrice) pour avoir envie de la désarçonner dans sa foi !!!
Mais bon sang, qu'ils sont étranges et si différents les uns des autres, les propos qui peuvent s'entrecroiser, par-dessus les assiettes où sont servis le gigot d'agneau et les petits légumes du jardin, à ma table brayonne, rurale et incroyante... Comment voulez-vous que je n'en divague pas ?
Mais comment je fais pour être d'accord avec les deux ???
- Par clopine
- Le 04/05/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
La position de Clopin, je la connais : non, ce n'est pas un choix entre "la peste et le choléra". C'est choisir de ne pas laisser la place à l'extrême-droite, quitte à élire le représentant d'une classe sociale qui a tout intérêt à ce que "rien ne bouge".
Mais la position du Clopinou se tient aussi, morbleu, enfin à mon sens. Surtout quand je lis son dernier mail à ce sujet :
"Voter dimanche pour Macron c'est montrer que l'on adhère aux institutions politiques actuelles. Je n'y adhère pas, pas du tout. Elles sont aliénantes, clament la liberté du peuple tout en le soumettant aux lobbys économiques et médiatiques. Non, nous ne sommes pas en démocratie, et je ne veux pas participer par ma voix à légitimer ce simulacre. Macron détruit le code du travail, l'Etat social, est pour une Europe toujours plus néolibérale et financière, pour une mondialisation destructrice de sens et de solidarités, pour un système sociétal abrutissant, infantilisant et écologiquement désastreux. Voter pour Macron, c'est adhérer aux institutions politiques qui mènent à faire un tel choix. Hors de question que je légitime par ma voix cela sous prétexte que "c'est le moins pire futur possible" face à la "menace fasciste" qu'on nous brandit comme un étendard sacré pour continuer de vivre dans le même monde de merde. Le FN est déjà le réservoir de la colère (légitime) des cons contre le système, je veux pas qu'en plus cette colère lui serve à se perpétuer par la peur..." (signé le Clopinou).
Bon du coup me voici d'accord avec les deux (soupir) , et surtout je me dis qu'il fallait bien s'y attendre un jour (re-soupir) : le Clopinou a sacrément grandi, certes, mais déjà tout tout petit, il y avait chez lui une sorte de "curiosité volontaire" qui était - à l'évidence- la posture qu'il allait adopter vis-à-vis du monde...
Et je le prouve ! Voici le Clopinou bébé :

(C'est vrai qu'il était rigolo, comme bébé ; mais a posteriori, faut bien avouer qu'il n'a pas vraiment la tête -ni surtout le regard- à voter Macron, celui-là...)
Le sourire d'une campagne ensoleillée...Et l'ombre d'une campagne empoisonnée.
- Par clopine
- Le 02/05/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Le festival départemental "Terre de Paroles" a eu la bonne idée d' Ouliposer quelque peu ses manifestations, cette année. Et ce dernier samedi, après une matinée d'"atelier-lecture" autour de Perec (on s'est vraiment bien amusés), une soixantaine de valeureux littéraires, plus un anglais venu en Bray pour traduire le dernier documentaire de Beaubec Productions, s'est retrouvée à Saint-Aubin le Cauf, à vélo, et sous le soleil : du coup, l'avenue verte bruissante d'odeurs et de fleurs en boutons, l'atmosphère printanière, les coups de pédale et les jeux littéraires ont fait bon ménage ; nous étions devenus des festipédaleurs, en quelque sorte...
Voilà qui m'a un peu réparée de mes déboires bourgeois (ça, c'est une private joke pour ceux qui suivent !!!)...
Mais rien, pas même la bonhomie ambiante d'un après-midi brayon, vélocipédique et littéraire, ne peut effacer l'arrière-plan politique de la sale période que nous traversons. L'oasis oulipienne n'y a pas échappé : dans la cour de l'ancienne école où nous nous sommes tous retrouvés, une fois les vélos remisés, Clopin n'a pu s'empêcher d'échanger quelques points de vue avec des participants, comme lui fortement inquiets des scores de l'extrême-droite : il règne décidément comme une tension, un climat d'urgence, face à l'ombre portée de l'arrivée au pouvoir des néo-fascistes (même enrubannés de blondeur oxygénée).
Clopin et son interlocuteur étaient du même avis, et parlaient fort : "qu'importe que Macron soit le hérault d'une classe sociale et d'une organisation de l'économie responsables, ou au moins complices, d'un délabrement de plus en plus évident de notre monde, il faut cependant voter pour lui, afin d'écraser toute prétention de l'extrême-droite". Moi, j'avais encore dans l'oreille le témoignage de notre ami anglais : dès le lendemain du Brexit, les racistes, se sentant légitimés, ont assassiné quatre immigrés, de l'Europe de l'Est ou du Moyen-Orient, à Londres ; est-ce que ma virulente indignation et mon espoir déçu d'un monde autre, valent l'arrivée d'une Le Pen au pouvoir, avec ce que cela implique de danger, immédiat et palpable, pour le premier maghrébin, le premier musulman venu, le premier être humain qui aura le simple tort d'être "autre", "étranger", "différent" ?
Est-ce que ma "vertueuse abstention" fait le poids, face à un risque pareil ?
L'épouse de l'interlocuteur de Clopin semblait, elle, très embarrassée : non de la teneur des propos des deux hommes, mais de la manière dont leurs voix résonnaient dans la cour, devant la soixantaine de personnes. "Je suis toujours gênée, j'ai toujours un peu peur", me dit-elle doucement, avec un peu d'effroi, "quand on se met à parler politique"...
J'ai pensé qu'elle avait vraiment tort. Quand la maison brûle, se préoccupe-t-on d'essuyer ses pieds sur le paillasson, avant d'entrer sauver ce qui peut l'être ? Je trouve qu'il y a, dans la "pudeur" que certains pratiquent autour de "la politique", le même type de silence que celui qui a si longtemps entouré les violences pédophiles et sexuelles. Les "choses dont on ne doit pas parler", que l'on préfère enterrer, sous le tapis, qu'il est malséant d'évoquer, vous reviennent bien entendu toujours en boomerang... Et en pleine gueule.
Je crois qu'il faut au contraire regarder notre monde en face. Il faudra bien entendu, un jour ou l'autre, analyser cette période que l'on vit. Savoir pourquoi et comment on en est arrivés à cette situation si incroyablement tendue. Trouver, d'une manière ou d'une autre, le moyen de renouer un contrat social sans lequel la vie commune n'est que violence. Mais avant, il faut laisser la parole agir, il faut laisser les gens s'interroger les uns les autres. En tout cas, j'espère bien que les oulipiens passés, les Queneau, les Perec, n'auraient pas pris en mauvaise part la discussion de samedi : car si nous ne nous questionnons pas les uns les autres, nous risquons encore moins de trouver le début d'une réponse !!!
Les murs meurent si rarement...
- Par clopine
- Le 28/04/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
En droit foncier, le "jour de souffrance" (admirable invention de propriétaire) désigne ces ouvertures, dans un mur, destinées à laisser passer un rai de lumière, mais pas le regard, ni l'air, ni la vue sur l'extérieur, et encore moins un objet ou un être quelconque. Cela fait frissonner, bien sûr, tant l'ingéniosité humaine à rationner à autrui des substances essentielles à son existence s'illustre ici, mais c'est admirablement dit, je trouve...
(Voici le schéma) :
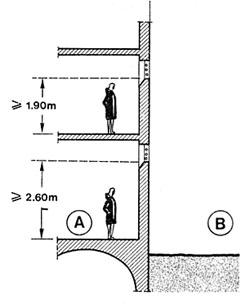
Il semble évident que tous les murs qui s'affirment aujourd'hui, se désirent et se construisent, du Moyen-Orient aux Balkans, du Mexique au parc Kruger en passant par Joypurhat, tous ces murs qui sont notre honte, ne seront jamais percés que de ces jours de souffrance : seule main tendue, seule promesse offerte à l'Autre, qui nous ressemble pourtant si fort.
La première chose à faire...
- Par clopine
- Le 15/04/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Comme le nouveau projet de film commence à se concrétiser, et que les délais seront cette fois réduits (18 mois seulement), je vais devoir cravacher et m'y mettre sérieusement. Aussi, pénétrée du sentiment d'urgence, vais-je m'atteler à ma toute première tâche : relire les souvenirs entomologiques de Fabre. Soit deux jolis petits pavés qui relatent par le menu toutes les recherches entomologiques de l'immense naturaliste que fut Fabre. Même pour une rapide comme moi, c'est au bas mot un bon mois de lectures quotidiennes qui s'ouvre devant moi. Mais la rigueur du propos et l'empreinte que je voudrais bien laisser sur le film sont à ce prix.
Ce n'est que justice, cette relecture : Fabre, comme quelques autres comme Giono, a été une de ces "lectures déterminantes" qui ont fait pencher la balance de ma vie. Comme si souvent, ce fut un cadeau de Jim. Son dernier cadeau, en fait, en guise de viatique, quand j'ai définitivement quitté Rouen et donc la vie commune d'avec lui, et avant que la maladie ne s'abatte sur lui, quelques années plus tard... Je me revois ouvrant la première page, vaguement méfiante, sur la défensive quoi - les goûts de Jim étaient parfois si étranges... Mais j'ai été captivée sur le champ, et je me revois, patiemment, avec émerveillement même, lisant page après page cette sorte d'encyclopédie du minuscule que représentent les souvenirs de Fabre. Je me revois aussi tressautant sur ma place de cinéma, à la sortie de "Microcosmos", en vouant que le film est dédicacé au savant : j'en aurais pleuré de gratitude...
Oui, c'est vraiment la toute première chose à faire : recommencer cette lecture, m'en nourrir, m'en abreuver : qu'elle soit le limon de mon travail d'écriture, en attendant, évidemment, que les images de Clopin ne viennent vivifier le tout !
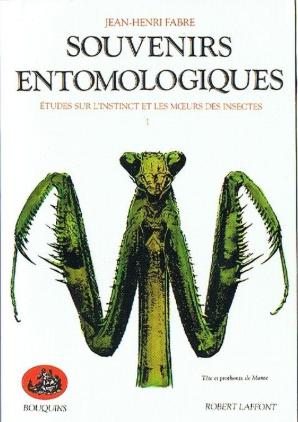
Asinus asinum fricat...
- Par clopine
- Le 14/04/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
on a beau être libertaire, pour une société sans classes, ni dieux, ni maîtres, on n'en est pas moins attachés à la conservation des espèces animales. Notre rencontre avec Franck, secrétaire de l'association des Grands Noirs du Berry, a été l'occasion de penser à remplacer notre irremplaçable. Eh oui. Je veux bien entendu parler de Dagobert, mâle entier et pourtant doux comme un agneau avec nous, compagnon de quelques vingt années d'amitié et de services rendus...
Trève de nostalgie, il vaut mieux continuer à vivre, n'est-ce pas. Et donc une noce à tout casser va être organisée, dès demain, dans l'espoir d'une naissance d'un nouveau grand Noir beaubequois : mariage non forcé, entre notre ânesse et l'étalon de Franck. Tous deux inscrits aux livrets nationaux idoines, et tout deux prêts pour l'aventure, surtout Quenotte, qui rabat les oreilles et mâche du chewing-gums, signes infaillibles des chaleurs...
Le nom des mariés ? Quenotte de la Brande et Ugolin de Kervoisan. Ni Balzac, ni Proust n'auraient renié cette aristocratie-là...
Ca en jette, hein ?
Il ne s'agit pourtant que d'un couple d'ânes...
Ni Dieu, ni maître, et CQFD
- Par clopine
- Le 13/04/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Après la passionnante soirée d'ARTE sur l'anarchie (j'avais l'impression de me retrouver il y a quarante ans, dans le petit troquet où je lisais la revue "La Rue" !), j'ai fait passer le jeu-test "quel anarchiste êtes-vous ?" à tous mes proches.
Bon, ni Dieu ni Maître, je savais qu'on avait tous à peu près ça en commun. Je dis "à peu près", parce que de la même manière qu'on n'a jamais réussi à prouver que la somme des intérêts particuliers aboutissait à l'intérêt général, on n'a jamais réussi à prouver non plus qu'un conglomérat d'individus fort variés, mais appartenant d'après l'état-civil, à une sorte d'entité appelée "famille", développait de ce fait des axes de pensée concordants. D'ailleurs, CQFD !
Dans le reportage, il était dit qu'il y avait presqu'autant de courants anarchistes que de pratiquants. A Beaubec (et avoisinant), ça se confirme rudement, si l'on en croit les personnalités représentant les pensées des uns et des autres :
- ainsi, je serais aux côté de Murray Bookchin, théoricien et essayiste américain, pratiquant l'écologie et prônant le municipalisme llibertaire.
- Tandis que Clopin est, lui, plutôt inspiré par Fernant Pelloutier, français comme son nom l'indique, militant syndicaliste révolutionnaire socialiste et libertaire (rien que ça...)
- Son premier fils se situe plutôt dans la mouvance de Noam Chomsky, intellectuel américain, linguiste engagé et de tendance anarchiste
- Pendant le second, dit "le Clopinou", n'hésitant devant rien, s'engage du côté du russe Michel Bakounine, fondateur du socialisme libertaire, philosphe et théoricien de l'anarchisme
- et que la copine d'icelui, toujours plus loin, se reconnaît dans le chinois Ba Jin, écrivain, romantique, espérantophone et anarchiste...
Ben voilà : c'est le bordel là-dedans.
Vous imaginez le cauchemar, quand il faut élaborer un menu qui plaise à tout ce monde-là ?
Anthrop' au logis
- Par clopine
- Le 11/04/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Comme une petite Margaret Mead, moi aussi je m'intéresse aux moeurs de ceux qui m'entourent, mais "à domicile", en quelque sorte. Ce que j'appelle de l'anthrop au logis, quoi. Il faut dire que mon principal sujet d'observation n'est autre que Clopin, natif du coin, que j'étudie minutieusement depuis quelque trente ans, et qui m'a permis d'avancer quelques hypothèses non scientifiquement prouvées sur la sociabilité brayonne. Mais en fait, avant d'écrire un quelconque article savant dans "le journal des anthopologues" du Musée de l'Homme, de la Femme et des habitants du pays de Bray, il faut quand même que je raconte l'anecdote, qui passe par la rencontre des deux "F." : rencontre fatale, puisque les deux F. élèvent des grands noirs du Berry... Ce fut fait cet hiver.
Les deux F. ne sont pas brayons, mais alors, pas du tout. Le premier est un de ces rares médecins généralistes qui acceptent encore de s'installer aux champs. Le second F , après une première vie dans l'industrie pharmaceutique, s'est reconverti : il produit désormais du lait d'ânesse, biologique et éthiquement irréprochable (ce n'est pas lui qui abattrait des nouveaux-nés ânons au motif qu'ils sont mâles et donc ne rapportent pas !), base de produits transformés dans la cosmétique et la pharmacologie. Leur implantation est solide, réfléchie, scientifique et (on l'espère pour eux !) fort rentable. L'habitation et l'exploitation sont remarquables : ancien corps de ferme parfaitement adapté, maison de maître élégante... Les deux hommes sont charmants, en plus : tout pour nous donner envie de nouer des relations...
Oui, mais voilà. F. n' a pas les codes !!! Et les codes, dans le pays de Bray, sont très clairs : décalquant de fort près les pratiques des îles Samoens, il n'est pas question, ici, de pratiquer le don, sans recourir systématiquement au contre-don. Je le sais : ça fait trente ans que j'observe le phénomène...
Car le brayon de base découpe le monde entier en deux catégories, qu'il passe son temps à délimiter, quitte à en tracer des frontières poreuses, faisant passer d'un côté à l'autre de la frontière tel ou tel, suivant l'état de ses relations avec le quidam en question. Le monde est donc divisé en deux : à savoir "ceux qu'il connaît" de "ceux qu'il ne connaît pas".
Le vrai brayon connaît donc, en tout premier lieu, tous les autres brayons dans un rayon de dix kilomètres autour de lui. Au-delà... Au-delà, la pratique sociale devient floue, soumise aux lois du commerce international et du capitalisme : la barbarie, quoi. En deça, le pacte est clair : les services et les produits cirucleront, mais suivant un code précis, quoique ni écrit, ni parlé. Ou, pour dire plus simplement, les échanges devront oligatoirement être équitables, scrupuleusement déterminés, rigoureusement suivis et devront démontrer, en dehors de leur valeur "en-soi", l'estime réciproque, le respect échangé, l'égalité de mise entre les personnes concernées (même si les niveaux sociaux ne sont pas les mêmes), et donc l'absolue impossibilité, pour l'une ou l'autre des parties, d'être taxée de poursuivre un but intéressé. ou, pire encore, de vouloir arnaquer l'autre... Ce qu'un brayon, par contre, n'hésitera pas à concevoir, s'agissant d'un ressortissant de la tribu de "ceux qu'il ne connaît pas"...
Ainsi, si vous arrivez chez votre voisin, un panier plein de légumes du potager à la main, (même s'il s'agit de surplus que vous n'auriez pu consommer, compte-tenu de leur profusion et de leur délai de fraîcheur), vous entamez du même coup une série d'échanges qui iront de la boîte d'oeufs frais déposée sur la table de jarin à, l'année suivante, le don de plants de tomates à repiquer tout prêts. Et ceci pratiqué avec toutes les règles de la politesse brayonne, à savoir un art de la conversation qui tourne résolument le dos à la vitesse contemporaine. Nous ne sommes pas, ici, dans la limite des 140 signes du message twitter, mais plutôt dans une proustienne conversation entre la Tante Léonie et Eulalie...
Auusi, sans le savoir, F. commet-il une "gaffe", en voulant à toute force nous ""offrir", par exemple, la luxueuse savonnette qu'il produit gràce à ses Grandes Noires (du Berry, hein...) ; car nous ne saurions l'accepter sans, à notre tour, lui fourrer dans son sac du miel maison, ou de la confiture, ou quelque autre produit. Telle est la terrible loi de l'étiquette, qui veut que l'offrande soit réciproque, sauf à être demandée au préalable, dans un grand accès de confiance dans la générosité de l'autre, exceptionnel chez le brayon moyen...
F. saura-t-il s'adapter ? Pourra-t-il seulement s'apercevoir , dans cet entrelacs social, de la vertu d'échange ainsi dégagée, parce qu'accumulée depuis des siècles, aussi calleuse que la paume des mains paysannes, certes, mais qui permet l'égalité entre le donneur et le donné ? Pour l'instant, ses cadeaux sont obombrés par son envie de bien faire. Il lu faudra du temps, disons, à vue de nez, une bonne trentaine d'années, pour vaincre la pudeur brayonne... Mais j'ai confiance !!!
Je me demande bien que ce Margaret Mead aurait dit de tout ça, tiens...
Madame la Présidente...
- Par clopine
- Le 07/04/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Vu que Madame la Présidente de l'association Beaubec Productions, c'est bibi, alors allons-y pour la toute dernière toute nouvelle toute chaude newsletter (lettre d'information d'après la clause Molière) !
Beaubec Productions - Newsletter N°32 

|
|
De gros poutous partout !
- Par clopine
- Le 05/04/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Je n'ai pas regardé le débat mais, écoutant Patrick Boucheron ce matin, ma curiosité a été éveillée. Et il faut bien l'admettre : une fois de plus, c'est de l'extrême-gauche qu'une parole disons "non-déconnectée du réel" (pour parler comme Patrick Boucheron) se fraye une toute petite place...
Never fail to me
- Par clopine
- Le 27/03/2017
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Prodigieuse écoute d'Arvo Pärt à la "'Tribune des critiques de disques" de France Mu. J'en suis sortie éblouie, non par la pertinence des analyses des invités, mais par la force de cette musique-là.
Vous me direz que le mysticisme imprégné médiéval de Pärt est à mille lieues de l'athéisme dans lequel je me reconnais. Mais c'est que je suis toujours fascinée par la musique répétitive (pour Pärt, je crois qu'on dit "minimaliste", m'enfin perso je ne fais guère la différence entre les versets de Téhilim d'un Steve Reich et le dernier mouvement de Tabula Rasa de Pärt, c'est ça qu'il y a de bien quand on est athée, on peut mettre le meilleur de chaque monothéisme dans le même sac harmonique, si j'ose dire ! Quand je dis "le meilleur", je parle de l'art qui découle de la spiritualité religieuse, car le pire, c'est-à- dire tout le "reste" qui émane des religions, ma foi (sic) ne vaut pas un pet de lapin, à mon sens éclairé !!! )
Et puis il y avait comme une évidence, une complémentarité entre le fonds et la forme, à écouter cette musique dans le format de l'émission de la Tribune, qui consiste, je le rappelle, à réunir d' éminents musicologues, journalistes musicaux ou musiciens, et à les faire choisir la meilleure interprétation d'une oeuvre en passant en boucle des extraits identiques. On aurait dit que le concept de l'écoute d'extraits tous "semblables" et différant seulement par l'interprétation était décalqué des ambitions de la musique répétitive.
Evidemment, Clopin a bronché. Clopin est absolument imperméable à la musique répétitive. Il se croit malin en demandant si l'instrument privilégié des compositieurs ne serait pas la scie musicale. Et explique que son aversion remonte à l'écoute prolongée d'un morceau répétitif (c'est le moins que l'on puisse dire !) de Tom Waits, chantant avec Gavin Bryars "Jesus's blood never failed to me", écoute que je lui aurais imposée sans aucun ménagement, provoquant désormais chez lui un rejet sans appel pour tout ce qui peut lui être rapproché.
Clopin n'a jamais entendu, dans ce morceau de Tom Waits , que la voix volontairement défaillante de Bryars, qui ressemble effectivement à celle d'un clodo enivré, prêt de sa tombe, chevrotant et maladif : que les paroles soient en réalité un jeu de mots (car je parierais que le "jesus'blood" dont il est question n'est autre que le bon vieux pinard), que Bryars soit un spécialiste de la facétie musicale, et surtout que l'orchestration de Waits, derrière ce filet de voix essouflé et agonisant, soit splendide, foisonnante et se déployant avec toute la majesté hémisphérique d'un orchestre symphonique, lui passent absolument au-dessus de la tête.
Clopin m'accuse en réalité de me complaire dans un dolorisme musical qui lui semble la marque de la musique minimaliste, et qu'il ne supporte pas, car, tout comme ses parents, Clopin n'oppose à la maladie, la finitude humaine et l'approche de la mort que le déni le plus radical. La seule réponse qu'il est capable d'y apporter est le détournement. Il détournera toujours les yeux de l'achèvement de la vie humaine, quand cette finitude est trop près de lui pour qu'il puisse lui oppposer l'indifférence de la conceptualisation abstraite. Déjà, il n'assume pas le rôle de garde-malade : alors, il est assez logique qu'il ne puisse écouter des musiques qui sont carrément issues de l'interrogation humaine sur la finitude... Et "Tabula Rasa" fait éminement partie des oeuvres sombres (mais sublimes) issues de ce genre d'interrogations. Le glas des cloches qu'on entend distinctement accompagner le motif musical, qui va s'assombrissant, nous le rappelle à l'évidence...
On pourrait d'ailleurs remarquer la contradiction qui existe chez Pärt comme chez Reich. Contrairement au Requiem mozartien, empli de l'allégresse de la promesse chrétienne d'un au-delà, ces musiciens pourtant pétris de spiritualité et assoiffés de religion cultivent une musique si sombre qu'elle en est désespérée. La fin de "Tabula rasa" me fait monter des larmes de compassion aux yeux : mais elle est aussi angoissante et bien plus, à mon sens, emplie de la finitude humaine que nimbée de l'espoir d'une quelconque résurrection.
En tout cas, nos attitudes, à Clopin et à moi, sont donc carrément opposées en ce qui concerne la musique dite répétitive. Là où il se détourne avec un frisson de dégoût, je me penche fascinée par le courage spirituel qu'il faut pour produire ces musiques - à la fois célestes et morbides- qui me semblent être l'expression du courage requis pour affronter notre finitude, en la sublimant. (et mon goût pour Pascal Quignard l'athée mystique n'est pas bien loin de cet univers-là. A savoir si cet écrivain-musicien connait Pärt, et ce qu'il en dit ?)
Bien entendu, ce clivage ne dépare pas l'absolue différence, voire la contradiction, qui nous sont habituelles à Clopin et à moi, qui ne sommes jamais d'accord sur rien... Mais il s'agit de la mort, et de son appréhension, ici...
Et c'est vrai que nous sommes ici à l'aboutissement de n'importe quelle relation amoureuse, à mon sens. Je veux dire que les paroles rituelles du mariage "... jusqu'à ce que la mort nous sépare" peuvent être entendues bien au-delà de ce qu'elles semblent signifier. Car, à première vue, elles nous disent que l'engagement va être seulement rompu à la mort des conjoints. Mais on pourrait aussi les entendre comme décrivant la frontière ultime séparant tous les êtres humains les uns des autres, même les plus proches -pas besoin d'être morts pour cela : car la question de notre finitude nous est posée à chacun de nous, et notre réponse est forcément singulière. Derrière cette singularité se manifeste l'obligatoire séparation qui peut s'établir dès le départ - pas besoin d'être dans une tombe pour être séparé de l'autre, puisque l'idée simple de la mort, et la façon dont chacun de nous l'appréhende, nous sépare bien plus profondément qu'aucune promesse ne nous rapproche.
Clopin n'écoutera jamais Arvo Pärt - je l'écouterai, tremblante, fascinée et admirative- sans cesse. Tant pis, tant mieux : ce n'est que l'illustration de la limite (volontairement ignorée, comme lorsque Pagnol nous dit qu'il n'est pas nécessaire de dire aux enfants que la vie n'est que quelques illuminations de joie, effacées par d'inoubliables chagrins) que notre finitude trace à chacun d'entre nous, dans notre "for(t) intérieur"...
Ah oui, le lien vers Tabula Rasa : https://youtu.be/8HON4AswPVk
PS : je ne sais absolument pas si j'ai été claire dans ce billet. J'y défends trois idées successives, ça doit être deux de trop à mon avis. Pourtant, je "conçois clairement" mon propos. Mais quant à l'"exprimer clairement", voilà le souci !
Des nouvelles de mon âme
- Par clopine
- Le 22/03/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Je pourrais "faire dans le quotidien" :
* raconter le rendez-vous avec Clopinou - incroyable, partis de Beaubec à 14 h, nous avons garé la twingo n'importe comment sur la place de la Sorbonne à 16 h 15 et à 16 h 18 nous retrouvions le fiston : ça c'est de la chronoexactitude !
* faire état du récit dudit Clopinou, qui a amené comme une narquoiserie dans l'atmosphère : juste avant de nous retrouver, le Clopinou était assis à côté d'Alain Badiou, dans un amphi de la Sorbonne, pour une conférence sur Marx. Il paraît donc que ça a dégénéré entre ledit-Badiou et le conférencier - qui se sont proprement insultés à la fin, après un débat sur le "nombre de morts dûs au stalinisme" (ah là là !) . Heureusement que Clopinou a suffisamment de bon sens pour hausser les épaules devant les débordements de son voisin, et qu'il continue à penser par lui-même : ce qui me rend, finalement, encore plus fière de lui que de ses résultats (qui ne sont pourtant pas médiocres !!!)
Je pourrais "faire dans le beaubecquois" : vous raconter que nous avons des doutes sur le compotrement de notre chien bien-aimé (trop aimé ?) : il semble, en vieillissant, développer une dépendance qui le conduit à ne plus supporter que nous soyons absents. Il a grogné après notre voisin, ce qui ne lui était jamais arrivé !!!Plus grave : il a grogné aussi apèrs Clopin... Bon sang, les animaux, s'ils sont conscients des interdits, n'ont aucune capacité à discerner le mal du bien : notre chien aurait-il une dégénrescence neuronale, ou une quelconque pathologie psychologique ?
Ou bien le chien partage-t-il avec moi le vrai sujet que je voulais aborder aujourd'hui : le mal à l'âme ? Je suis en effet persuadée que nous en avons une, d'âme, qui se présente et s'évanouit, s'enfle et se dégonfle, apparaît et disparaît, au gré de notre souffle, de nos pensées, de nos chagrins ou de nos joies. Un ballon extensible, parfois douloureux, parfois extasié, qui réunit en une seule et imperceptible entité notre inconscient, nos émotions, notre corps et notre intelligence. Seule différence avec l'âme des croyants : la mienne (et celle de mon chien) est parfaitement mortelle - et elle est atteignable ; j'en veux pour preuve le mal de chien qu'elle me donne quand il s'agit d'apprender le passé et l'avenir. Comme si l'âme, finalement, n'était supportable qu'au présent, quand elle est tenue à la discrétion par la laisse de la réalité... Soupir.
Violence et beauté
- Par clopine
- Le 14/03/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Sans doute y'a-t'il un lien entre l'absence de beauté et la violence : ce qui expliquerait pourquoi nos contemporains s'acharnent ainsi sur le pauvre monde - leur terre nourricière et leurs semblables. En tout cas, moi, le soir, j'ai du mal à dîner et regarder en même temps les nouvelles d'ARTE : pourquoi faut-il que ce soit les plus innocents d'entre nous, les enfants, qui trinquent ainsi ?
Il y a une suffocation des images, de la violence quotidienne, qui nous force à nous anesthésier. Se précipiter vers la fenêtre, l'ouvrir, s'abreuver à la beauté du crépuscule beaubecquois, certes :


Mais ne pas oublier que derrière la douceur rose et bleue du crépuscule normand, la violence du monde tabasse, elle, et plutôt dans le rouge sang.
La liste...
- Par clopine
- Le 13/03/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Tombée dans le tonneau Netflix, je suis désormais les séries américaines - il faut dire que Clopin, devenu accro à Breaking Bad, insiste largement pour que je partage cette nouvelle passion- et qu'il y a, ma foi, quelques solides arguments qui penchent en la faveur de ces sortes de feuilletons (façon "les Trois Mousquetaires") revisités : le format permet d'installer des problématiques psychologiques qui peuvent enfin se déployer , et parfois même le vieillissement des acteurs est prévu et légitimé par la durée du récit, comme dans "Dowton Abbey", série non US mais néanmoins répondant parfairtement au cahier des charges du genre. On ne peut que constater le rôle de "pare-feu" que ces séries jouent face aux "blockbusters" qui vous envoient des scènes d'action bombardant 20 images/secondes, dans un mode qui s'apparente à un shoot répété par intraveineuse...
Le mode narratif de la série a cependant ses limites : je m'en aperçois en avalant, épisode après épisode, "Orange is the new black".
Cette série a normalement tout pour me plaire : le sujet (ça marche comment, une prison de femmes américaine ?), le propos sous-tendu (ouvertement pro-gay), le mode de traitement (chaque caractère possède ses deux faces d'ombre et de lumière, mais disons que le regard qui est porté là est globalement plutôt bienveillant voire affectueux).
N'empêche qu'il y a là quelque chose à quoi je résiste, et je n'arrive pas à savoir quoi, exactement.
J'ai d'abord incriminé une sorte de complaisance : il y a beaucoup de scènes de cul et les propos sont d'une vulgarité insensée. Mais si l'on réfléchit que cela se passe dans une prison, cela devient plus crédible. Certes, on peut toujours soupçonner qu'il s'agit ainsi de racoler les spectateurs friands de gros plans "érotiques" et ricanant devant un vocabulaire osé... Mais en tout cas, ce n'est pas l'origine de mon malaise : mon recul ne vient pas d'un sursaut de morale effarouchée.
Je vais sans doute trouver l'origine de mon recul avant la fin du visionnage - car j'irai jusqu'au bout, étant donné que l'addiction marche en plein, évidemment !
C'est marrant : en regardant cette série, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une des internautes les plus perfidement pleines d'humour, souvent ravageur, que je fréquente sur facebook : Nicole Garreau. Le personnage qu'elle fabrique et met journellement en avant a beaucoup de points communs avec les héroïnes principales (disons parmi les détenues blanches) de la série : la jeunesse "tourmentée" avec le tutoyage de la délinquance, la nature addictive aux substances psychotropes, la gay attitude et le sentiment de solitude caché sous les gros sabots de la dérision (elle joue un rôle de "dictateuse" dérisoire et sentencieuse...)
Je ne sais évidemment pas si la "vraie" Nicole Garreau est comme cela : mais telle quelle apparaît sur internet, elle pourrait facilement appartenir à la tribu déjantée que Piper Chapman est en train de commencer à préférer à sa "vraie" famille (j'en suis à la saison trois, et si j'étais les scénaristes, j'inventerais bien un "choix" final de Piper de rester en taule !)
Ce qui est drôle aussi, c'est qu'on apprend plein de trucs sur les prisons -et donc la justice- américaine, qui semble être une Dame qui propose des Deals aux criminels, ce qu'on a du mal à imaginer vu de France. J'ai appris aussi que, pour recevoir des visites, les détenues inscrivent des noms sur des listes, qui permettent de filtrer les visiteurs. Cette sorte de liberté accordée aux détenues - liberté parce que ce sont donc elles qui choisissent de recevoir qui bon leur semble, au final- m'a bien entendu fait divaguer ...
Admettons que je sois coffrée dans une geôle effrayante et souvent sordide, quoique néanmoins pleine d'humanité. Qui insrirais-je sur ma liste d'invités ?
La question est moins simple qu'il n'y paraît : car cette inscription implique d'une part, de surmonter la culpabilité (faire venir des gens rien que pour vous voir, alors que vous ne méritez sûrement pas le souci et la perte d'énergie, sans compter l'effroi et le malaise, que représente une visite en prison), d'autre part, de se reconaître comme dépendante (puisque vous avez si besoin de les voir que vous n'hésitez pas à leur demander de venir). Cette liste répond donc à la question : "qui est suffisamment important pour moi, et moi pour lui, pour qu'il accepte de subir cette épreuve ? Qui m'aime assez, et qui j'aime assez, pour cela ?"
C'est effrayant : après quelques minutes à ruminer, je n'ai trouvé que trois noms à inscrire sur ma liste...
Mais il est vrai que je ne suis PAS en prison, sinon, peut-être, celle de ma solitude : mais cette dernière est librement choisie, et c'est un des choix les plus doux...
L'arrêt taurique
- Par clopine
- Le 11/03/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Jamais encore - même en 2002 - je n'avais eu une telle impression de confusion et de débâcle. C'est que cela va faire la seconde fois que le F Haine va être présent au second tour de l'élection présidentielle. Or, si, à la première secousse, on avait pu plaider la surprise, le coup fourré, la sortie de route en quelque sorte, en 2017, et dans le contexte mondial, on ne peut plus, à mon sens, aller voter et s'en laver les mains après.
Parce qu'en 2002, comme 82 % des français, eh oui, j'étais allée voter...
Mais justement.
J'avais voté "contre", bien sûr. Chirac a fait comme s'il ne le savait pas, qu'on ne votait pas pour lui mais CONTRE Le Pen. Ca a donc servi à quoi, mon vote ?
Et après lui ?
De pire en pire.
Alors voilà. Je n'ai pas forcément d'opinion sur les programmes des uns et des autres, sur leur "vision de la France", sur leur honnêteté ou plutôt le degré de leur corruption. Je pense simplement que, quand le F Haine crie "tous pourris", il omet de dire que lui aussi barbote dans la mare aux canards. Et que derrière la véracité et la vraisemblance de ce cri (je dis "vraisemblance", parce que je pense qu'il doit rester quelques représentants honnêtes tout de même, mais la suspicion est désormais telle que bien malin qui pourrait trier le bon grain de l'ivraie. Disons qu'a priori, une Taubira ou un Mélenchon paraissent sincères et animés par le bien public. Mais combien peu nombreux semblent-ils, aujorudh'ui !!!) , il y a une attaque contre la démocratie, une attaque démagogique et bien connue, car c'est celle que tous les bons vieux fascismes pratiquent et ont pratiqué.
Mais au-delà de ça, tout de même... Chirac, Sarkozy, Hollande... Depuis 2002, quel gouvernement s'est réellement attaqué à la montée de l' extrême-droite ? En quoi voter Hollande, par exemple, a-t-il permis de voir en quoi que ce soit la situation améliorée - notamment pour les étrangers ? En quoi le score du F Haine a-t-il baissé ?
Plutôt que de se gratter la tête en se demandant si, tout compte fait, on ne va pas aller voter Macron dès le premier tour "pour faire barrage", ou au moins au second, ne serait-il pas temps de se rendre comtpe que, si on fait ça, on ne fait pas barrage, non... Rendez-vous dans 5 ans les amis dans ce cas - de combien de pourcentage l'extrême-droite devra-t-elle augmenter ses scores, à chaque fois, avant qu'on ne se rende compte de l'illusoire du "barrage" ?
Est-ce qu'on peut croire sérieusement que "ne pas voter Macron, c'est ouvrir la porte au F Haine" ?
Mais notre caste politique lui a depuis belle lurette ouvert la porte, bon sang, à gauche comme à droite : Et un Fillon lui place en plus le tapis rouge sous les pieds, puisqu'il reprend ses thèses sur la majorité des questions, avec ce simple bémol que la droite, elle, ne veut pas porter le coup fatal à nos institutions (tu parles, elle les utilise à ses fins personnelles et s'en fiche bien de la voir sapée par en-dessous) !
J'y étais, moi, dans la rue, contre la loi El Khomry. J'ai trouvé ça bien, moi, les "nuits debout", même si je reconnais que ce n'était pas les "djeunes des quartiers" qui y participaient. Et j'en ai marre qu'on tente de me culpabiliser en disant que si Le Pen passe au second tout, ce sera ma faute...
"TU VEUX QUE LE F HAINE PASSE ?" Voilà l'argument qu'on m'assène, quand j'ose dire qu'à mon sens, ce n'est PAS en votant Macron au second tout qu'on va résoudre le problème...
Alors NON JE NE VEUX PAS QUE LE F HAINE PASSE. Mais si nos institutions sont dans les mains d'une caste qui, assise sur ses privilèges, s'avère totalement incapable de le contrer, il est hors de question que j'aille voter pour un enième énarque, un énième défenseur du capitalisme, un enième rat qui bouffe le gâteau en nous disant contrôler le truc, alors que l'extrême-droite ne fait que monter, monter, monter...
Le SEUL PROGRAMME qui pourrait m'inciter à aller voter au second tour devrait s'appuyer sur la démonstration des mesures qui feront reculer l'extrême-droite : l'affirmation d'une politique anticapitaliste, féministe et écologiste, l'accueil des étrangers, la défense des roms et des maghrébins vistimes de racisme, l'extension de la laïcité et la construction, ensemble, d'un nouvel espace social avec de nouveaux modes de représentation républicaine.
Et ce n'est pas avec Macron qu'on commencera à faire le premier petit pas dans ce sens...
Off t"as le mot...
- Par clopine
- Le 07/03/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Les consultations d'ophtalmo à Charles Nicolle (le monstrueux hôpital de Rouen, qui entasse les pavillons pêle-mêle, au beau milieu d'un quartier qui n'en a plus que le nom, éventré de voies de circulation mal définies et de zones de parking sauvage) sont toujours surprenantes : le miracle d'être reçue par deux professionnels (jeunes, il est vrai, mais désormais les trentenaires m'apparaissent souvent comme des bébés...) en très peu de temps contraste tant avec la quasi-impossibilité d'avoir un rendez-vous avec un ophtalmo "de ville".
Pour ce dernier, dix mois d'attente sont désormais la norme. Pour les premiers : je n'ai attendu ni à l'accueil du pavillon central, celui aux "portes condamnées" (ah bon ? Elles aussi ?) ni à l'accueil du service, et dix minutes simplement dans la salle d'attente...
On est donc reçus, et vite, efficacement et soigneusement, aux urgences ophtalmologiques. Mais dès qu'on parle avec les médecins, et notamment du contraste entre l'efficacité hospitalière et les délais en ville, les visages se ferment. Mes deux jeunes médecins m'ont mise mal à l'aise tout de suite, comme si j'étais vaguement scandaleuse d'évoquer un numérus clausus aberrant, qui conduit pourtant à cette situation. Est-ce parce qu'ils ont bien l'intention, une fois leurs internats terminés, d'en profiter à leur tour ?
Je suis sortie de là en ayant un peu écarté l'épée de la cécité, qui se balance toujours sinistrement (comme la lampe au-dessus de la tête de l'assassin du Corbeau de Clouzet) au-dessus de mes pauvres yeux. Il semble que je vais pouvoir me servir encore un peu de ces derniers...
L'envie d'acheter des livres, que j'avais ces derniers temps suspendue à la patère de ma vision, m'est revenue d'un coup, d'autant plus forte que je l'avais remisée. Pas ^sure que ma carte bleue ne va pas, à son tour, souffrir comme ma cornée d'un précoce désséchement, si j'assouvis toutes mes envies.
Au premier rang desquelles le "dictionnaire des féministes", évidemment. L'achat est d'importance, mais si je pouvais y trouver matière à divagation, notamment sur le thème "féminisme et écologie", qui suscite chez moi quelques solides interrogations...
La vie sans Clopinou...
- Par clopine
- Le 06/03/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
La nouvelle amie du Clopinou est haute comme trois pommes. Mais pas à genoux. Ah non ! Pas à genoux !!! (très large sourire !)
Pas d'école pour Pascal...
- Par clopine
- Le 04/03/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Je pourrais dire tout simplement que Pascal Quignard m'étonne - ce qui, l'âge et la raison aidant, m'arrive de moins en moins - mais ce ne serait pas suffisant pour expliquer l'intérêt que je porte à ce drôle de bonhomme.
Certes, au niveau biographique, lui et moi avons un point commun, que nous partageons avec des myriades d'autres êtres humains : celui de ne pas avoir été désiré. Mais cela ne suffirait pas à justifier la lecture ardue, secrète, mystérieuse, en un mot : sentant l'effort, que je pratique pourtant, presque malgré moi.
J'ai également discerné ce qui, pour moi, fait la particularité de cet auteur : il s'attache à des objets, comme "la pensée", "le temps", "la sexualité" qui sont depuis belle lurette des incontournables de la pensée philosophique ou scientifique. Mais lui ne s'inscrit dans aucune de ces démarches : il n'en a cure, et trace obstinément une voie qui, pour toute érudite qu'elle soit, n'en est pas moins irréductible à quoi que ce soit de connu.
Je l'ai une fois comparé à un diamantaire, qui, devant une pierre brute, met au jour les facettes au départ invisibles de son objet d'étude. Mais il va sans dire que cette comparaison pourrait être tout aussi vraie de n'importe quel philosophe attelé à son concept. La particularité de Quignard, c'est bien qu'il n'adopte pas la démarche philosophique. Qu'il lui tourne même, presqu'ostensiblement, le dos...
IL va donc procéder, très précisément, comme un mosaïste. Regardant son sujet sous toutes les facettes, mais à l'aide d'outils de savoir non utilisés par les autres. Par exemple, l'ourage commencera par un récit tiré de tel manuscrit datant du moyen-âge, racontant telle anecdote historique ou religieuse, contenant un rapport plus ou moins loitain avec son sujet. Et là où d'autres chercheraient à mettre en parallèle l'enseignement tiré de l'histoire en faisant un parallèle avec notre modernité, Quignard, lui, nous invite à le rejoindre dans l'espace-temps où l'histoire, ou historiette, ou fable, ou anecdote, ou récit, fut inscrit. Il nous invite à faire le chemin inverse de celui qui nous est d'habitude proposé : nous voici sommés, si nous le suivons, à réfléchir, à réagir, à penser le réel comme tel ou tel protagoniste médiéval, ou latin.
Je dis "ou latin" à dessein, puisque le propos de Quignard, tournant le dos à la philosophie, l'emmène bien évidemment plus volontiers dans la Rome antique que dans la Grèce de Périclès : les Grecs ne faisaient rien d'autre que de la philosophie. Les latins, eux, construisaient patiemment l'idée de droit, et tentaient de résoudre ainsi les trébuchements de leur société. Nul doute que Quignard se sente plus volontiers de leur côté - nonbostant sa résistance à l'idée de dieu (qui est encore quelque chose que je patage avec lui, mais là, nous sommes bien moins nombreux, hélas !) - car les plus belles mosaïques sont bien romaines, et non athéniennes... Et puis, il y a dans cette tentative latine de définir le droit, quelque chose qui, transcendant la philo, amène directos à l'humanisme (qui est le sujet caché de toute l'oeuvre quignardienne, son interrogation profonde sur son individualité, son refus d'inscrire sa sensation de soi dans la lignée des idées communes à ce sujet, cette croyance que la lumière viendra de la juxtaposition d'éléments disparates, ce paradigme qu'il fait toujours entre le récit et l'ineffable de la musique...) : dépassant la loi "naturelle" - c'est-à-dire "sans morale", un chien ne sait pas le bien ou le mal, il connaît juste l'autorisé et l'interdit, (ce qui fait le rêve de tout dictateur : ne réfléchissez plus, ne tentez plus d'être face au monde, laissez-moi vous dissoudre dans le monde magique où la vérité est dans l'abolition de la pensée et l'adoption de la Loi) - et tentant de proposer des codes qui refléteraient une société "civilisée"...
Quignard s'appuie sur son érudition pour nous emmener dans un chemin extrêmement étroit, réduit à lui-même en quelque sorte : c'est en cela qu'il ne pourra jamais être assimilé. N'importe quel autre penseur (mais Quignard divague plus qu'il ne pense, ou plutôt, il ne cherche pas à "penser", il cherche à obtenir le plus de reflets possibles de la pierre qu'il taille) éprouve, tacitement ou ouvertement, le désir de "faire école". Quignard, lui, ne montre aucun chemin. Surtout pas. En ce sens, il n'est pas non plus du côté des Lumières. Il nous invite simplement à venir avec lui descendre dans l'obscur...
Evidemment, c'est casse-gueule. Mais on y trouve tant de beautés. Certes, c'est une posture qui n'interroge pas notre monde contemporain, puisque tout ici est fait pour qu'on rejoigne ceux qui nous ont précédé, au plus près d'eux-mêmes et non de nous. Mais la splendide solitude qui en découle n'est-elle pas la seule réponse que l'incomparable érudit pouvait apporter à sa présence au monde ?
Hmmmhhhhh ???
Le crépuscule des yeux
- Par clopine
- Le 03/03/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Le rendez-vous chez l'ophtalmo est fixé au mois de juillet. Mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir attendre jusque là, tant la brûlure de mes yeux devient désormais permanente.
Au boulot (sept heures d'écran par jour), me voilà obligée de porter des lunettes de soleil pour supporter la luminosité des écrans. A la lecture, je dois avori recours à la loupe, ou à une lumière puissante (qui abîme encore un peu plus) pour discerner les caractères. Et la douleur est désormais constante.
j'ai toujours fait le rêve, né d'une conviction bizarre de la justice, d'une vieillesse heureuse. C'était compter sans ses infirmités. Oh, je dois relativiser : les vieux d'aujourd'hui ne sont plus les pauvres infirmes d'hier... Il n'empêche : la métaphore de 'la nuit qui vient" pourrait bien, dans mon cas, se revéler plus douloureuse que je ne l'avais escompté.
Payer l'addiction...
- Par clopine
- Le 02/03/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Par nature, je suis addictive. Enfin, comme on dit aujourd'hui. Au 17è siècle, on aurait peut-être parlé de "fidélité", au sens de clientèle et de loyauté...
En tout cas, tombée dans les pièges de l'addiction (c'est-à-dire de la facture qui est toujours brandie, à la fin), je ne connais qu'une manière de m'en sortir. Celle de la louve qui, prise au piège, consent à se séparer de sa patte, en échange de sa liberté.
Au Québec, un jeune animateur de pourvoirie, afin de justifier les modes de chasse actuelles, a un jour enfermé mon poignet (qui, du coup, était si menu, étroit et fragile qu'on aurait dit une patte de sauterelle) dans un "nouveau piège", entendez un piège à loups mais caoutchouté de manière à ne pas blesser l'animal pris. Je n'ai pas osé, tant le discours du jeune homme était empli de sincérité et de passion pour les animaux qu'il disait côtoyer tous les jours, lui demander si, malgré l'absence de douleur physique , certains continuaient néanmoins à préférer la mutilation. Il m'aurait répondu "non", convaincu. Je suis certaine du contraire. C'est ce qu'on appelle "y laisser des plumes". C'est la loi.
J'ai donc rogné ma peau, entaillé mes veines et scié mes os, mais j'ai décidé d'arrêter de fréquenter la République des Livres. Une de mes plus grosses addictions. Il y a quelques jours, un des participants à ce blog littéraire a été enterré, et son départ a reçu des hommages mérités. Je n'en attends pas tant : je sais que sur ma tombe virtuelle (car mon dernier commentaire était un adieu) tomberont très certainement trois roses, et vingt brouettées d'indifférence ou de méchanceté. Peut-être mon départ est-il aussi ma manière de saluer le disparu ?
J'ai un jour dit à un jeune médecin (j'impressionne toujours les médecins, je m'en suis rendue compte à leur empressement à me prescrire tout ce que je peux bien leur demander) que ma seule addiction, en réalité, était Clopin. Je disais ça en souriant... Mais pour le prouver, ne faut-il pas d'abord que je me débarrasse de toutes les autres, grandes et petites ?
Comme les apnéistes, le sevrage s'opère par palier, quelque soit l'addiction à traiter : disons que je vais commencer par me contenter de lire le Magazine Littéraire, et de m'emporter, comme il m'arrive si souvent, contre les opinions qui y sont émises et le style vulgaire et manichéiste avec lequel on y exècre certains auteurs. Mais je ne porterai plus mes indignations "là-bas" : c'est le début du traitement !
Et nous verrons bien si mes démangeaisons littéraires survivent à l'abstinence, et à la réflexion...
Bye Bye Larry...
- Par clopine
- Le 22/02/2017
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Tellement aimé ça... Ca s'appelle "twin house", ça n'a pas vieilli (mais Larry Corryel est mort aujourd'hui !)
Sinon, pour répondre à Paul Edel : oui, sans doute avez-vous raison - jamais de trève, jamais de repos, et un monde toujours et sans cesse sanguinolent. Je persiste cependant à penser que nous assistons effectivement à la renaissance des vieux démons - le nationalisme, le repli sur soi- et que tous les néofascismes en profitent. Je voudrais vous dire aussi que le repli sur le privé est un peu plus difficile à pratiquer quand on a un fils et un beau-fils de respectivement 23 et 33 ans : de jeune adultes, qui peuvent basculer du jour au lendemain dans un monde bien plus violent que celui que nous voulions leur léguer. N'avez-vous jamais ressenti cette sorte de responsabilité, vis-à-vis de vos enfants, et cette sorte de honte, à voir toujours ressortir les mêmes spectres que ceux que d'autres, avant nous, ont bel et bien dû combattre ?
je soupire d'avance : le résultat du prochain scrutin a toutes les chances de me faire, une fois de plus, arpenter les rues. En vain, bien entendu, en vain..
L' Ecosse (art)
- Par clopine
- Le 21/02/2017
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Nous partons en mai pour l'Ecosse. Ca laisse trois mois à Clopin et Clopinou pour se préparer...
L' excitation de la bougeotte
- Par clopine
- Le 11/02/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Ca se passe comme ça d'habitude : la kangoo (avant et pendant longtemps, jaune PTT, désormais bleu glacé) est pile devant la porte, Clopin et moi nous agitons là autour, déplaçant les sacs et posant le pique-nique à portée de mains, le chien, alllongé sur le carrelage de la cuisine, nous regardant de loin et d'un air lugubre (il sait que, sauf exceptions, il restera là, et prend toute l'agitation nocturne pour un abandon caractérisé - il est à deux pattes d'écrire à la SPA, et même s'il sait parfaitement que tout est prévu pour lui, il estime qu'on aurait pu mettre en place une cellule psychologique, ou au moins une psychothérapie décennale).
Et puis c'est le départ en pleine nuit.
Longtemps, le dernier acte était d'aller chercher le Clopinou dans sa chambre, de le descendre enveloppé dans la couette, de le déposer à l'arrière de la voiture avec son oreiller, tel un petit papoose parti sur la piste des bisons. Certes, il ne s'agissait plus ici, que de rejoindre l'autoroute, et les bisons ont des doubles pneus , des feux à l'arrière et la mention "TIR" apposée sur la porte salie.
Mais nous sommes des humains, et quoi de plus humain que l'excitation de la bougeotte, quelles qu'en soient les conditions ? Pendant longtemps, j'ai appréhendé, pour le fiston, l'inconfort de ces départs. "Tu rigoles", m'a-t-il répondu récemment, "c'était le meilleur : j'adorais ça. Etre porté dans l'escalier, rester dans la couette, savoir qu'on partait, garder les yeux fermés et les ouvrir juste comme ça, très vite : pourquoi croyais-tu que je faisais semblant de dormir ?"
J'aurais pu m'en douter...
Comme tous les ans à pareille époque, le départ se fait, pour ces vacances-ci, sans moi : je reste avec le chien (!) - je ne skie pas, et il n'est pas désagréable de rester seule, lorsqu'on sait que cette solitude a un terme.
Il ya quelques années, j'aspirais même à cette rupture - le boulot, plus le quotidien, les repas et la maison, c'était lourd, et d'un coup je me retrouvais légère. J'ai beaucup moins besoin de cette halte désormais, je l'appréhende même un peu - des fois que je ne me joue des tours et ne découvre, à force d'introspections et de vagabondage mental, une Clopine douloureuse, seule en face d'elle-même.
Un peu comme le chien, quoi.
Une Arendt dans le gosier...
- Par clopine
- Le 02/02/2017
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Perso, aprèsa voir visionné le film (j’allais écrire « documentaire » !) sur Arendt, hier au soir, j’ai pensé que la banalité du mal vient certes de la médiocrité d’une pensée fanatisée ET administrative, mais aussi, plus globalement, de notre déconnection du monde sensible. (même si ça doit vous faire hurler tous, je trouve que la racine est la même. Y’a qu’à aller visiter une usine de porcs pour comprendre ce que je veux dire : c’est un cerveau « nazi » qui a inventé ça, pas possible autrement°
J’ai attrapé un stylo pour noter que, quand Arendt parle de l’homme devenu « superflu » dans les camps de concentration (avec la destruction totale des valeurs qui s’en suit), on pourrait étendre cette notion à la nature : elle aussi est devenue « superflue » pour tellement de nos contemporains ; la publicité pour la Renault Scénic est pour moi tout aussi banalement terrifiante qu’Eichmann – en encore plus sournois, en quelque sorte.
La déclinaison actuelle de la pensée d’Arendt, c’est aussi Daech, qui rentre parfaitement dans le schéma totalitaire éclairé par la philosophe.
(j’aurais voulu en savoir tellement plus sur cette pensée mais le « biopic » était trop restreint à ce niveau-là.)
ah oui, lien vers la pub, pour que vous voyiez ce que je veux dire quand je parle de « terreur » : une vision de l’avenir totalement irréelle, quoi. Ou la moindre brindille devient « superflue »… https://youtu.be/1N-uNgCS_xg
A(h) A(h) A(h)
- Par clopine
- Le 31/01/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Bien sûr, mon désengagement militant auprès de la Fédé n'en a pas pour autant amoindri mon intérêt pour les idées et les convictions qui étaient agitées là. Passant ainsi de l'anarchie au féminisme, puis à l'écologie, je me rends bien compte qu'on pourrait m'accuser de Bouvardetpécuhettisme - je ne serais certes pas la seule -mais je ne crois pas que c'était le cas.
Je tâtonnais, ça, c'est sûr, d'autant que je ne disposais pas du corset universitaire - qui certes rigidifie les pensées, mais qui permet néanmoins de se tenir droit. Mais contrairement aux héros flaubertiens, je conservais soigneusement, à chaque étape, ce qui m'avait nourri à la station précédente. J'étais en réalité une éponge, tendue vers tout ce qui pouvait à la fois m'expliquer le monde dans lequel je devais vivre, et me donner l'espoir de me bâtir autrement que ce à quoi j'étais destinée. Echapper au déterminisme, cela avait à voir avec le refus de la violence de la discipline.
ca donnait un drôle de mélange dans ma tête, qui aurait pu m'acculer à confusion, si je navais pas quelques solides garde-fous. Et d'abord, la conviction que toutes les théories, toutes les opinions, tous les soubresauts intellectuels se fracassaient contre la réalité. Aucune des théories si intelligentes du dix-neuvième siècle n'avait réussi à façonner le monde autant que la volonté d'un capitalisme triomphant - ça n'était pas les stériles terrils, (qu'on finirait bien par prendre pour des témoins religieux tels des pyramides), qui allaient me contredire. Pour remonter moins loin, pendant que je m'approchais, fascinée et démunie, du monde magique des idées, le moindre programmateur informatique préparait mon avenir - et j'ai moi-même participé, lors de petits boulots à la DDE où il s'agisait de comptabiliser le trafic routier, à l'encombrement du monde sensible auquel j'appartenais : il fallait doter la terre d'infrastructures routières aussi pratiques qu'arides - contre-vivantes : la palme, dans le genre, revenait sans doute aux parkings de supermarché.
Cette prise de conscience, cette révolte, a toujours sous-tendu mes prises de position. J'étais à la fois persuadée que seul l'individualisme issu de l'humanisme était supportable, en l'état, mais que cette indivudualisme me rendait paradoxalement si dépendante d'un univers collectif mortifère que c'en était pitié. J'ai écrit il y a quelque temps que Kukas avait eu une sacrée prescience, en assignant à l'homme du futur - foetus intergalactique - du film 2001 l'odyssée de l'Espace, un destin lié à un "monolithe noir" qui ressemble furieusement à un de nos portables. Nous ne le savions pas encore, mais tous nos soubresauts politiques ne faisaient pas le poids, devant la marche inexorable de ce que d'aucuns appelaient "progrès", et qui ressemblaient au fourmillement mortifère d'une termitière détruisant son propre écosystème.
Quoi qu'il en soit, si je relativisais les théories libertaires qui me séduisaient tant (et d'autant plus que, restées inexpérimentées, elles n'avaient pas eu le temps de prouver ou d'infirmer leurs vertus), je n'en conservais pas moins "mes trois A" : l'anarchie, l'altérité, l'altruisme.
L'altérité était sans doute la cheville ouvrière qui pouvait relier le féminisme à l'anarchie : contrairement aux fascisme d'extrême-droite, auquel il est parfois associé, le mouvement libertaire garde toujours, précieusement, le sentiment de l'existence et de la dignité de l'"autre". Ce qui sous-tend également, dans une perspective humaniste et universaliste parfaitement illustrée par un Condorcet, les combats féministes...
(la suite à plus tard...)
Je voulais écrire un texte sur le féminisme et l'écologie.
- Par clopine
- Le 27/01/2017
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Je voulais écrire un texte sur l’écologie et le féminisme. Mais à peine avais-je tapé ces deux mots sur mon azerty que, (là, au choix, une métaphore :
- Telle une viennoiserie dans de l’earl grey,
- Tel le ballet récurrent et nostalgique des feuilles mortes venant recouvrir le sol de l’automne,
- Telles les bulles qui remontent à la surface quand vous pétez dans le bain, au risque de passer pour une grosse feignasse qui y passe des plombes.
Suivant vos goûts et votre personnalité, vous pouvez choisir l’une des options…), un souvenir s’est imposé, et je me suis retrouvée dans un garage non chauffé d’une rue montueuse, à Rouen, dans les années 70-80, assise sur une chaise bancale autour d’une planche posée sur des tréteaux, sous la lumière faible et clignotante d’une unique ampoule : dans le local de la fédération anarchiste locale, quoi (les connaisseurs auront reconnu, mais ce seront bien les seuls, car nous étions 6 ou 8 seulement).
"Eh bien, pourquoi n'écrirais-tu pas un article sur les rapports entre l'anarchie et le féminisme ?"
Je ne me souviens plus ni du nom, ni du son de la voix qui me posait la question. Mais je me revois l’entendre, incrédule et impressionnée.
C'étaient des années où les discussions politiques avaient lieu partout, tout le temps, et pendant des heures interminables. J'y participais parce que j'avais reçu, au lycée, de la part d'un prof trotskyste, une formation politique qui avait débouché, chez moi, sur la conviction qu'aucune dictature du prolétariat ne pourrait changer l'humanité. Seule l'anarchie, avec sa revendication fondamentale d'égalité, ses aspirations à un monde économique fondé sur l'autogestion et son rêve de fédéralisme fractal (c'est-à-dire reflété et répété de la cellule familiale à ce qui allait remplacer l'Etat) m'avait persuadée de "m'engager".
Et puis, confusément, je sentais déjà que j’étais « à part ». Il me semblait ressentir, par exemple, bien plus fortement qu’autrui, la violence de la discipline. Je n’acceptais que celle que je m’imposais, mais ne pouvais m’empêcher de renifler, (et re :
- comme une bête sauvage le fait avant de s’élancer hors de son abri
- comme le SDF pas persuadé du tout de sortir intact de l’hébergement nocturne prévu par les autorités
- comme l’humaniste au moment d’ouvrir le dernier Houellebecq)
les autres. Encore maintenant, j’ai toujours un sursaut devant les règlements intérieurs, par exemple. Même (et surtout ?) ceux que Clopin édicte au gré de ses préoccupations quotidiennes, comme la fermeture des portes des placards et des portes, l’entretien du congélateur ou l’interdiction de marcher dans le potager, bref.
Ce sursaut, légitime ou non, est sans doute une des causes de mon indissolubilité dans le collectif. Et même le groupuscule anar dont je parle aujourd’hui a été encore « trop » pour moi. Mais n’anticipons pas.
Très vite, je suis devenue la meilleure vendeuse du Monde Libertaire, surtout le samedi après-midi rue du Gros-Horloge : c'est-à-dire l'endroit de Rouen où, compte tenu de l'affluence, on pouvait vendre à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Surtout quand on était une fille de 20 ans et qu'on possédait une voix conséquente, pour appeler le chaland !
Je le vendais, bien, mais je n'arrivais pas souvent à le lire en entier, ce canard libertaire : les articles (la majorité d'entre eux signés Maurice Joyeux, ce nom étant à mes yeux le signe que j'étais bien au bon endroit pour l'avenir) étaient touffus, hérissés de convictions, curieux mélanges d'anathèmes, de lyrisme sur fond de démonstrations et d'allusions historiques dont je ne possédais pas les clés ; je préférais de loin les revues mensuelles de "La Rue", qui étaient dévolues chaque mois à un thème, et qui, beaucoup plus pédagogiques, m'étaient du coup plus abordables.
N'empêche qu'être sollicitée pour écrire un article qui, potentiellement, pourrait peut-être paraître dans Le Monde Libertaire, c'était très très très intimidant.
J'avais déjà, à 20 ans, l'habitude d'être seule fille au milieu de mecs. Sans doute mon enfance, passée avec deux frères très peu distants de moi par l'âge (cela se comptait presque en mois pour le plus proche !), m'avait donné l'aisance nécessaire, le manque d'appréhension et l'habitude d'une certaine confrontation, que d'autres filles ne possédaient pas.
En tout cas, c'est une caractéristique de ma vie -encore maintenant : je suis très souvent seule fille au milieu de garçons, sans l'avoir jamais délibéré. Il a donc bien fallu que je m'y fasse.
Mais j'étais néanmoins fille - et nous étions fort peu nombreuses, à la fédé anar. C'est donc à cause, très certainement, d'une "discrimination positive" qu'on m'avait proposé ainsi de m'exprimer sur le sujet.
J'en fus incapable.
Oh, ce n'était pas d'écrire qui me tourmentait : les mots me connaissaient déjà. Mais le projet d'article que je rendis, quinze jours plus tard, fut un échec retentissant.
"Bien", dit le leader après avoir lu mes quatre petites feuilles, écrites largement. "Tu as parfaitement résumé les thèses féministes. Mais par contre, l'anarchie là-dedans, e tle rapport entre les deux, je ne le vois pas - du tout."
Je fus bien entendu mortifiée - mais j'acceptais la sentence. J'avais été incapable de trouver la moindre documentation (et internet n'existait pas, je le rappelle tout de même...) sur ce thème. Et ni les écrits sur Makno ou la CNT, ni les thèses phalanstériennes de Fourier, même critiquées par Proudhon, ne pouvaient guère me sauver. Voyons, imaginer un monde où, comme par magie, la sexualité s'arrangerait à merveille, sans violence et dans une égalité harmonieuse, (par exemple, l'amateur de sexe sur fond de souliers féminins trouvant une partenaire aimant précisément regarder un homme boire du champagne dans sa godasse - tous les deux "prenant leur pied" ainsi, wouarf...) m'était absolument impossible.
Nous étions dans les années où les réflexions féministes aboutissaient à la nécessité, non seulement d'un combat contre le machisme ambiant, mais encore d'une prise de conscience des mécanismes fondamentaux de l'objectivation de l'autre - et les quelques malheureux textes que j'avais pu parcourir pour mon article n'avaient effectivement rien "d'anarchistes", et tout de "féministes".
De toute façon, l'ambiguïté du combat féministe - après tout, n'était-il pas mené en priorité par des avocates, des intellectuelles, des bourgeoises, ce qui indiquait qu'il pouvait fort bien se limiter à du réformisme, à l'application de revendications égalitaristes, sans changer radicalement la nature humaine (et pourquoi être anar à 20 ans, si ce n'est pour changer radicalement l'être humain, bon dieu de merde ?) ne m'apparaissait pas encore clairement.
C'était la même ambiguïté qui entourait les combats pour l'homosexualité, d'ailleurs. Le paradoxe qui consistait à en arriver à revendiquer avec eux le droit au mariage (alors que, pour un libertaire, le mariage n'est ni plus ni moins qu'une sorte de contrat relevant d'une société étatisée, et pour une féministe, une déclinaison légalisée de la prostitution) ne me gênait pas trop, certes : je disais "d'abord, luttons pour qu'on arrête de leur casser la gueule. Après, nous verrons..."
Mais j'avais conscience aussi que je ne pouvais interroger franchement mes braves camarades libertaires en développant ces "points d'achoppement" - qui étaient pourtant les seuls intéressants dans l'histoire. Il faut dire qu'à l'époque, les militants anarchistes, mâles dans leur immense majorité, étaient aussi des "machos" de première. J'invite tous ceux qui ne me croient pas à écouter attentivement Léo Ferré - où à prêter l'oreille à l'une de ses premières phrases, sur cette vidéo . ("Ruteboeuf avait des problèmes d'argent et de femmes, ce qui est souvent la même chose", ben voyons.)
Je fus incapable, malgré les encouragements, d'étoffer mon article par la partie qui "manquait".
Mais cet échec, et aussi le fait d'entendre des réflexions, de la part de mes potes anars de l'époque, fleurant bon l’homophobie primaire firent que je quittai, quelques mois plus tard, la Fédé. J’entrai du même coup dans la nébuleuse féministe : les groupes femmes, le café « Adèle Blanc-Sec » du quartier Saint-Nicaise, les manifs et les discussions m’occupèrent longtemps…
Avant d’être interdite (comme par hasard) d’entrée dans un groupe femmes auquel je souhaitais adhérer. (encore une autre histoire !)
Mais ces différents échecs de mon engagement « militant » ne m’empêchaient pas, même s’ils étaient particulièrement durs à vivre, de m’emparer des thèses et des convictions qui m’étaient présentées.
Et c’est bien par le mouvement libertaire que je fus conduite à l’écologie : précisément dans un des numéros de cette revue mensuelle « la Rue », consacré à ce thème, et qui présentait la plupart des thèses écolos.
Il y avait d’ailleurs comme un lien ontologique entre l’écologie et l’anarchie : le refus de la société étatisée nécessaire à l’avènement du nucléaire. Certes, les écolos pouvaient « trimballer », plus que de raison, des contradictions et des errements qui n’allaient pas leur servir – encore moins quand il fut décidé qu’ils sortiraient de la sphère uniquement associative et qu’ils entameraient un combat politique, ce qui était et est toujours, à mon sens, largement hors de leur portée.
Mais les fondamentaux étaient là, et je les adoptais aussitôt.
N’allez pas croire que j’oublie, en vous racontant tout ça, mon sujet premier, à savoir l’écologie et le féminisme. Mais en retournant vers ce passé, il me semble aujourd’hui que le décalage (encore et toujours, soupir !) qui existe entre mon milieu désormais très fortement écolo et moi, provient de ces prémisses : à savoir que j’ai soutenu les thèses écologistes fondamentales par le biais de textes issus des cercles libertaires, que j’ai rencontré ces textes au moment où j’allais quitter ce milieu libertaire pour intégrer le mouvement féministe de l’époque, et qu’il y a donc eu, dès le départ, comme deux « registres » bien différenciés dans ma pensée : un plan où il s’agissait de penser des rapports économiques et sociaux radicalement différents, sous peine de naufrage environnemental, et un autre où il s’agissait de faire l’apprentissage de la libération de la femme, comme on disait à l’époque – mais en remisant pour de bon le moindre robot Moulinex, évidemment.
Je n'ai pris conscience ces différences avec ceux qui m'entourent désormais que lentement - et encore aujourd'hui, je pense qu'il ne serait pas négatif que j'éclaircisse, autant que je le peux, cet écheveau qui s'est noué, pour moi, dès mes vingt ans...
(la suite à plus tard).
L'ombre de la main de Léonard
- Par clopine
- Le 23/01/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
VU sur Arte l'enquête "picturale" sur un tableau attribué (avec quelques éléments sérieux de vraisemblance) à Léonard de Vinci :

Comme d'habitude, le souci de monter le documentaire en "enquête policière" conduit à quelques "tics" assez énervants : la répétition, à intervalles réguliers, des mêmes phrases( "il faut désormais que l'acheteur apporte la preuve irréfutable" "l'expert doit désormais prouver", etc. Mais il semble qu'aucune émission ne puisse, désormais, à l'instar de la publicité, faire l'économie de la répétition : soupir.) , la recherche de "suspens", avec passage tout aussi obligé sur le "plagiaire" qui va "montrer comment les faussaires font" (mais qui n'en est pas un, hein, soyons clairs ! Wouarf....) , et surtout l'enjeu : une toile achetée 22 mille euros qui se retrouve "trésor inestimable" (expression dite à plusieurs reprises) mais dont on nous donne cependant l'estimation (des millions de dollars).
Bon, je reconnais que le tableau est beau, la recherche fascinante : vérifier la datation du velin, reconstituer la technique de peinture, expliquer pourquoi le tableau ne fut jamais accroché ni même mentionné, retrouver le modèle et son histoire, comprendre que le tableau était en fait une page d'un livre retrouvé en Pologne, faire coïncider l'identité du modèle, sa place à la cour des Sforza, la prèsence du peintre sous l'autorité de son commaditaire, père naturel de la princesse, déterminer que le tableau a été peint par un gaucher et retrouver les trous de la reliure, correspondant exactement à la feuille découpée, dérobée du livre 'd'origine : quelle jolie histoire, n'est-ce pas ?
Le dernier mot du documentaire souligne ce qui, aux yeux du réalisateur, est donc le plus important : la valeur monétaire de la toile -dernière offre refusée : 80 millions de dollars. On sent le frisson qui parcourt l'échine...
Mais pour moi, c'est autre chose que le "prix" de l'oeuvre qui m'a fait frissonner : une experte s'extasie sur le dessin de la jeune fille - la dimension de son nez démonre qu'elle est à ce stade intermédiaire entre l'enfant et l'adulte, par exemple, et un faussaire même génial aurait-il pu, comme Vinci, saisir à ce point la vérité du modèle ?
Oui, une femme-enfant est donc représentée là... J'écoute : c'est une fille illégitime de Sforza, une jeune "Bianca" de treize ans. Et le portrait a été effectué pour son mariage...
Son mariage.
Sûrment rien à redire, au quinzième-seizième siècle, au mariage d'une fille de treize ans...
Et une autre phrase, comme ça, au détour d'un plan :
"morte trois mois après ce mariage, vraisemblablement des suites d'une grossesse".
D'un seul coup, les millions de dollars, la "chance" du connaisseur finaud qui a acheté l'oeuvre, le lent travail des experts, la mobilisation autour du portrait, la richesse de la tenue de la princesse, la beauté des cadeaux reçus pour son mariage, dont ce "livre" enluminé et s'ouvrant par son portrait, tout ce luxe, passé et présent, tout ce monde de l'art et de l'argent, tout pâlit à mes yeux...
Chef d'oeuvre de Léonard de Vinci en majesté... Tous ceux qui regardent ton portrait ne voient que lui, que Vinci, le Maître. C'est pour lui qu'on s'extasie, pas pour toi, petite fille mariée et morte trois mois après, car forcée bien trop jeune, comme j'ai vu, parfois, chez les chattes : l'une d'elles, qui n'avait pas fini de grandir, et prise trop tôt, mourant sous un ventre ballonné qui excédait ses forces...
Je n'arriverai pas, sous les "bravos" des spectateurs, les sourires gourmands des connaisseurs et les billets de banque volentant autour de la Trouvaille, à oublier ton sort : et derrière ton fin profil, c'est la brutalité et le machisme de ton temps qui pèsent sur l'ombre de la main de Léonard, dessinant ton front, ton menton, et la belle natte tressée qui pend sur ton dos, droit comme celui d'une écolière, menu comme celui d'un enfant, Léonrad dessinant ce qui fut une "Belle Princesse", à jamais sacrifiée.
Saturday morning fever
- Par clopine
- Le 21/01/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Pour des raisons - dont vous ne saurez rien, je dois derechef, après des moments d'inactivité qui se sont étalés sur quelques années, consacrer 35 heures hebdomadaires à un travail salarié, morne et alimentaire, alors même que je sens tous les jours l'usure de mon corps - et que je dois désormais passer au contrôle technique, comme les voitures, à intervalles réguliers. Ceci n'est pas sans rapport avec mon humeur morose, causée également, cette humeur, par le désastre du monde qui m'entoure, certes. Mais si j'avais 20 ans, je supporterais sans doute mieux l'évolution catastrophique de mes contemporains.
En tout cas, mes contraintes professionnelles ont ceci de bon que je retrouve le goût du samedi matin, que j'avais quelque peu perdu.
Il faut travailler toute la semaine pour bien apprécier le samedi matin. Le réveil tardif, la conscience bienheureuse que non, on n'a pas à se lever, le tapotage de l'oreiller avant d'y replacer la tête de trois quarts, et l'épiage, par la fenêtre de la chambre, de la lumière du soleil qui monte... C'est encore meilleur quand il fait très froid dehors, et qu'un chat vient rontonner dans vos bras, histoire de vous raconter le plaisir qu'il a à vous voir...
Du coup, je retrouve mes vieilles marques, et notamment les moments solitaires, une fois descendue dans la cuisine, où je fais chauffer de l'eau, m'occupe vaguement de petites corvées ménagères, prépare la théière, me verse de l'earl Grey, vais dehors me rafraîchir en déposant de la margarine dans la mangeoire aux oiseaux, traîne le rocking chair dans la cuisine, face à la fenêtre, pour pouvoir mater les passereaux qui viennent s'y nourrir, et ouvre France CUl. (Clopin, lui, le matin, ne supporte pas le bruit de la radio. C'est donc un plaisir solitaire et donc, dirait Marcel Proust, impie et coupable, que de m'adonner à l'écoute de Répliques, d'Alain Finkielkraut - que j'honnis par ailleurs, bien entendu.)
Ce matin, pendant que les passereaux s'en donnaient à coeur joie, le plaisir était précisément là, car l'invité était Hector Obalk, dont je suis "friande", dirais-je. IL y a six ou sept ans, j'avais même plagié Brassens en me décernant le titre de "la fan d'Hector". Cela faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendu (depuis qu'on ne le voit plus à la télé sur Arte, en fait), et c'était un vrai plaisir d'entendre sa voix - qui ressemble pour moi au pépiage de ces jolis oiseaux qui viennent, légers et graciles, se nourrir à mes frais.
Si je me sens en "intimité" intellectuelle avec Obalk, outre le fait qu'il m'apprend tant de choses que j'ignore car c'est un authentique érudit, c'est à cause, je crois, de l'arrière-plan jubilatoire qui l'entoure. Pour son dernier ouvrage sur la Sixtine, il est monté sur un échafaudage, du type de celui que Michel-Ange a emprunté. Finkielkraut était encore ému de l'exploit (pensez ! Monter sur un échafaudage ! ) et je reconnaissais tellement "mon" Obalk dans l'anecdote que je m'en balançais un peu plus vite dans mon rocking-chair -au risque d'effrayer,, au-dehors, les mésanges charbonnières, toujours nerveuses quand elles sont trop proches de la maison.
Ca me faisait tellement de bien, l'enthousiasme juvénile, volubile et jubilatoire d'Obalk, en ce triste surlendemain d'investiture américaine du Roi des Cons, que mon humble cuisine devenait pavée de toutes les couleurs de la Renaissance. Certes, les hypothèses iconoclastes d'Obalk sur Michel-Ange doivent être sujettes à caution, dans les cercles 'autorisés". Moi, je m'accorde à les trouver originales, surprenantes et surtout éclairantes.
Ainsi, pour lui, l'illustrissime scène où Dieu, sur son nuage, effleure sans les toucher les doigts d'Adam : scène donnée comme "clé" de l'Humanisme de la Renaissance, homme et dieu sur le même plan, se regardant en miroir et si semblables qu'on devine tout de suite, comme dans un mythe grec, que le fils va bien finir par zigouiller son papa.
Obalk la voit tout autrement, cette scène si célèbre qu'on ne la regarde plus que détournée vingt mille fois par la publicité : notre vision moderne nous empêcherait de percevoir la perspective voulue par Michel-Ange, la scène devant se lire comme un énorme dieu, très loin, que des yeux du 16è siècle percevaient parfaitement comme relevant d'un effet d'optique perdu pour nos regards contemporains...
J'adore ça, ce genre d'hyptohèses, quand c'est Obalk qui les développe. Parce que ce type est d'une ingéniosité qui repose sur une sorte d'humilité sincère, dans laquelle je me reconnais. Pas le genre à affirmer une théorie un peu aventureuse, à l'asséner, puis à se retirer dans le silence, Obalk. Non : il commence par s'excuser, presque, d'avoir de telles idées, semble cligner un peu de l'oeil, et puis, avec le même plaisir que le prestidigateur sort un joli lapin de son chapeau, vous donne, un peu pataud, le résultat de ses cogitations.
Ca m'a fait beaucoup de bien, parce que je suis un peu frustrée en ce moments, à cause de débats littéraires commencés ailleurs, et qui ont tourné court. Du coup; entendre un type de la stature du critique d'art avoir une telle modestie dans une hypothèse qui, sous ses airs fantaisistes, doit puiser ses racines dans une érudition réelle (je suis sûre que son bouquin sur la Sixtine doit être particulèrement dense !), c'est comme partager -enfin- sur un pied d'égalité, une jolie conversation...
Et c'est donc fort plaisant, pour une fan d'Hector !!!
Une Polémique Marcel (différente, donc, de la Polémique Victor !)
- Par clopine
- Le 18/01/2017
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
ais
Alors voilà : je fréquente un blog dédié à Marcel Proust, plus précisément à la Recherche du Temps Perdu, blog qui est sous-titré "voyages extraordinaires dans la Recherche" et qui est tenu par un certain "fou de Proust".
Une sorte de discussion s'y est engagée entre un internaute "Jean Adloff" et moi-même, à propos... de deux adjectifs employés par Proust dans une des plus célèbres scènes du premier tome de la Recherche : "du côté de chez Swann", dans la partie "Combray".
Je me rends bien compte, allez...
Un débat pour deux adjectifs... Et où je m'engage, moi qui n'ai aucun titre pour ce faire, alors que des litres et des litres et des litres d'encres universitaires ont été répandues et n'ont même pas encore eu le temps de sécher, qu'on élucubre là autour depuis des lustres, et que, s'il y a UN livre qui ouvre légitimement à toutes sortes d'interprétations, c'est bien la Recherche.
Alors, pourquoi ne pas admettre bien tranquillement l'opinion de Jean Adloff, et vouloir "batailler" (avec le sourire quand même, hein !) là autour ? Je me mets en danger, avant tout d'être renvoyée dans mes foyers pour cause d'impertinence et d'illégitimité, et après tout pour un résultat couru d'avance : Jean Adloff est particulièrement convaincu d'avoir raison, et il semble qu'il ne soit pas le seul de son opinion, sur ces deux fameux adjectifs.
D'autant que la lecture induit cette liberté d'interprétation, puisque chaque lecteur introduit dans le texte qu'il aborde une part de lui-même...
C'est peut-être justement cela. De la même manière qu'un Onfray chaud bouillant, s'appuyant sur "le livre noir de la psychanalyse", entreprend de déboulonner la statue de Freud, de la même manière j'ai envie de défendre "ma" lecture de Proust, fondée sur le respect du texte littéral et et quelques considérations sociologiques générales, notamment sur les clichés entourant la question de l'homosexualité.
Si le débat pouvait s'ouvrir, j'en serais enchantée...
En attendant, voici les deux adjectifs incriminés : "impie" et "secret",
et voilà le passage en question. Un des plus célèbres, à juste titre, dans la richesse psychologique du tout est superbe :
"Maman resta cette nuit-là dans ma chambre et, comme pour ne gâter d’aucun remords ces heures si différentes de ce que j’avais eu le droit d’espérer, quand Françoise, comprenant qu’il se passait quelque chose d’extraordinaire en voyant maman assise près de moi, qui me tenait la main et me laissait pleurer sans me gronder, lui demanda : « Mais Madame, qu’a donc Monsieur à pleurer ainsi ? » maman lui répondit : « Mais il ne sait pas lui-même, Françoise, il est énervé ; préparez-moi vite le grand lit et montez vous coucher. » Ainsi, pour la première fois, ma tristesse n’était plus considérée comme une faute punissable mais comme un mal involontaire qu’on venait de reconnaître officiellement, comme un état nerveux dont je n’étais pas responsable ; j’avais le soulagement de n’avoir plus à mêler de scrupules à l’amertume de mes larmes, je pouvais pleurer sans péché. Je n’étais pas non plus médiocrement fier vis-à-vis de Françoise de ce retour des choses humaines, qui, une heure après que maman avait refusé de monter dans ma chambre et m’avait fait dédaigneusement répondre que je devrais dormir, m’élevait à la dignité de grande personne et m’avait fait atteindre tout d’un coup à une sorte de puberté du chagrin, d’émancipation des larmes. J’aurais dû être heureux : je ne l’étais pas. Il me semblait que ma mère venait de me faire une première concession qui devait lui être douloureuse, que c’était une première abdication de sa part devant l’idéal qu’elle avait conçu pour moi, et que pour la première fois, elle, si courageuse, s’avouait vaincue. Il me semblait que si je venais de remporter une victoire c’était contre elle, que j’avais réussi comme auraient pu faire la maladie, des chagrins, ou l’âge, à détendre sa volonté, à faire fléchir sa raison et que cette soirée commençait une ère, resterait comme une triste date. Si j’avais osé maintenant, j’aurais dit à maman : « Non je ne veux pas, ne couche pas ici. » Mais je connaissais la sagesse pratique, réaliste comme on dirait aujourd’hui, qui tempérait en elle la nature ardemment idéaliste de ma grand’mère, et je savais que, maintenant que le mal était fait, elle aimerait mieux m’en laisser du moins goûter le plaisir calmant et ne pas déranger mon père. Certes, le beau visage de ma mère brillait encore de jeunesse ce soir-là où elle me tenait si doucement les mains et cherchait à arrêter mes larmes ; mais justement il me semblait que cela n’aurait pas dû être, sa colère eût été moins triste pour moi que cette douceur nouvelle que n’avait pas connue mon enfance ; il me semblait que je venais d’une main impie et secrète de tracer dans son âme une première ride et d’y faire apparaître un premier cheveu blanc. Cette pensée redoubla mes sanglots et alors je vis maman, qui jamais ne se laissait aller à aucun attendrissement avec moi, être tout d’un coup gagnée par le mien et essayer de retenir une envie de pleurer. Comme elle sentit que je m’en étais aperçu, elle me dit en riant : « Voilà mon petit jaunet, mon petit serin, qui va rendre sa maman aussi bêtasse que lui, pour peu que cela continue. Voyons, puisque tu n’as pas sommeil ni ta maman non plus, ne restons pas à nous énerver, faisons quelque chose, prenons un de tes livres. »
Bon, voilà, nous y sommes.
Alors, thèse de Jean Adloff. Le "geste de la main impie et secrète" serait une masturbation du jeune Narrateur, masturbation qui serait un secret si lourd à porter qu'il en expliquerait toute la Recherche, construite à partir de ce geste "primitif" (comme la "scène primitive" de Freud, qui prétend que chaque enfant assiste aux ébats sexuels de ses parents et éprouve du même coup le complexe d'Oedipe, désir sexuel de la mère et envie de meurtre du père).
Ma thèse : le "geste de la main impie et secrète" serait une métaphore non d'un acte masturbatoire commis pendant la scène racontée, mais simplement du chagrin que l'enfant, dans sa victoire à la Pyrrhus, cause à sa mère, elle-même prise dans un conflit de loyauté.
Les arguments pour ma thèse sont les suivants :
(suite à plus tard).
38,5 degrés de critique littéraire (suite)
- Par clopine
- Le 06/01/2017
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Allongée dans le lit maternel, la maison enfin vide autour de moi et les genoux relevés portant tous les livres que je voulais, je bénéficiais apparemment du calme préconisé immuablement par le médecin : mais ce calme concret dissimulait une telle intensité d'émotion et de pensées, au fur et à mesure que je tournais les pages, qu'une seule héroïne littéraire peut rendre compte de ce tumulte : la petite Jane Eyre, derrière son rideau. Une frangine, sans aucun doute.
Tout m'était bon, certes, mais déjà je trouvais plus de matière dans Victor Hugo que dans Enyd Blyton. Moi aussi, comme la soeur d'Alice, je commençais à préférer les livres "où il n'y avait pas d'images" et parfois, quand les passages trop difficiles (mais il y en avait de moins en moins) me faisaient obstacle, je ne cherchais pas d'explications à l'extérieur, mais reprenais mon élan, reculais d'une page ou deux, et arrivais généralement, contexte aidant, à emporter l'explication.
Je pense que c'est vers 8 ou 9 ans qu'à l'occasion d'une grippe, j'ai commencé sérieusement à vouloir savoir "comment c'était fait". Comment de simples mots pouvaient aboutir à de tels ravages, de tels emportements : pourquoi n'étais-je déjà plus libre de suspendre ma lecture, s'il s'agissait de savoir si Claude Gueux allait mourir, la petite Fadette être aimée de Landry ou Raskolnikov être démasqué. Plus tard, ma rage de lecture me fit craindre d'être atteinte de bovarysme - mais je savais déjà trier, laisser tomber les stupidités type Guy des Cars.
Je crois que c'était la fièvre qui m'aidait à opérer ce tri, ce classement, cet embryon de "critique littéraire". La fièvre est une formidable alliée pour affiner son goût et son analyse (même si, découvrant avec ravissement la grammaire à l'école, je compris très tôt que savoir agencer des briques n'a rien à voir avec la beauté d'un mur, sinon, bien entendu, que cet agencement est l'art même de le faire tenir debout), parce qu'elle correspond, chez le lecteur, à la poussée créatrice de l'écrivain.
La limite était très claire : 38,5 °; Au-delà, la chambre commençait à tourner, mes yeux se brouillaient, ma tête retombait sur l'oreiller : je ne pouvais plus lire. Mais mes plus belles appréhensions de ce qu'était un texte se situaient juste un peu en-deça. Je dirais que 38,3 ° est une excellente température pour comprendre comment Hugo, après un long passage explicatif, concentre son propos en une phrase balancée entre paradoxe, oxymore et brillante formule : adjectif plus image contre oxymore plus image, par exemple.
Les textes hors de ma portée étaient ceux écrits sous une fièvre plus intense encore. Il me fallut même être adulte, et apprendre ce qu'était l'ivresse alcoolique pour pouvoir "situer" des textes comme ceux de Joyce, ou certains Céline. Mais enfin, Hugo, Dickens ou Balzac étaient déjà passablement enfiévrés comme ça !
Toute empirique, naïve et peu crédible que puisse paraître cette méthode de "critique littéraire," elle m'est toujours cependant apparue fiable, enfin, plus fiable que ce que j'ai eu le loisir de découvrir ici ou là. Je me souviens ainsi d'un "exercice", appelons ça comme ça, d'un de ces structuralistes (je ne me souviens plus de son nom, mais disons qu'il avait fleuri dans le parterre semé par Barthes) des années 70/80. Il s'agissait du Rouge et Noir, et l'auteur avançait sans trembler que le livre avait été écrit par Stendhal suivant les mêmes règles qu'un jeu de cartes. A preuve, les quatres Dames étaient distribuées. Evidemment, les Dames de coeur et de pique étaient respectivement Madame de Rênal et Mathilde de la Mole , mais la belle Amanda était la reine de trèfle, et Madame de Fervaques, de carreau. Le tout argumenté, bien voyons. C'était drôle, intelligent, bien construit... et totalement absurde. Qui pourrait sérieusement croire que le Rouge et le Nor a été élaboré mentalement par un Stendhal pendant qu'il jouait à la belote ?
(par contre, le soupçon que l'essai structuraliste en question ait été écrit par un étudiant venant de passer une soirée arrosée à jouer au tarot est lui, beaucoup plus fondé, à mon sens...)
Quand on sait ce que le structuralisme a causé de dégâts à l'enseignement du français, on peut avoir de l'indulgence pour la méthode parfaitement empirique avec laquelle j'ai bricolé mes propres critiques littéraires. Et l'on peut me comprendre, je pense : déchiffrer un livre en étant soignée, (c'est-à-dire ce qui ressemble le plus à être aimée), n'est-ce pas la condition sine qua non pour comprendre le pouvoir de la littérature sur l'âme humaine ? D'autant que, notamment ici, je mesure et restreins bien évidemment ce pouvoir aux limites thermographiques des fièvres d'une fillette pourvue d'un rhume carabiné...
(et hier, j'ai atteint 38,6°).
38,5 degrés de critique littéraire
- Par clopine
- Le 06/01/2017
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Je crois bien que ce sont les maladies que j'ai préférées, dans mon enfance. Je crains que les enfants uniques, régnant sans partage sur l'attention que leur mère peut leur porter, ne puissent me comprendre. Mais pour moi, dans ma famille nombreuse, être malade était une bénédiction. En tout cas, moi qui étais une fillette des plus pleurnicheuses, "jamais contente" et de l'avis de tous une source de problèmes, j'étais une petite malade aussi idéale (sans la fin tragique) qu'un petit prince d'Oscar Wilde.
D'abord, je n'allais pas à l'école. Mais ce mot "école" ne rend pas compte du soulagement que j'éprouvais, et peut tromper ; car ce n'était pas "l"école" qui étati un problème : dès mon arrivée dans la classe, je me sentais généralement bien, occupée, intéressée. Ce qui me chagrinait d'ordinaire, et à quoi je coupais quand je restais à la maison, c'était la crainte d'être soit en retard, soit en avance ; c'était le "sas" entre la maison et l'école qui me préoccupait chaque jour. Si j'étais malade, eh bien, la question ne se posait plus.
De plus, ma mère, qui n'était ni câline ni encline à donner aux enfants de trop bons sentiments d'eux-mêmes (mais elle compensait ce trait de caractère par une loyauté et une vaillance jamais démentie), baissait un peu la garde, en cas de maladie. Elle promettait des récompenses, en échange du courage à supporter l'épreuve de l'absorption des médicaments. Et puis, quand on était malade, on était ainsi seul avec elle, pendant l'absence scolaire des autres enfants. Je crois bien, ma parole, que je me serais incoulée moi-même l'angine ou la rougeole, pour obtenir ce fabuleux résultat.
D'autant que, malade, j'avais le droit d'être dans la chambre et le lit parental, pendant la journée. Ca, c'était le mieux. Le lit m'apparaissait aussi vaste que l'océan, et si la fièvre me faisait chavirer, l'illusion était alors parfaite.
Quant aux douleurs des maladies enfantines, eh bien, j'ai eu la chance d'être enfant quand les médecins, dits "de famille", se déplaçaient encore chez leurs patients. Quel qu'ait été l'état de ma gorge, il me suffisait d'entendre le pas lent et pesant du médecin grimpant l'escalier du perron pour commencer à moins souffrir. Car si ce pas était souvent fatigué, il était aussi déterminé et bienveillant. Je me rends compte, avec la distance, que le médecin était aussi le seul homme adulte de mon entourage qui prenait le soin de m'interroger, d'écouter mes réponses. J'adorais sa venue, j'adorais tout le petit cérémonial des visites, la cuiller à soupe que ma mère allait chercher dans le tiroir de la cuisine pour que le docteur m'ausculte la gorge, la discussion dans le couloir entre le médecin et ma mère, l'oracle qui tombait : "elle en a pour quatre jours... ", jusqu'aux paroles redondantes qui tombaient à chaque visite : "mais cette petite est bien trop nerveuse, le calme lui fera du bien".
Je pense aujourd'hui que ces visites à domicile avaient, outre la vertu de simplifier la vie d'une femme comme ma mère, accablée d'enfants et sans moyens de transport, l'avantage de permettre au médecin d'entrer dans la vie même de ses patients. De voir l'intérieur des maisons, d'estimer non seulement l'évolution des angines mais aussi le degré de fatigue des mères et le niveau du ménage, de jeter mine de rien un coup d'oeil à la cuisine ou de poser la main sur les radiateurs, histoire de voir si le chauffage marchait, de suivre les évolutions, aussi. Je me souviens de discussions entre ma mère et le médecin sur la télévision (une des premières de tout le quartier), et de l'usage que l'on en faisait.. .
Peut-être que les médecins généralistes d'aujourd'hui, qui passent les quinze premières minutes de la consultation l'oeil rivé sur l'écran de l'ordinateur, à vérifier votre dissier tout en vous écoutant sans plus même regarder votre visage, sont plus renseignés ainsi que leurs confrères d'antan sur l'état réel de leur patient. Mais j'en doute.
Il n'y a pas eu une seule maladie de mon enfance qui n'ait été pour moi la source d'un contentement suprême : pouvoir lire jusqu'à plus soif. Je ne peux décrire le plaisir que je ressentais, accoudée aux oreillers du grand lit, les genoux relevés, la porte entrouv'erte sur le couloir et les allées et venues de ma mère dans la maison perceptibles et rassurantes, le chat en boule au bord du lit, et le livre grand ouvert. Ma parole : je crois bien que je pouvais lire toute la journée sans en être fatiguée, au contraire...
Et tout enfant, c'est également pendant ces périodes de maladie et d'intense lecture, très tôt donc, qu'une des questions qui allaient, par la suite et sans prétention de ma part, se poser constamment dans ma vie, a pour la première fois surgi : à savoir "Comment c'était fait ? Comment cela fonctionnait-il ?"
(la suite à demain)
L'art des Cris...
- Par clopine
- Le 31/12/2016
- Commentaires (1)
- Dans Mes textes
Si je m 'accorde une qualité, c'est bien celle de lectrice : mais cela ne signifie rien, hélas, sur l'art d"écrire : car mes lectures faisaient partie d'un temps qui n'est plus celui d'aujourd'hui, et ce qu'utilisaient les écrivains n'est plus "valable" (quel vilain mot), tel le ticket du métro, pardon, du RER, au-delà d'une certaine limite.
l'art décrit, l'art d 'écrit, l'art des cris dornavant , est, à mon sens, de plus plus en difficile à utiliser, si le but que l'on recherche est celui de décrire ce moinde, et sa propre posture;
Et ce, parce que la littérature avait toujours fait bon ménage avec la nature, dans une relation disons "essentielle", et que ce n'est plus le cas : le petit Marcel embrassant en pleurant ses aubépines était tout entier issu d'un temps littéraire où les émotions humaines étaient peintes avec le matériau du monde sensible.
En un mot, il suffisait de parler du rouge-gorge sautillant sur l'appui de la fenêtre et nourri par une jeune fille blonde aux cheveux tressés pour faire naître, tour à tour, l'amour mélancolique pour les jeunes recluses, le coeur bondissant sous l'ennui quotidien, et le feu sous la glace si cher aux blondes hitckockiennes et à Catherine Deneuve.
Je sais parfaitement (et les jeunes gens, nos grands fils et leurs compagnes, qui hantent désormais Beaubec, aussi rapides, vifs et intermittents que les hirondelles revenues nicher sous la grange tous les printemps, m'en persuadent un peu plus à chacun de leurs haltes passagères) que la "nature", le "monde sensible", le registre des pierres, des plantes, de l'eau, du feu, de l'animal aussi, les éléments quoi, (de moins en moins "premiers") ne sont plus "pertinents" pour exprimer ce que mes jeunes contemporains vivent, et comment ils perçoivent le monde qu'ils partagent et qui les nourrit.
IL faudrait avoir vingt ans, peut-être, et bien du talent sans doute, pour comprendre et retraduire ces nouvelles (et pour moi, mystérieuses) manières d'être au monde : arriver , en décrivant comment un pouce glisse sur la matière transparente, dure et monolithique d'un écran tactile, arriver à faire sentir l'effroi d'un appel amoureux, ou au contraire la désinvolture d'un égoïsme, ou l'angoisse d'un désarroi sans nom : mais je suis bien trop vieille pour comprendre et partager cela.
Oh, ma génération a bien pressenti les choses, pourtant : le parallélépipède noir et glacé de "2001, l'odyssée de l'espace" préfigurait assez bien, à mon sens, ce qui nous arrive. Et c'est un défi formidable qui attend aujourd'hui celui qui voudrait se servir des mots pour parler de soi et des autres : par exemple, la tentation d'un suicide pourrait, devrait sans doute, être illustrée par une panne de téléphone portable, allez savoir...
J'éprouve donc une ormidable incapacité à sentir le monde actuel comme descriptible, saisissable, à portée de mots. Mais c'est cette incapacité même qui m'aide à vivre aux champs, alors que c'est une existence dure et solitaire...
Car ici, (et contrairement, donc, j'insiste, à ce que vivent l'immense majorité de mes contemporains, de plus en plus éloignés du monde sensible et donc de moins en moins aptes à en profiter pour l'humaniser de mots l'usage de la métaphore comme médium entre le sentiment éprouvé et le monde réel est aussi aisé, apaisant, évident que le geste de boire un verre d'eau pour étancher sa soif.
(etsi je connais un peu mieux maintenant le vocabulaire de la ruralité - alors que nos jeunes gens sont bien incapables de distinguer un rouge-gorge d'un chardonneret, par exemple, je ne sais pas même simplement nommer la moitié des objets qu'ils manipulent tous les jours, d'un autre côté).
Le givre, qui s'est installé deuis hier, un peu partout, après un vilain brouillard dense, en est un parfait exemple. La conscience du mouvement de toute chose est d'habitude comme cachée, imperceptible. Mais la gaine étincelante, de ce blanc inflexible du froid, qui enveloppe chaque objet "du dehors" produit le même effet qu'un cliché pris sur le vif : les branches comme entravées par leur élan, et ployant sous le poids de glace, révèlent chaque arbre à lui-même : comment ne pas se servir de ce qui est fourni, ici, à portée de regard, pour exhaler le sentiment si humain, en ce 31 décembre, de nostalgie du temps qui passe et d'appréhension de l'avenir ?
Nous sommes tous (et j'entends ici les occidentaux), aussi "révélés" par notre époque que la géométrie et le mouvement des choses sensibles le sont par le givre. Et sans doute n'est-ce pas un hasard si ce mot sert, en qualificatif, pour la désignation d'une sorte de folie.

défête
- Par clopine
- Le 26/12/2016
- Commentaires (0)
- Dans Mes textes
Tojours le coeur gros pendant cette période. L'impression habituelle d'être en demande de reconnaissance, avivée par les efforts de sociabilité à faire , et si jamais l'on oublie de me dire "merci", je me sens inévitablement réduite au pentagone table-frigo-évier-four-machine à laver la vaisselle - c'est bien évidemment paradoxal, car je ne suis obligée à rien, ce que l'on me fait parfois savoir avec un ton disons acerbe.
Je ne peux pas m'empêcher à la fois de donner raison à l'argument -puisqu'effectivement, je ne suis obligée à rien, (et surtout pas à être là n'est-ce pas), et en même temps de me dire que le "merci" serait peu de chose, et qu'il pourrait même venir de coeur, allez savoir...
c'est la dépression des fêtes : une sorte de période où je pourrais, je m'en rends compte avec effroi, entamer moi aussi le dialogue de la femme rompue...
Mais je ne suis pas, ne veux pas être rompue. S'il le faut, je plierais aussi bien que le roseau ; ce n'est pas le vent qui manque.